De janvier à mai 2018, chaque jour, un texte déposé de Chris Marker, issu de mes cartons.
Agnès de Cayeux
(pages 120-127)
(pages 158-159)
(pages 1-9)
(pages 93-94)
Revue Esprit, novembre 1947 - numéro 139
(pages 751-754)
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Marker
« Accomplir fault les Escriptures. » C'est à cette orgueilleuse humilité que fait penser la tentative de Laurence Olivier portant Shakespeare à l'écran. De toutes les vertus qu'on y découvre, la première à frapper est sans doute cette fidélité, cette piété qui font accéder au film sans surprise. Et cette facilité d'accès, cette évidence, cette impression que tout dans le film est normal et conforme au voeu de Shakespeare, cet apparent effacement du réalisateur, sont en fin de compte mille fois plus frappants que toute ingéniosité gratuite, tout effet extérieur à l'oeuvre originale. Tandis qu'on peut s'attendre, par exemple, dans le Macbeth d'Orson Welles, à être ébloui par des trouvailles de mises en scène, quitte à relire ensuite Macbeth avec un réflexe de défense, ici tout vous paraît découler à ce point des caractères de la pièce, que ce n'est qu'après coup qu'on admire le chemin parcouru pour la retrouver.
Plusieurs raisons ont sans doute décidé Sir Laurence Olivier à commencer son cycle shakespearien (qu'il vient de poursuivre avec Hamlet) par une des pièces les moins « universellement » célèbres : Henry V. D'abord, évidemment, le souci de présenter une oeuvre singulièrement propre à s'accorder aux espoirs de l'Angleterre en guerre (le film a été tourné en pleine guerre, et est dédié aux troupes britanniques). Ce parallèle avec Ivan le Terrible est d'ailleurs sur plus d'un point significatif, et cette alchimie par laquelle les peuples font de leurs anciens souverains des héros démocratiques peut être interprétée dans un sens très optimiste. Il y a aussi l'intention de délivrer Henry V, et du même coup les drames historiques, de je ne sais quel complexe d'infériorité vis-à-vis des grandes tragédies. Mais surtout, et ici nous rejoignons l'accomplissement des prophéties, de tout cet effort vers le cinéma qui anime l'oeuvre de Shakespeare au delà des limites du théâtre, c'est dans Henry V que l'intention en est le plus clairement, le plus manifestement exprimée. Un personnage l'incarne, qu'aucune autre pièce de Shakespeare, en dehors d'une brève introduction à Roméo et Juliette, ne possède : le choeur. Le choeur, le récitant, cette voix invisible et omnisciente des films qui sans ambages avoue, adjure et convie le Dieu Cinéma à se manifester. Écoutez les premières lignes du drame : « Cette baraque peut-elle contenir les vastes champs de France ? Où pouvons-nous entasser dans cet O de bois tous les casques dont l'air d'Azincourt fut effrayé ?... Réparez nos imperfections par votre esprit. Divisez un homme en mille parts, et créez une armée imaginaire. Pensez, quand nous parlons de chevaux, que vous les voyez imprimant leurs fiers sabots dans la terre accueillante… » Et d'un acte à l'autre, nous le retrouverons avec les mêmes avertissements, les mêmes invocations. Si le Dieu Cinéma avait du coeur, il serait descendu sur terre au XVIIe siècle... « Soutenez votre patience, et nous ferons tenir dans le jeu cet espace qui nous arrête… Ainsi, d'une aile imaginaire, vole notre théâtre, dans un mouvement vif comme celui de la pensée... Allons, faites travailler votre imagination, qu'elle vous montre un siège… » Lorsque, dans le film, le choeur deviendra transparent, puis invisible, et que les scènes qu'il appelle naîtront d'un fondu, cet enchaînement paraîtra naturel et voulu. Mieux encore, lorsque l'admirable veillée d'Azincourt s'achève par ces mots « Behold... a little touch of Henry in the night... » nous ne pourrions l'imaginer autrement que dans cette petite tache de lumière qui accompagne le roi, grandissant à mesure que la camera s'approche, et environnée de tentes gonflées comme des voiles, dont sa lueur, au passage, fait une flotte à demi engloutie par la nuit. Il n'est plus question ici de suggestion, mais d'une intention précise contenue dans « little touch » et pour laquelle des générations de metteurs en scène shakespeariens ont dû se mordre le front jusqu'à ce que vienne le film.
Il était donc logique et louable d'adopter Henry V. Encore fallait-il l'adapter. La longueur de la pièce, le ton inhabituel (cinématographiquement parlant) de son dialogue, le caractère de l'époque qui devait la baigner, de tout cela Laurence Olivier s'est tiré avec une intelligence qui défie les louanges. Tout d'abord, le texte beaucoup trop long, devait être élagué. Il l'est, de toute façon, à la représentation. Certaines digressions une fois supprimées, il fallut impitoyablement tailler dans les intrigues secondaires. Ainsi, toute l'histoire de la conspiration de Lord Scroop a disparu, à part une réplique. (Et il est curieux de constater que plusieurs épisodes, longuement développés par Shakespeare, sont ici supprimés, ce qui est normal, mais qu'en demeure un fragment ou une allusion, évidemment incompréhensible au public qui ne connaît pas la pièce, comme s'il s'agissait d'un signe et d'une excuse, d'un clin d'oeil d'intelligence échangé entre Laurence Olivier et Shakespeare). Par contre, une scène est rajoutée, celle de la mort de Falstaff, où l'on entend un écho de la dernière entrevue du moribond et du prince Hal, couronné Henry V le matin. même - scène empruntée à Henry IV et destinée à éclairer le personnage de Falstaff auprès des ignorants. Mais, en raison des coupures, nous ne saurons pas que Bardolph, son compagnon, est pendu pour avoir volé un ciboire. Ni que le soldat avec qui Henry se querelle à la veille d'Azincourt sera retrouvé par lui, et récompensé pour son courage et son franc-parler. C'est dommage, mais l'essentiel du moins est préservé, et si le personnage de Fluellen, le Gallois rageur et loyal, tient moins de place dans le film que dans la pièce, ses deux meilleures scènes subsistent intégralement (encore que la première, confrontation des accents et des tics du gallois, de i'écossais et de l'irlandais, ait découragé les traducteurs des sous-titres). On regrettera moins la suppression des plaisanteries échangées entre Henry et le duc de Bourgogne au moment des fiançailles, et dont la " franche gaîté », comme dit le duc, risquerait, en notre siècle pudique, de raviver les maiden blushes de la ravissante Renée Asherson.
La ligne du drame ainsi épurée et raccourcie, il s'agissait de reconstituer un climat « XVe siècle ». S'étant naturellement reporté à la convention des documents de l'époque, Laurence Olivier a eu l'idée de rester dans cette convention, aussi merveilleusement archaïque que le texte lui-même. Aussi toute la partie centrale du film se joue-t-elle en d'étonnants extérieurs, mi-réels, mi-décors, où au fur et à mesure qu'elles s'éloignent, les perspectives s'amortissent, pour s'achever en fonds plats qui reproduisent à la perfection les miniatures du temps. Le matin d'Azincourt est particulièrement saisissant : dans la lumière de l'aube, une image de livres d'heures s'anime lentement, du paysage se séparent mille petits points encore noirs et raides comme des soldats de plomb. Puis la machine se met en marche, les plans se rapprochent, les soldats se couvrent de métal et de chair, et tout d'un coup on saute de Fouquet à Buffalo Bill, avec une charge de la cavalerie française (sur l'air de « Réveillez-vous, Picards ») qui est peut-être le plus beau travelling de chevauchée qui ait jamais été réalisé.
Mais c'est sur le troisième point, sur la difficulté de faire accepter à un public nourri de langage quotidien et de décors hollywoodiens le style et l'imagerie de la pièce, que Laurence Olivier se montre le plus simplement génial. Il nous propose, au départ, la reconstitution d'une représentation d'Henry V au Théâtre du Globe, créant ainsi un spectacle à l'intérieur d'un spectacle, faisant ainsi accepter au spectateur, par le biais d'une discrète parodie, ce qui risquerait de le choquer dès l'abord. Mieux même, comme le prologue comporte un long exposé historique, nécessaire pour la compréhension de l'intrigue, mais qui deviendrait vite fastidieux, il invente des gags très simples qui détendent le public, sans pour autant l'empêcher de suivre l'argument. Puis, sur les paroles du récitant, la scène s'élargit, les navires apparaissent, puis la. mer, et nous sommes conduits, comme Shakespeare le souhaitait, en France, « après avoir enchanté le détroit des mers » jusqu'à Azincourt (traité, nous l'avons dit, en cinéma très pur). Le public est alors suffisamment « dans le bain » pour suivre sans gêne, jusqu'à la fin, les scènes les plus déroutantes au regard du cinéma habituel : Pistol et son poireau, la déclaration d'Henry à la princesse de France et son ravissant dialogue... Un autre long monologue, celui du duc de Bourgogne, passe, grâce à un long panoramique qui en illustre les termes ; et là encore l'image et la musique répondent si bien au texte, qu'on se persuade d'avoir lu clairement cette intention dans Shakespeare, et qu'à toutes ses inventions dramatiques ou humaines, le vieux Will ait ajouté celle, plus discrète, du speaker... Sur quoi Henry et la princesse montent sur le trône, où ils sont accueillis par les applaudissements... des spectateurs du Globe, car entre temps nous y sommes revenus, par un artifice si simple que je n'en veux pas gâcher la surprise aux spectateurs non prévenus.
Le public suit, un peu étonné, rigolant au passage parce que la princesse parle français avec l'accent anglais (ce qui prouve, après tout, que la transition a été assez convaincante pour lui faire oublier que c'est du théâtre). Il ne réagit qu'au moment d'Azincourt, parce que, comme l'a fort bien dit Jeanson, le Français de 1947 accepte tout, la guerre qui vient de s'achever, celle qu'on prépare, les scandales, les privations, les prélèvements exceptionnels, les prélèvements constants, tout, tout, sauf d'avoir été battu à Azincourt en 1415. Pourtant, que de précautions ! Un texte liminaire avertit les spectateurs qu'il ne s'agit pas d'une reconstitution historique, mais d'une fiction dramatique. (Pour un peu on aurait mis, comme dans les films américains : « Toute ressemblance avec des événements réels, des personnes vivantes ou mortes, est pure coïncidence. ») La copie qui circule en France comporte une coupure importante : le passage, pourtant décrit par Shakespeare, où le connétable de France, exaspéré par la défaite, fait une descente sur le camp anglais, massacrant les pages et pillant le trésor. A la suite de ce méfait, dans la pièce, le roi ordonne à chaque soldat de tuer ses prisonniers. Ici, c'est Laurence Olivier qui a coupé et remplacé ce sombre trait par le combat singulier au terme duquel Henry étend mort le connétable d'un coup de gantelet. Il coupe également la scène burlesque du soldat français implorant la grâce de Pistol, qu'il prend pour un « grand capitaine ». Enfin, lorsque le roi demande le nombre des Anglais tués, le héraut lui répond « Five and twenty », mais le sous-titre, soucieux, en face des dix mille Français massacrés, de diminuer un peu la proportion du désastre, écrit « 5oo ». Tout est donc mis en oeuvre pour que le valeureux public français ne ressente pas avec trop de dureté cet affront âgé de cinq siècles, déshabitué qu'il est depuis lors de toute défaite militaire, ou autre... Eh bien, non, il proteste. Il ne se rassérène qu'à la fin, quand le roi épouse la jolie princesse, signe cinématographique que tout va aller désormais très bien. Or, et c'est là le piquant de l'affaire, si Azincourt est incontestablement une grande défaite, c'est aussi une grande entreprise courageuse, et la noblesse qui s'y fit massacrer prouvait, outre son imprudence, une vaillance et un patriotisme fort respectables. Tandis que cet heureux mariage où nos gens se ragaillardissent, préliminaire au traité de Troyes, consacre une de nos plus grandes catastrophes nationales : l'établissement de la royauté anglaise sur la France, qui ne cessera qu'avec Jeanne d'Arc. Si bien qu'en fin de compte le patriotique public français s'offense au moment du courage, et sourit au moment de la honte, de la capitulation dans l'honneur et la dignité... ce qui est dans l'ordre.
Ceci dit, ne soyons pas trop exigeants sur la valeur historique des personnages. Ils ont parfois la naïveté des images, mais toujours leur éclat. Certes, il nous sera difficile de reconnaître du premier coup, en ce duc d'Orléans au visage lunaire et grand joueur de bilboquet... Charles d'Orléans lui-même. Encore plus difficile de deviner, sous la belle robe de velours et les manières doucement mélancoliques du duc de Bourgogne, l'abominable crapule qui livre la France aux Anglais et, dix ans plus tard, leur livrera Jeanne d'Arc. La question du roi de France est plus complexe. On sait qu'il s'agit de Charles VI, le roi fou (vous savez, celui qui, réveillé par le bruit d'une lance sur une cuirasse, piqua des deux en criant : « A moi, Auvergne, ce sont les ennemis... »), et Shakespeare, dont le récit suit pas à pas la chronique d'Holinshed, ne devait pas ignorer ce trait. Pourtant, dans le texte, rien n'apparaît qui permette de choisir à coup sûr le caractère du roi, et l'on est même tenté de lui attribuer un ton et un port réellement « royaux ». Laurence Olivier, lui, a choisi d'en faire un grotesque, ce qui donne à certaines répliques une valeur ironique qu'elles n'avaient peut-être pas (par exemple, la tirade du dauphin qui commence par « My most redoubted father... ») prête à sourire). Seule vraie méchanceté dont on puisse lui faire grief, mais, outre sa valeur théâtrale indiscutable, disons-nous qu'elle est encore au-dessous de la réalité, et que le spectacle de cette cour livrée aux vassaux d'un monarque dément que seule une crainte obscure du sacrilège gardait de la déposition, eût été mille fois plus éprouvant pour notre chauvinisme. Quant à la représentation des seigneurs français frivoles, vantards et inconscients, nous savons depuis les Bandar-Logs ce que les Anglais pensent de nous. Tout au plus pouvons-nous rire un brin de trouver sur les épaules de cet antipathique dauphin de France la plus parfaite gueule d'Anglais-roux-brûleur-de-saintes qu'ait rêvée M. Boutet de Monvel. Il est plus significatif de relever les deux autres caractères dont l'Angleterre se pare à nos dépens : la piété (aucun Français n'a l'air de se soucier de l'existence de Dieu, alors que le roi et toute son armée l'associent à tous leurs actes) et la démocratie (les seigneurs français n'ont aucun contact avec la troupe, se vantant de leur faste à la veille d'Azincourt, tandis qu'Henry s'entretient familièrement avec ses soldats « and calls them brothers, friends and counttymen...»). Et certain choc de montage entre les chevaliers français buvant le coup de l'étrier, et un visage de paysan anglais ruisselant de sueur tandis qu'il enfonce les pieux sur quoi les premiers nommés viendront s'empaler, résume le débat.
Parler de Laurence Olivier acteur, comme de Laurence Olivier metteur en scène, décourage la louange. Disons seulement qu'il est beau, d'une beauté dure, sans faille, sans cadre, qui s'accommode d'une invraisemblable coiffure en bol, d'une couronne posée comme un pot de fleurs... Disons aussi que pour la première fois, nous avons l'impression d'avoir vu un acteur. Quel que soit notre amour de Jouvet, de Dullin, de Barrault, il restait toujours une zone d'ombre entre eux et l'image que nous nous faisions d'un Talma, d'une Rachel... Nous finissions par mettre cette zone d'ombre sur le compte des prestiges du passé, de la légende. Et c'est peut-être le cas pour certains d'entre eux. Mais les autres, maintenant que nous avons vu Laurence Olivier, nous savons de quelle race ils étaient, à quoi, à qui ils pouvaient ressembler. Autour de lui, qui possède cette double fonction de grand acteur de théâtre et de « bête de cinéma », cette ambivalence humaine et divine, gravitent de parfaits comédiens, tous interprètes habituels de Shakespeare en Angleterre, et qui nous sont par conséquent inconnus, à part Leslie Banks (le choeur) en qui nous reconnaissons le sombre héros des Chasses du comte Zaroff, et Robert Helpmann (l'évêque d'Ely) dont la réputation de danseur a franchi le Détroit.
Il faudrait dire bien d'autres choses, vanter le Technicolor (dont la qualité, disent les mauvaises langues, est inversement proportionnelle à la proximité dans l'espace de Mme Nathalie Kalmus, détentrice des brevets... ), dire tout le bien possible de la musique de William Walton, où nous retrouvons plusieurs thèmes de chez nous - et aussi, chose rare, de la qualité littéraire des sous-titres - admirer la construction de l'oeuvre, dont le désordre apparent de chronique, style « Goetz de Berlichingen » ou « La Jacquerie », cache un plan vigoureux, amenant et prolongeant le fortissimo d'Azincourt (lequel, pour les gens curieux de ces choses, se situe dans la pièce et dans le film en un point correspondant à la section d'or)... Le spectateur y suppléera. Il n'est quand même pas indifférent de souligner enfin que ce film épique, qui bat sur leur propre terrain les grandes machines du cinéma américain, a été réalisé dans des conditions techniques et financières beaucoup plus proches de celles de Païsa que de celles de Ben-Hur, et que, de même que la personnalité de son réalisateur prouve, après Malraux, Cocteau et Orson Welles, la fragilité de la notion de cinéaste, cette réalisation confirme nos espoirs de remise en place du mythe du « cinéma riche » mythe qui paralyse davantage la production française que les accords Blum-Byrnes. Ce caractère populaire dont la pièce se pare, tant dans son origine que dans sa thèse, il s'est trouvé tout naturellement marquer sa réalisation. Dans un domaine d'Irlande Laurence Olivier fit construire un camp, et la bourse du travail lui délégua une centaine d'authentiques soldats irlandais pour renforcer son armée. Grâce à un vétérinaire du pays, il obtint des fermiers voisins cavaliers et chevaux pour la chevalerie française. Les élèves des écoles d'art de Dublin participèrent à la confection des costumes, des étudiants aveugles tricotèrent de fausses cottes de maille... Bref, comme dit Laurence Olivier lui-même dans un article de l'Everybody's Weekly, avec une charmante ingénuité, « le travail de pionniers qui était le nôtre exigeait des méthodes différentes de celles qui sont généralement utilisées dans la production cinématographique ».
C'est peut-être à cela que le film doit d'être, lui aussi, différent...
C.M
Mateo MAXIMOFF : Les Ursitory (Flammarion).
On a déversé bien du faux pittoresque sur la vie des tziganes, leurs rites et leur justice. Voici enfin un tzigane qui rompt le silence, et écrit sur la trame d'un conte flamboyant d'amour et de mort, la plus surprenante évocation de ce monde qui est le sien. Délivré de toute influence, brûlant d'une pureté qui l'isole de toute mode, ce livre enchante et surprend comme le signe d'un autre règne.
Fernand GREGH : L'Age d'Or (Grasset).
Aux souvenirs communs d'une génération, chaque poète impose une forme et un style. Au divertissement, à l'agrément mélancolique des Mémoires se joint ici, éparse à travers ces pages attachantes ou drôles, l'émouvante tentative de conjurer le temps et de rester fidèle à la vie.
Bernard PINGAUD : Mon beau navire (Table ronde).
Un de ces récits d'adolescence qui cernent de plus en plus près la matière du roman, sans pourtant s'identifier complètement avec lui, faute de détachement. Celui-ci a au moins les mérites d'une construction solide et d'une très grande - trop grande peut-être - maitrise de ses moyens.
Allan SEAGER : Equinoxe (Julliard).
Le jeu des sens et des sentiments qui conduit la fille de Richard Miles à être amoureuse de son père se serait sans doute résolu sainement sans l'intervention d'un psychiatre. Le plaisir de voir remettre la psychanalyse à la place qu'elle occupe neuf fois sur dix apporte une couleur particulière à ce roman noir d'une bonne facture américaine.
Langston HUGHES : Histoires de blancs (Minuit).
Le titre indique l'intention : ce n'est plus du côté des noirs que se situe l'objet. Une jeune littérature vivace renverse les rôles, et met à son tour en accusation le blanc et ses « manières » (The ways of white folks est le titre original. En Afrique noire aussi, on dit « manières de blanc »). Aux blancs alors d'apparaitre dans leur pittoresque sordide et brutal. Chacun de ces récits est un acte de justice.
Stephen Vincent BENET : Le Roi des Chats (Julliard).
Un chef d'orchestre à queue de chat, un Bonaparte qui n'est pas devenu Napoléon, des Romains
des diables, des êtres qui sont toujours à la fois dans le temps et dans l'éternité, dans leur peau et dans celle de leur ange gardien, et dont chaque geste ébranle depuis le fond des âges le mécanisme de l'aventure humaine, telles sont les composantes de la cuisine S.-V. Benet, en qui s'incarne à une rare profondeur, sous la parure de l'humour, l'épanouissement de la culture américaine.
James Gould GOZZENS : Hommes et frères (Julliard).
Un ministre du culte qui arrange les affaires de ses pénitents, s'occupe des malheureux, sort les innocents de prison et remet les défroqués au couvent, bref, fait son métier et se conduit comme un homme normal : il n'en faut pas plus pour obtenir d'inépuisables effets de surprise.
Diana FREDERICA : Diana (Deux Rives).
Confessions d'une lesbienne, d'où il ressort que le tonus habituel de ces amours anormales est fait d'une ferveur et d'une loyauté qui brillent dans les amours normales à l'état d'exceptions.
Robert S. CLOSE : Prends-moi matelot (Chêne).
Un livre évidemment destiné, par le titre, la couverture et la publicité, au genre de succès qu'a illustré Vernon Sullivan. On n'en est que plus heureusement surpris de découvrir là-dessous un récit de mer solide et empoignant, écrit dans une langue certes peu soucieuse de périphrase lorsqu'il s'agit de femmes et de marins, mais où brillent par moment des images et des paroles qu'on ne se souvient pas d'avoir connues et que l'on n'oublie pas facilement.
Revue Esprit, février 1948 - numéro 143
(pages 292)
Les enfants terribles
par Chris Marker
Il y a une histoire électorale très connue dans l'Union Française : En Afrique noire, avant un meeting politique, le candidat du... (ici un blanc, rempli généralement par le nom du parti adverse de qui vous raconte l'histoire)... dépose une noix de coco dans la main d'un nègre, et lui dit : Premier qui parle, laisse causer. Deuxième, fous-y sur la gueule... Puis il monte à la tribune. Malheureusement, le président de la séance tient à dire quelques mots d'introduction, et, c'est le candidat machiavélique qui, se trouvant en deuxième position, récupère sa noix de coco sur la ... comme il a dit. Il y a une autre histoire : Deux jeunes personnes, l'Une et l'Autre, écoutent la radio. L'Une, qui affecte une grande érudition et un grand amour de la musique, se tient le front avec tous les signes de l'extase, L'Autre écoute un moment, puis lui demande : « Qu'est-ce que c'est qu'y jouent ? » L'Une, en soupirant, et après un discret coup d'oeil à son bracelet-montre, répond : « Le prélude de Tristan.
Tiens, dit l'Autre, je ne me l'imaginais pas comme ça. » Sur quoi la musique cesse et l'on entend : « C'était Wai-Berg et son grand jazz symphonique. Voici maintenant le Prélude de Tristan et Isolde, joué par... » Alors l'Autre dit simplement : « Ta montre avance... ». Ces deux histoires me sont revenues à l'esprit l'autre soir, en entendant à la finale des jeux de Radio-Luxembourg le dialogue suivant :
De qui est le Discours de la Méthode ?
Descartes.
Très bien. L'Anabase ?
Xénophon.
Très bien. Le Maharadjah ?
Montesquieu.
Ici un certain bruit, des toux, des rires. « C'est une plaisanterie, voyons... Coquatrix ... » Puis on passa à la question suivante :
L'Esprit des Lois ?
Revue Esprit, mars 1948 - numéro 143
(pages 472)
La science et la vie
par Chris Marker
Il circule en ce moment en librairie une curieuse publication. Sous le titre : Le Da Costa encyclopédique, fascicule VII, volume II, dans une présentation ma foi très encyclopédique, commençant de façon abrupte en haut à gauche de la première page par un « festations inexplicables » qui laisse supposer une infinité de définitions préliminaires, s'achevant sur la description des extases mystiques de Marie-Ange, et des bonbons y afférents, passant par des définitions qu'on attendait vainement de la science jusqu'à ces jours derniers, telles que « Hectoplasme- Ectoplasme dont la masse pesée dans le vide équilibre exactement celle de cent centimètres cubes d'eau distillée », « Et caetera - Ce que les parents ne veulent pas dire aux enfants », « exagération - Il n'y a rien d'exagéré », reproduisant pour la première fois à notre connaissance le fac-similé du « Permis de Vivre » dont nous sentions la promulgation inéluctable depuis quelque temps, qui n'est délivré que pour un an et n'est valable que s'il porte le poinçon de contrôle pour le mois en cours, dont l'absence ou l'invalidation entrainera la peine capitale, aggravée pour les étrangers d'une mesure d'expulsion... cette publication, dis-je (due, avouons-le, à Patrick Wabberg, poète surréaliste célébré par Harold Kaplan dans la Partisan Review pour ses combats en Magnésie contre le mauvais esprit Mala-Parth) se présente pour les gens d'esprit droit et de sens rassis comme une bonne plaisanterie - et comme telle, témoigne d'une force et d'un sérieux que l'on chercherait vainement ailleurs...
- Sauvages blancs seulement confondre. » (Légende d'un dessin paru dans l'édition d'Omnibook.)
ALLONS-NOUS nous trouver dans l'obligation de faire l'éloge du Reader's Digest ? Il s'en faut. Mais comme on serait plus à l'aise pour dire tout le mal qu'on en pense, si depuis quelque temps cette critique n'était devenue le cheval de bataille d'un nouvel antiaméricanisme qui se montre digne, tant par ses arguments que par son vocabulaire, de celui des années 42-44, et qui, du train dont il va, risque de ravir brillamment le ruban bleu de la... cuistrerie, à l'antisoviétisme des gens d'en face. Si vraiment, comme le soutient l'un des plus sérieux prétendants au ruban bleu, M. Jean Kanapa, il y a deux Amériques (d'accord là-dessus, puisqu'il y a toujours deux quelque chose, comme dit mon ami J. D., l'existentialiste bien connu) qui sont : celle d'Howard Fast tout seul (et d'avoir trouvé ce juste dans Sodome, M. Kanapa, plus exigeant que Jehovah, ne tire aucune indulgence pour les autres) et celle des autres, qui sont, bien sûr, les trusts et ces grands amis des trusts que sont John Dos Passos et Ernest Hemingway - le Ku-klux-klan et ces grands amis du Ku-klux-klan que sont William Faulkner et Richard Wright - le cardinal Spellman, et ces petits potes au cardinal Spellman que sont Henry Miller et Erskine Caldwell, et puis, pèle-mêle avec notre Reader's Digest et son ombre liquide le coca-cola, boisson pernicieuse pour des organismes habitués au pastis, toutes ces abominations babyloniennes inventées pour la perte de l'esprit français, les pin-ups de Varga, alors qu'on peut acheter dans n'importe quel kiosque parisien des images galantes aux poitrines un peu tombantes mais farouchement françaises - les magazines de contes policiers, alors que Détective ou Police-Magazine, publications françaises, vous offrent de vrais crimes, de vrais viols, avec photos et détails - les comics où des personnages et des animaux un peu fous échangent des propos absolument pas cartésiens, alors qu'il vous suffit d'ouvrir l'Humanité pour vous délecter des aventures d'un chien réellement comique (Échantillon des dialogues : Première image : - Quelle tiédeur, on sue de partout ! Deuxième image : - Profitons de cette ombre bienfaitrice. Troisième image : - Roula ! Quatrième image : -Vous allez vous faire tutoyer ! Fin.) - les omnibouques, qui vous concentrent (fort mal d'ailleurs) Saroyan et Steinbeck, alors qu'à pouvoir d'achat égal, la maison Ferenczi, librairie française, publie une collection de romans populaires du genre : l'Amour vainqueur de la purée, en recommandant à ses auteurs : beaucoup d'action, le genre cinéma, et une fin morale ; - les films loufoques, quand nous avons Bourvil, immoraux, quand nous avons Viviane Romance ; -les clubs d'admiratrices de Frank Sinatra, quand les femmes de France, plus raisonnables, savent se grouper toutes seules pour adorer le breton Luis Mariano... si donc tout cela est indissoluble et s'agrège comme le kan à l'apa, alors nous voici contraints de chanter le sénateur Bilbo pour défendre Richard Wright, et moi, grand amateur de gadgets, moi qui vis entouré de haricots sucrés, de biscuits à l'emporte-pièce, de cigarettes qui font rêver en technicolor, de gamelles moulées sur les seins de Rita Hayworth, de chocolat malthusien et de bandes molletières en nylon, j'irai du même coup jouer de l'ukulele sous les fenêtres de De Witt Wallace, roi du Digest et protecteur de Sélection.
Heureusement, John Bainbridge est là. John Bainbridge est un des collaborateurs les plus astucieux de cette merveilleuse publication, le New-Yorker. Le New-Yorker ne figurant pas dans l'énumération de M. Kanapa, j'ignore de quelle amérique il fait partie. Toutefois son cynisme de bonne compagnie, le snobisme narquois qu'il tient de son label, un dandy monoclé, quelques piques destinées à l'U.R.S.S. et je ne sais quoi dans son humour d'irréductible à la notion d'engagement, ne doivent guère le servir à des yeux jansénistes, et le relèguent sans doute, « objectivement », quelque part entre Dorothy Lamour et le bubble-gum. Ainsi étiqueté « objectivement » réactionnaire (et cette distinction, je m'empresse de le dire, me paraît défendable, puisque M. Kanapa, qui est communiste, apporte « objectivement » par chacun de ses articles une moisson d'arguments à la réaction) le New-Yorker cousine donc avec le Reader's Digest. Or - voyez comme les gens sont compliqués et malsains - voilà le New-Yorker, par la plume de Bainbridge, qui engueule le Digest. Et méchamment. Et en détail. Sans doute est-ce une feinte, comme en joue M. Sartre quand il fait semblant d'attaquer le général de Gaulle (« Seuls les naïfs se laisseront prendre » écrit l'Huma) et que les gaullistes font semblant de chercher M. Sartre pour lui casser la fiction grammaticale, et que le Gouvernement fait semblant de supprimer son émission, tout ceci pour la confusion du prolétariat. Mais il est permis de dire qu'en tout cas, c'est bien imité. Tel a dû être l'avis d'Europe qui a publié, elle aussi, un des cinq articles consacrés par Bainbridge aux tenants, aboutissants, engrais et semis du « Petit Magazine ». Et si là-dessus Bainbridge risque objectivement de se faire accrocher comme un américan par M. Rankin ; non moins objective est notre satisfaction de trouver par la voix d'un citoyen américain le réquisitoire que nous n'avions plus le goût d'écrire, contre cette entreprise d'abrutissement polyglotte. Et en fin de compte c'est l'Amérique qui en bénéficie, tout comme le P.C. bénéficierait d'un dékanapage. Si ton oeil te scandalise, arrache-le, fût-il celui de Moscou.
Et puisque, grâce à John Bainbridge, l'affaire Reader's Digest est bien nette, que nous sommes tous d'accord pour en condamner l'esprit, la philosophie primaire, la morale chafouine - et flûtée, l'analphabétisme artistique, la fausse objectivité, qu'on ne vienne pas brouiller les choses en s'en prenant à la formule. Nous sommes quelques-uns à penser qu'un Digest bien fait serait un inappréciable instrument de culture, et qui ne désespérons pas de le faire un jour. Si plaisante que soit l'image proposée par les toutourienistes de la culture, de la méchante fourmi américaine ordonnant à la cigale française qui l'implore : « Vous pensiez, j'en suis fort aise, eh bien, condensez maintenant... » j'avoue que ni la nationalité du Digest, ni le principe du condensé ne me paraissent de grand poids en face de ce caractère, infiniment plus redoutable, qui semble en assurer le succès. Ce n'est tout de même pas par américanophilie que les sondages effectués en France et dans tous les pays bénéficiaires d'une sélection du Digest donnent le même score triomphal à un certain nombre d'articles de la catégorie optimiste-larmoyante, de ces articles où l'on vous exhorte au début pour vous rassurer à la fin. Et ce que Bainbridge appelle la «formule magique » de Wallace pourrait bien se résumer en un mot : sécurité. Importée ou non, condensée ou pas, c'est elle qui déclenche en fin de compte le mécanisme de la satisfaction. J'aime à me représenter chaque livraison du Digest comme une collection d'éponges, ayant chacune pour rôle d'absorber le sang qui, dans son voisinage, circule en excès. Le goût de l'aventure ira s'éponger aux récits lointains, l'inquiétude et la curiosité à de mirobolantes (et controuvées) découvertes scientifiques, le souci d'agir sur les choses se condensera, lui aussi, en mille petites solutions à des problèmes pratiques, et l'ouverture d'esprit se comblera petit à petit de statistiques et de moyens d'enrichir votre vocabulaire. Un peu de morale là-dessus, sous une forme qui tient du groupe d'Oxford, de Lanza del Vasto et de la méthode Coué, et le lecteur se sent d'accord avec l'Ordre des Choses, armé à parts égales d'acquisitions et d'abandons, rincé, vidangé et béat entre ses désirs éteints et ses rêves préfabriqués. Que cette attitude soit aux antipodes de l'idée de progrès, cela n'est pas à démontrer. Mais justement, quelle ne serait pas la virulence d'un Digest basé sur les principes inverses, apportant régulièrement une somme des continuelles provocations de la pensée, des sciences et de l'histoire ! Impartial ? Je vous la laisse, l'impartialité, pour mettre dans le café si vous manquez de sucre de raisin. Passionné, au contraire, violent, contradictoire, déconcertant, tout ce que vous voudrez, mais qui, prenant appui sur la curiosité du lecteur, lui ouvre les yeux sur l'intérêt permanent, réellement permanent, de son aventure, et lui ôte à tout jamais la possibilité de s'endormir sur l'Ordre des Choses. Sur quoi, je le répète, qu'on nous fiche la paix avec la condensation. Pour ce lecteur impréparé, mal informé, un peu paresseux, fatigué aussi, et à bon droit, peu susceptible, spirituellement et financièrement, de se constituer une bibliothèque, une bonne condensation vaut certes mieux que le hasard ou la publicité. Dans la mesure où elle ne s'attaque pas aux chefs-d'oeuvre - il s'en publie tellement ? - peu de textes en souffriront. Certains même y gagneront... Tout cela semblerait évident à Bagdad ou à Sucre, mais nous vivons en un pays de si haute culture qu'on a le droit de se montrer chatouilleux, et que je ne sens que trop la faiblesse de mes arguments. On dit qu'il est des pays où la littérature s'apprend en morceaux choisis, où l'on publie fréquemment des collures de textes nommées anthologies, où la Guerre des Gaules et l'Anabase prennent quelquefois l'aspect d'Omnibooks d'une centaine de pages, où même la religion (horreur !) se condense en un Digest de l'Ancien Testament dénommé Histoire Sainte. J'en tremble. Mais pour nous, holà ! nous qui avons lu Thucydide d'un bout à l'autre et le Livre des Rois sans en sauter une ligne, nous qui n'avons jamais souhaité qu'un roman anglo-saxon eût moins de 665 pages, nous qui nous sommes toujours gardés de lire un Prix Goncourt en commençant par la fin, pour nous, dis-je, il est évidemment difficile d'admettre d'emblée de pareils procédés, qui risquent de donner aux non-spécialistes cette néfaste ouverture sur un domaine étranger, que les littérateurs eux-mêmes demandent aux traités de vulgarisation scientifique et aux anthologies nègres. Je me risque pourtant à ne voir dans le fait du condensé qu'une nécessité économique, justifiée par, des considérations de temps, de clarté et de densité, qui ne vaut ni plus ni moins que la matière qu'elle condense, et que les chastes défenseurs de la culture incompressible condamneraient plus sûrement en lui laissant le monopole de la bêtise, du sectarisme et de la mauvaise foi. Au surplus, elle correspond à un moment, à une situation donnés, et j'envisage aussi sereinement, pour des temps plus tranquilles et des lieux moins encombrés, des éditions dilatées d'articles d'intérêt permanent, qui apporteront chaque jour à des lecteurs avides et jamais rassasiés leurs cent trente huit pages d'Aragon, et leurs six cent quatre-vingt d'Emmanuel Mounier.
Mais ce Digest de combat, que nous appelons de nos voeux, rien n'en annonce la venue, encore que de beaux efforts soient faits par des publications un peu différentes (et, hélas, moins monumentalement « publiques ») comme Caliban ou le World Opinion de Londres. Pour le reste, contemplons ensemble ces piles de Digests multicolores sur mon bureau, comme des confettis. English Digest, Irish Digest, Scots, Junior, Teen-Age, World Digest, Voix « le Digest français », l'édition arabe du Reader's avec palmiers et chameaux, l'espagnole avec ballons roses et la française avec Notre-Dame, le Digeste Catholique (Digeste, rappelons-le, est un nom commun, et non un adjectif) aux couleurs cardinales... Sans doute leurs propos sont bien différents. Le Reader's prêche, le World exalte l'Empire Britannique, le Teen-Age instruit et bricole, l'Irish démontre que toutes choses valables en ce monde sont dues à des Irlandais. Pourtant un facteur leur est commun, et il est de taille : la division du monde en deux. L'U.R.S.S. d'un côté, évidemment, où tout va très mal, et en un seul mois (Janvier 48) je trouve : Bilan d'une illusion (Voix) - Staline en famille (Voix) - On m'a volé mon gouvernement, par Ferenc Nagy (Sélection) - Pourquoi la Russie s'oppose aux Nations Unies (Reader's Digest) - Ce que pensent les Russes (English Digest) - L'Art pour l'amour de Marx (World Digest) - Les camps de travail soviétiques (Catholic Digest) - La force secrète du communisme (Catholic Digest)... et le reste du monde, où tout va mieux que bien. Passe pour la Suisse « heureuse vallée » (World Digest) « qui sait comment rester libre » (English Digest). Mais voici le Japon « oasis d'ordre, de paix et d'effort constructeur » (Catholic Digest) « ouvert comme jamais aux vérités nouvelles » (Informed Reading). On sait comment s'est opérée l'ouverture, n'importe ! les Japonais sont « de dociles démocrates »' (World Digest). Voici l'Arabie où « Ibn Séoud et l'oncle Sam associés répandent sur le désert la manne du progrès » (Sélection) « pays désertique lancé dans l'orbite du monde civilisé » (Voix). Voici Hawaï, island paradise, (Reader's Digest) dont la reine Liliuokalani avait du sang anglais dans les veines, ses ancêtres ayant mangé le capitaine Cook. Voici l'Amérique elle-même, « peuple gentil, hospitalier et courtois » ( I r1:sh Digest), les Brésiliens « au coeur gai, aux manières simples, qui détestent la violence et le sang « (Junior Digest), les Mexicains : « I like mexicans » (Reader's Digest), Saint-Marin, « dont les plus hautes fonctions, sauf une, pouvaient être remplies par le paysan le plus illettré, s'il était réputé sagace » (World Digest). Voici la planète Mars qui « bénéficie d'un beau temps continuel » (Junior Digest). Ce que c'est que d'être en-deçà du rideau de fer...
On dit que l'U.R.S.S. va élever un monument aux marins de Colomb qui voulaient lui faire rebrousser chemin avant d'avoir découvert l'Amérique. La réciproque n'est pas vraie, car sans l'U.R.S.S. on se demande où tous les Digests liquideraient leurs complexes. Mais ce qui s'explique aisément de la part de Digests nationaux, dont le nom, comme un pavillon, avoue la soumission aux règles du chauvinisme et de la bagarre internationale, cela passe plus difficilement peut-être quand on s'appelle Catholic Digest, et que sous ce drapeau on couvre la même marchandise lénifiante, réactionnaire et a-culturelle que le protestant Reader's ou toute autre publication capitalisante. Ce Digeste Catholique, qui s'annonce avec une modestie toute évangélique comme « une source de documentation inépuisable » est en tout cas une source de divertissement à ne point dédaigner. Son texte liminaire est tout un programme : «Le but du Digeste Catholique est de reproduire des articles pris dans toutes les revues catholiques aussi bien que non-catholiques quand elles publient des articles catholiques (!!!). Nous regrettons que ce geste ne puisse être une approbation de tout ce qui paraît dans ces revues non-catholiques. Nous voulons par là les encourager à faire à leur tour usage d'articles catholiques (le texte américain est beaucoup plus beau, qui dit catholic material). En cela nous suivons le conseil de saint Paul : « Pour le reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est convenable, juste, pur, aimable, méritoire - que tout ce qui est vertueux et digne de récompense - que tout cela occupe votre pensée. » A vrai dire, à la lecture du Catholic Digest, notre pensée n'est guère occupée que par ces mêmes ingrédients isolés dans le Reader's par Bainbridge : nous y trouvons les mêmes histoires d'animaux d'Alan Devoe, les mêmes considérations sur le prix du lait et la mort à Hollywood, la même attitude « conciliatrice » envers les rapports du Travail et du Capital. Simplement, ces thèmes rabâchés sont ici confiés à des personnalités catholiques, tel ce père Brown, dont la sagesse n'a guère de points communs avec celle du héros de Chesterton, mais qui a trouvé le moyen de réconcilier patrons et ouvriers : « Deux choses sont indispensables pour faire oeuvre de médiation, dit le père Brown : Les deux parties doivent désirer un arrangement, et la décision médiatrice doit être entièrement acceptable pour les deux parties ». Cette dialectique semble irréfutable, mais quand elle ne suffit pas à emporter la décision, la Providence y pourvoit. Ainsi de cette réunion de machinistes (sic) où deux ivrognes faisaient scandale et refusaient de quitter les lieux : « Je ne veux pas m'en aller, criait l'un, je veux entendre le père Brown. » « Si vous voulez entendre le père Brown, je vous conseille d'aller à la messe le dimanche », répondit un machiniste. La glace fut brisée. Tout le monde se mit à rire et les hommes décidèrent de reprendre le travail. »
Entre autres choses vraies, convenables, justes, pures, aimables, méritoires, vertueuses et dignes de récompense, notons encore l'article de Francis J. Connell sur les rapports du Travail et du Capital, où deux mots reviennent sans cesse : « modéré » et « surnaturel ». Un capital modéré, une prospérité modérée, l'usage modéré de biens temporels, voilà ce que l'Église veut pour l'homme, en précisant bien que « la richesse ne sert en rien pour obtenir le bonheur dans la vie éternelle, mais qu'elle est plutôt un obstacle ». Pour le reste, son but est surnaturel, son point de vue toujours surnaturel, et l'essentiel en toutes choses de garder l'oeil sur le surnaturel. Il n'est pas sans intérêt de rapprocher ce texte d'un des plus lyriques passages du Credo américain (sic) de Mgr. Spellman (« Je crois en l'Amérique, en ses libertés, en ses idéaux, en ses traditions... » sic, sic, sic, jusqu'à l'écoeurement) où le point de vue surnaturel s'oppose brillamment au matérialisme communiste : « En Amérique, cinquante pour cent des familles ont leur automobile. Le fait de posséder ce véhicule nous accorde une faveur dont nous ne concevons probablement pas l'entière portée. Grâce à ce moyen de transport, il nous est loisible de parcourir librement le pays, d'aller le Reader's par Bainbridge : nous y trouvons les mêmes histoires d'animaux d'Alan Devoe, les mêmes considérations sur le prix du lait et la mort à Hollywood, la même attitude « conciliatrice » envers les rapports du Travail et du Capital. Simplement, ces thèmes rabâchés sont ici confiés à des personnalités catholiques, tel ce père Brown, dont la sagesse n'a guère de points communs avec celle du héros de Chesterton, mais qui a trouvé le moyen de réconcilier patrons et ouvriers : « Deux choses sont indispensables pour faire oeuvre de médiation, dit le père Brown : Les deux parties doivent désirer un arrangement, et la décision médiatrice doit être entièrement acceptable pour les deux parties ». Cette dialectique semble irréfutable, mais quand elle ne suffit pas à emporter la décision, la Providence y pourvoit. Ainsi de cette réunion de machinistes (sic) où deux ivrognes faisaient scandale et refusaient de quitter les lieux : « Je ne veux pas m'en aller, criait l'un, je veux entendre le père Brown. » « Si vous voulez entendre le père Brown, je vous conseille d'aller à la messe le dimanche », répondit un machiniste. La glace fut brisée. Tout le monde se mit à rire et les hommes décidèrent de reprendre le travail. »
Entre autres choses vraies, convenables, justes, pures, aimables, méritoires, vertueuses et dignes de récompense, notons encore l'article de Francis J. Connell sur les rapports du Travail et du Capital, où deux mots reviennent sans cesse : « modéré » et « surnaturel ». Un capital modéré, une prospérité modérée, l'usage modéré de biens temporels, voilà ce que l'Église veut pour l'homme, en précisant bien que « la richesse ne sert en rien pour obtenir le bonheur dans la vie éternelle, mais qu'elle est plutôt un obstacle ». Pour le reste, son but est surnaturel, son point de vue toujours surnaturel, et l'essentiel en toutes choses de garder l'oeil sur le surnaturel. Il n'est pas sans intérêt de rapprocher ce texte d'un des plus lyriques passages du Credo américain (sic) de Mgr. Spellman (« Je crois en l'Amérique, en ses libertés, en ses idéaux, en ses traditions... » sic, sic, sic, jusqu'à l'écoeurement) où le point de vue surnaturel s'oppose brillamment au matérialisme communiste : « En Amérique, cinquante pour cent des familles ont leur automobile. Le fait de posséder ce véhicule nous accorde une faveur dont nous ne concevons probablement pas l'entière portée. Grâce à ce moyen de transport, il nous est loisible de parcourir librement le pays, d'aller d'une ville à l'autre, d'État en État, de suivre aisément les routes internationales. Là où le communisme tient les rênes du pouvoir, seuls les puissants possèdent des autos et dans ce cas ils parcourent bien rarement le pays, car ils sont constamment en butte à un espionnage jaloux. »
Dans le genre, j'aime encore mieux les appels du pied de Mgr. Sheen. Et beaucoup plus encore les lettres que je reçois de Jerry ou de Mac, mes amis catholiques des États-Unis. Mais quoi, eux ne disposent pas d'éditions néerlandaises ni de traductions en Braille, et Alvin, tué à Forbach, militant du C.I.O., ne lisait pas le Catholic Digest. Aux yeux du monde, c'est Mgr. Spellman et Francis J. Connell qui sont le visage de Dieu, en compagnie des évêques espagnols bénisseurs de Franco, des évêques français bénisseurs de Pétain, et des évêques italiens pour qui l'abstention aux élections est un péché mortel. Et de ce même Vatican qui, au temps de « Mit brennender Sorge », condamnait la substitution des réalités politiques à celles de la Foi, rien ne vient lutter contre le faux visage de Dieu, le Dieu d'affaires, le Dieu à tête de banquier que Claude Roy a rencontré en Amérique, que Blaise Cendrars avait pressenti dans sa Fin du Monde, ce veau d'or expédié en frigo à travers le monde par un réseau de compagnies... Ce qu'ils font de la religion, les Digests, en même temps et du même mouvement, le font de la culture. C'est parce que le Petit Magazine réunit en lui tous les éléments de cette aliénation que nous ne nous excusons pas, Bainbridge ni moi, d'y avoir consacré tant de pages.
En rade de Ville d'Avray, le 1er juin à l'aube. Pourrons-nous débarquer ? Le haut-parleur nous donne à intervalles réguliers des nouvelles du monde, tandis que pour tuer le temps nous plions et déplions la presse parisienne. Le temps n'est que blessé. Il ne s'arrête pas. « L'EX-ROI MICHEL EST DÉCHU DE LA NATIONALITÉ ROUMAINE » dit le haut-parleur. Pareille mésaventure n'arrivera pas au Commodore Charles Drouilly, roi du chapeau, dont les sujets sont plus conciliants. Cet intéressant personnage, nous apprend France-Dimanche, fait les beaux soirs de Deauville, où il se balance aux réverbères et se coiffe d'une perruque blonde pour amuser les dames. A retenir pour Prévert « Ceux qui commodorent ». « L'ORCHESTRE DES ÉTUDIANTS DE PARIS VA DISPARAITRE FAUTE D'ARGENT. » L'Orchestre des Étudiants de Paris ferait mieux de jouer à Deauville pour le commodore Charles Drouilly qui stimule les musiciens des boîtes de nuit « à coups de pourboires de 10000 et 20000 francs » imité par son ami Spiro Catapolis, célèbre armateur grec... « NOUVELLES EXÉCUTIONS EN GRÈCE »... célèbre armateur grec, qu'on nous présente dansant la samba à 5 heures du matin. Le commodore est en spencer, Miss Amérique « qui est très gaie » porte une fausse barbe, toutes les femmes ont le nioulouque et tous les hommes sont milliardaires. « ROBERT GARRIGUE AVAIT TUÉ POUR VINGT FRANCS. » Miss Joan Redder, envoyée spéciale du Daily Mirror, ayant perdu sa robe du soir, est venue à l'Opéra en chemise de nuit. Personne ne s'en est aperçu. Le comte Stanislas d'Herbemont, lui, change toutes les cinq minutes de cravate, de veston ou de voiture. (Aux Ecoutes.) Quelle exagération ! Voilà comment on alimente la lutte des classes... « UN COMMUNISTE BRÉSILIEN OBTIENT LE PRIX PERON I947. » On croyait que Peron était fachiste. Quand on vous dit que ça s'améliore. Le prix Staline à François Mauriac, le Politzer à Jean Kanapa, et Pierre Boutang viendra réciter des poèmes aux samedis des Lettres Françaises. Ou bien André Maurois, que voici dans Life, en train de lire ses mémoires chez la Duchesse de la Rochefoucauld... « MATHÉ, ANCIEN MINISTRE DE VICHY, ARRÊTÉ PARCE QU'IL FAISAIT LA COUR A SA BOUCHÈRE. ON LUI REPROCHE UN DÉCRET RELATIF A LA CASTRATION DES CHEVAUX DE TRAIT. » Dans un médaillon, un vieux monsieur aux traits fins, entre deux dames assez vulgaires, sans doute un des écrivains invités se rendant au vestiaire... Il y a gourance, c'est le maître d'hôtel qui renseigne une princesse et une comtesse. Jules Supervielle bâille, le duc de la Force s'est fait des frisoulis dans le cheveu. Pierre Hervé détourne les mineurs de leur devoir, il se fait expulser... »
Ah, si nous avions un jour
le charbon de la Ruhr
que la vie serait belle... » dit le haut-parleur. Hé oui, au lieu de représenter M. Frédéric Dupont en officier allemand par un truquage photographique... « M. FRAISSINET EST CONDAMNÉ A 50.000 FRANCS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS »... M. Fraissinet, par un truquage similaire, mettrait la tête de M. Frédéric Dupont sur le corps de Tarzan, et personne ne dirait rien. « QUATRE ANS D'OCCUPATIONS PAR SACHA GUITRY. » Le premier béatifié de ces quatre ans vient d'être proposé à Rome : Un prêtre polonais qui avait pris la place d'un de ses compagnons dans la chambre à gaz. On s'occupe comme on peut. « GUERRE EN PALESTINE. » « Je revis l'image de ma mère.... Je pensai aux êtres qui me sont chers. Je fis un signe de croix et je partis au combat. » C'est Cerdan qui parle, dans France-Soir. Et Gaston Bénac, dans Paris-Presse « au cours d'un ultime round, qui nous apparut un moment comme devant être le dernier... » Heureusement que ça n'a pas duré. « ARTHUR KOESTLER DECLARE... » Qu'il se taise, Koestler. Bourvil chante à la Radio « Le Yogi gai », et Raymond Raynal joue « Le Commissaire est bon enfant ». Qu'est-ce qu'il veut de plus ? Nous pourrons débarquer. Simplement, à la sortie de Saint-Lazare, des inconnus ont nettoyé la pancarte qui porte ces mots « ATTENTION AUX CROCODILES D'ENTRETIEN ». On ne sait encore ce qu'il faut entendre par là...
Pendant la guerre de 1914, on déposait en avant des lignes de petits rats en cage, pour détecter l'approche des gaz asphyxiants. Il semble que l'écrivain engagé, sauf le respect que je lui dois, se soit dévolu ce rôle héroïque, et que le sens de son engagement (volontaire) soit précisément de mettre au service de l'action la sensibilité et le flair dont sa nature d'écrivain a le privilège, en face des antennes rudimentaires du technicien et du politique. Toujours est-il que Jean-Paul Sartre a été le premier à réagir violemment et publiquement (librement aussi) à +ses senteurs mêlées de lavande et de naphtaline qui s'élèvent depuis deux dimanches des prairies de France. Cet hommage rendu, on peut avouer que l'émission qui a fait tant de bruit était assez faible. L'eût-elle été davantage d'ailleurs, que cela n'eût rien changé à rien : il y a beau temps qu'en notre pays d'exactitude les faits n'existent plus. Ou plus exactement, ils sèchent au milieu d'un concert de miroirs brandis à bout de faucille, de flèche, de sabre ou de goupillon, et de se voir ainsi jugés, prouvés, niés ou justifiés en image, sans personne qui s'intéresse à leur pauvre mais honnête existence de faits, ils finissent par douter de leur propre réalité, et s'évanouissent à leur tour dans un au-delà d'où il n'est pas certain qu'un historien dégagé aille un jour les déloger. Pour s'en persuader, il suffit de considérer un quart d'heure avant chaque repas cette évidence : si Sartre avait commencé ses émissions politiques en attaquant les communistes, ce sont les journaux de droite qui auraient brandi l'étendard de la liberté totale d'expression, et l'Humanité qui aurait crié au scandale.
Car le fond de la querelle ne réside pas dans le contenu réel de l'émission, où Sartre avait beau jeu de clouer le bec d'un gaulliste peu convaincant incarné par Chauffard : il semble même qu'il eût été de bonne guerre de laisser un peu d'avance à l'adversaire, et de le régler plus sûrement après l'avoir doué d'une certaine astuce, alors que le personnage fabriqué à cette fin paraissait plus bête que nature - si c'est possible. Mais on voit ce qui a déchaîné en quelques heures l'indignation d'une population bourgeoise enivrée de sa victoire et de son apparente impunité : l'assimilation faite par un des collaborateurs de Sartre et que tous les Parisiens ont pu faire savoir que sur ses affiches électorales, M. de Gaulle avait la gueule d'Hitler. Cela ne se discute pas. Dans la même journée un crieur de journaux (du Monde, qui plus est), un ivrogne fieffé, un pharmacien de première classe, et un économiste distingué m'ont dit la même chose, sans que rien n'indiquât clairement qu'ils s'étaient concertés à l'avance. Comment s'en étonner, d'ailleurs : il existe dans ce domaine une sorte d'obscure attirance qui fait ressembler certaines affiches à ce qu'elles craignent le plus de ressusciter. On se souvient de l'affiche antiaméricaine du temps de l'occupation, ou Fiorello La Guardia avait la tête de Laval, et de cette affiche du Parti Communiste, l'une des premières dans Paris libéré, qui était décalquée sur une page de Signal. Là comme ailleurs, la magie se rattrape, et réalise en sous-main ces mystérieuses alliances qui font les affiches du R.P.F. et le lapsus freudien.
Le scandale et le divertissement résident donc beaucoup moins dans l'émission elle-même que dans ses à-côtés : Bénouville et Henry Torrès qui opposent à Sartre leur goût des gens «normaux et sains», l'Huma qui écrit «M. Sartre attaque de Gaulle, seuls les naïfs se laisseront prendre» et surtout Paris-Presse. On sait que les journaux, pour rester dans les métaphores d'une philosophie élémentaire, sont semblables au chien de Pavlov : au moindre signe, sans qu'il soit même besoin de leur présenter leur nourriture, ils se mettent à baver. Mais Paris-Presse se surp
Au cas où l'émission aurait été réalisée avant la victoire du R.P.F., on pourrait considérer que la diatribe de M. Jean-Paul Sartre est le fait d'une coïncidence malheureuse. L'audition d'hier soir prouverait alors que l'ordre ne règne pas à la Radiodiffusion Française c'est moi qui souligne, il y a de quoi puisque aucun responsable ne s'est avisé dans la journée de lundi qu'il était opportun d'en différer la diffusion... Si, au contraire, le pamphlet sartrien a été conçu, composé et enregistré dans la journée de lundi, il est alors facile d'établir ma préméditation
On a bien lu : dans le cadre d'une «victoire» du R.P.F. un organisme soucieux d'»ordre» a le devoir de «différer» toute atteinte à la personne du vainqueur. Curieuse consécration d'une attitude habituellement flétrie sous le nom d'opportunisme. On pourrait supposer là-dessus que Paris-Presse la prend à con compte, si d'autres signes non équivoques ne laissaient supposer les puissantes raisons qui décident ce journal à se mettre du côté du manche - si j'ose m'exprimer ainsi.
Une dame indignée et nettement sartrifuge me dit : «Il est si laid qu'il a besoin de s'en prendre aux autres.» Comme j'ai vu la veille cette fausse bande d'actualités que la firme américaine Metro Goldwyn Mayer a fabriquée avec quelques images anodines et un vaste extrait du discours de Vincennes pour servir la propagande électorale du général, et que j'ai encore dans l'oreille les rires des enfants, émus de l'incroyable laideur de ce monsieur, dont les multiples mentons semblent conçus uniquement pour supporter le nez, comme les coussinets d'un arbre de couche - j'ai d'abord envie de rire, moi aussi. À la réflexion, cette phrase m'éclaire. Je me souviens d'avoir lu dans Montherlant qu'un public féminin ayant à choisir le plus bel homme de France, on désigna Jean Bouin, qui était difforme, mais qui incarnait le mythe de l'athlète. Sans doute, de Gaulle incarne-t-il pour beaucoup de dames le principe mâle (une sorte de réponse à la Sainte Vierge, pour ces âmes pieuses et simples) et après tout, un bulletin de vote c'est moins compliqué qu'un adultère.
Reste à savoir ce qui se compose réellement au bout de cette consultation démocratique de la lassitude et de la mauvaise conscience qui a donné au R.P.F. sa majorité. Lorsque Sartre la juge, et il la juge sainement, c'est au nom d'une troisième force, d'un refus d'accepter le choix entre les deux blocs. Mais au fond, qui l'accepte profondément en dehors d'une minorité aux deux extrêmes ? Est-ce que la plupart des électeurs même de de Gaulle ne voient pas en lui un moyen précisément d'échapper au dilemme des influences étrangères, en se réfugiant dans cette France seule, dans ce Pays réel que nous commençons à connaître ? Un des apports du marxisme, c'est cette certitude éprouvée que, quoi que l'on fasse, il n'y a pas de combat à trois. Les scouts de Ville d'Avray, les fils d'hommes d'affaires de Neuilly, les dames d'Oloron-Sainte-Marie ne font pas de politique et refusent le dilemme, mais ils portent en choeur leurs voix à de Gaulle. Or, il semble bien qu'il y ait une troisième force : celle qui passe en chacun de nous. Sortis de là, les socialistes irréductibles, les néo-travailleurs français, les M.R.P. forts de la fidélité au néant, les fascistes clandestins pourront bien chercher le tiers chemin, ils déboucheront un jour dans l'une des deux routes nationales. Avec cette multitude de troisièmes forces et l'éparpillement dans l'espace de son ancien empire, joint aux subtiles pénétrations qui s'exercent sur son territoire, la France montre une fois de plus avec éclat qu'elle demeure le pays de Pascal : son centre est partout, et sa circonférence nulle part.
Or, il n'y a plus de centre. Le seul problème est, malgré toutes les tentatives de confusion, le match socialisme-capitalisme. Et tout essai de coiffer cette lutte d'un chapeau ou d'un képi rassembleur et bénisseur est en réalité une aggravation du désordre. Cela revient à joindre artificiellement des éléments liés à l'une des forces en cause, et sollicités par une illusion dont l'abandon les ruine : c'est ainsi qu'on a vu dans le fascisme des gens qui cherchaient la mort du capitalisme et d'autres qui y voyaient son meilleur moyen de survie. Nous commençons à être édifiés sur le culte de ces dieux bicéphales ; le coup de l'Union Sacrée, le coup de l'Etat français, le coup du Rassemblement, on nous le fait une fois, deux fois... Pour nous, c'est fini. Il restera suffisamment de bonnes familles et de braves coeurs pour marcher aux prochaines sollicitations : la garde meurt, et ne se rend pas à l'évidence.
J'avais un ami qui était possédé de cette passion du rassemblement : un jour, il a voulu rassembler deux fils électriques, il a fait sauter tous les plombs. C'est la pensée de ces ténèbres qui dirige mon sentiment envers le néo-gaullisme, et me fait donner à son chef le grade auquel il a vraiment droit, celui de général de division...
Cette pensée, et cette image, passée rapidement dans le cours des actualités, et qui résume pour moi tout le drame du R.P.F. : Malraux, rêveur, dominant cette foule de Vincennes dont la moitié au moins était de l'espèce qui offrait des épées d'honneur aux officiers franquistes, du temps qu'il écrivait L'Espoir...
C.M
(pages 562-565)
(pages 400-405)
(pages 285)
(pages 281-285)
(pages 134-137)
(pages 90-98)
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Marker
LA VIE QUOTIDIENNE ACCABLÉE
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Marker
On discute à la Chambre des événements de Madagascar. Ça commence par un coup de chapeau aux morts... Non, deux coups de chapeau. Comme on évoque d'abord les colons massacrés, la droite se lève et salue. Un peu plus tard, c'est le tour des Malgaches réprimés, jetés vivants d'avions en plein vol... La gauche se lève et salue. Pas de métissage, chacun ne reconnaît que ses morts, et cette vague fraternité des ombres, où l'on pensait qu'allaient enfin s'échouer toutes les guerres, des sergents recruteurs la parcourent, qui ramènent bon gré, mal gré, chaque mort à ses luttes anciennes. Sur quoi le gouvernement, en équilibre sur cette ligne de démarcation lancée du visible à l'invisible, assurant sa gravité au moyen d'un parapluie doublement symbolique, déclare ses bons sentiments, et ajoute que puisque c'est ainsi qu'on récompense son zèle, on ne l'y reprendra pas.
Curieuse morale. Si nous comprenons, bien son raisonnement, le gouvernement nous assure de sa volonté de proclamer une liberté de l'Union française qui s'accorde avec les voeux de tous les peuples libres, à la condition expresse qu'il en tire les mêmes avantages que de l'ex-Empire. Autrement dit, de réunir les satisfactions de la conscience et les bénéfices du pouvoir. Et s'il y a un os, on renoncera plus aisément à la conscience qu'au pouvoir, parce que, n'est-ce pas, « il ne faut pas être dupe ». Curieuse morale, qui pourrait se résumer ainsi : « S'il rapporte moins d'être désintéressé que d'être intéressé, où est l'intérêt ? »
Pourtant, il semble démontré que, dans la conduite individuelle : premièrement, le désintéressement trouve aussitôt sa punition, deuxièmement, la vertu consiste précisément à faire passer cet accord de la conscience avant l'intérêt pur et simple. En quoi cette règle cesse-t-elle d'être valable quand il s'agit du gouvernement ? Si vraiment l'Union française nous est dictée par la vertu, écoutons la vertu, et résignons-nous à demeurer incompris, ou à rencontrer l'ingratitude. Sinon... Sinon vous finirez bien par découvrir une idée de l'État transcendant à la morale, qui nous rappellera des choses. Et alors, je vous le demande, que reprochez-vous à Pierre, à Paul, à Joseph et à Samuel ? Et surtout. où est votre Démocratie ?
Pour ne pas être dupe, il suffit de poser ce principe : on perd toujours, et à coup sûr, à jouer la justice contre le crime, la générosité contre l'âpreté, la clémence contre la haine. Pas d'illusion là dessus. Maintenant moi je vous dis : si nous ne croyons pas un peu à ce gain contenu dans cette perte, à ce gain invisible et sans poids en face de cette perte concrète et parfois redoutable, au nom de quoi parlons-nous ? D'où tirons-nous cette présomption, cette folie de discuter les choses, et de juger les hommes ? Si nous ne sommes pas des enfants, si on ne nous la fait pas, si nous savons faire la part des choses et tout sacrifier à l'efficacité, ça va bien : rentrons dans la ronde, avec les S.S., les maurrassiens et les Hottentots, on aura de quoi causer ensemble !
Je sais tout ce que cette attitude blesse en nous : je sais que J.D. une fois de plus, me reprochera de chanter tout seul, tandis que lui prépare le monde futur. Et s'il m'accorde son dégoût de certains moyens, il voit sa grandeur à les accepter comme prix de ce monde. Et c'est cette imposture qui m'arrête : d'un côté on condamnera le but de celui-ci, en arguant de ses méthodes inacceptables. De l'autre, on justifiera les mêmes méthodes, au nom d'un autre but. Si bien qu'au fond de tous les choix, il n'y a rien d'autre qu'un acte de foi, quand ce n'est pas un pari. Et nous n'aurions rien à dire là contre, n'était ce tour de passe-passe par lequel on oppose arbitrairement les méthodes et le but, le contenu et le contenant, pour recouvrir sa foi d'un survêtement de bonne conscience. Les fascistes étaient très forts à ce jeu : le fasciste n'admettait pas la discussion des buts du communisme, because massacres d'innocents, Bela Kun, carmélites déterrées et ghetto entre les dents. Maintenant, si vous lui opposiez les camps de concentration, il y voyait une condition regrettable, mais inévitable, de l'évolution vers la Pax Fascista, et trouvait le rachat de ceux-là dans celle-ci. A l'époque, les victimes de ce raisonnement en éprouvaient sur-le-champ l'extravagance. Il semble que certaines en aient perdu le souvenir.
On l'a bien vu lors du procès Masuy. Quand Rémy se demande sérieusement si Masuy a outrepassé les règles du contre-espionnage, on reste rêveur : où est la limite ? Est-ce que le premier coup de poing à un prisonnier ne contient pas déjà toutes les tortures de la Gestapo ? Mais quand la presse qui n'est pas dans le coup, qui n'est ni Rémy, ni Masuy, en profite pour piquer sa crise de pureté et se demander comment au jour d'aujourd'hui de telles horreurs sont-elles Dieu possible, alors non ! La police est la police, le contre espionnage, une police aggravée de politique, et pour ma part je verrais volontiers en jugement tous les auteurs de tortures, quel que fût leur drapeau. Mais puisqu'il n'en est pas question, qu'on nous épargne les vertus outragées. Un des fruits amers des récoltes de la guerre, c'est que sur le plan des méthodes tout le monde se tient, et que, comme chantait Suzy Solidor à un mot près, si tous les bourreaux du monde voulaient se donner la main, on pourrait faire une ronde, et ainsi de suite. Ce qui me frappe le plus dans le livre de David Rousset, c'est de le recouper avec les récits de camarades qui ont connu le simple camp de prisonniers, le camp de concentration « sans mort » (Gurs ou bien les camps espagnols, Miranda, etc.) ou l'internement en Suisse, et d'y découvrir, derrière une sécurité apparente, les mêmes mécanismes humains. La même géographie y régit le chef de camp, le représentant de l'autorité, et surtout le concentrationnaire à qui l'autorité délègue une part de son pouvoir. Et cela condamne la notion tranquillisante d'une responsabilité à sens unique. Celui qui fait une bassesse pour obtenir un léger avantage sur ses co-détenus est déjà un kapo. Et celui qui lève la main sur un prisonnier est déjà un S.S. Les bonnes gens s'imaginent que le S.S. pousse comme une mauvaise herbe, ou qu'on le fabrique à la chaîne. Qu'ils s'interrogent, et ils trouveront que les S.S. ont été lâchés parmi nous comme des ilotes tragiques pour nous enseigner ce que nous pouvons contenir. C'est peut-être en chacun de nous que le S.S. sommeille. A côté du cochon. Et ils doivent faire bon ménage.
Et tout cela se tient. On commence par rêver d'une efficacité propre, parce qu'on croit vouloir le bien, et qu'on n'est pas méchant. Et puis chaque jour nous enseigne que la propreté est inefficace. Alors on laisse tomber la propreté, et quelqu'un s'éveille en nous, qui y prend goût, qui se satisfait de cette caution que nous lui donnons en gardant les yeux sur le but, qui est toujours pur. Nous sommes des voyageurs qui s'embarquent en compagnie de bourreaux. Et le bourreau volontaire est pire que le bourreau-fonctionnaire. Je me souviens d'un camarade des F.F.I., engagé comme chauffeur au 2e Bureau. Son office consistait, en dehors des travaux ordinaires du chauffeur, à « donner la main » aux interrogatoires. Ce don de la main s'exerçait, entre autres, dans des bains de vapeur où lui et ses copains replongeaient à coups de poing le « prévenu » jusqu'à ce qu'il étouffe ou qu'il l'ouvre. Il était ravi, le gars. Il me racontait ça avec fierté, et une conscience toute tranquille. Dame, c'étaient « des salauds ». Et en effet, c'étaient peut-être des salauds. Seulement, à certains signes, on voyait qu'il aimait ça, qu'il y prenait goût, qu'il s'accommoderait toujours de la définition du salaud pour se livrer à son petit passe-temps. Et c'est un fait d'expérience : on ne peut pas frapper un homme attaché sans aimer ça. Et ce qui compte ici pour moi, ce n'est pas l'homme frappé, qui le « mérite » peut-être (cette vague notion de mérite peut recouvrir ce que l'on veut, et sur un certain plan tout le monde peut « mériter » la pendaison. La dame qui dit au petit garçon qui fait de l'équilibre à la fenêtre : « Tu mériterais de tomber » n'éprouve pas le besoin de le pousser), mais à celui qui frappe, à qui, si je reconnais l'efficacité de sa méthode, je donne un blanc-seing qui me fait son complice. Quand je dis que nous nous embarquons avec des bourreaux, ce n'est pas une figure de style. Et le plus grave, c'est que des siècles d'histoire nous enseignent qu'en telles aventures, ce sont toujours les bourreaux qui pèsent, en fin de compte, le plus lourd.
On n'est pas très fier de penser qu'au bout de ces grandes poussées révolutionnaires, tout ce qui montre un peu de générosité est élagué comme romantique, et qu'on parvient à un monde peut-être plus viable que celui de nos rêves, mais où tout ce qui donnait à la vie ses couleurs est tombé au nom de la tactique, du réalisme et de l'efficacité. Nous entrevoyons déjà ce monde, qui porte trop d'espoirs pour qu'on le combattre, et pourtant avoue déjà les immenses déceptions qu'il contient, l'espèce de fourmi qu'il substituera à l'homme. Alors peut-être d'autres hommes s'apercevront de leur mutilation. Ils prêcheront quelque temps sans succès un homme nouveau, libre et progressiste. Et puis, quand ils sentiront un bon vent historique, ils se mettront en marche sur le terrain de l'efficacité, lâchant à chaque étape un peu de ce qui rendait leur message unique. Ensuite ils remporteront sans doute une victoire. Il est dur de renoncer aux victoires, Pour d'autres, en face de leur prix, il est dur de s'y résigner.
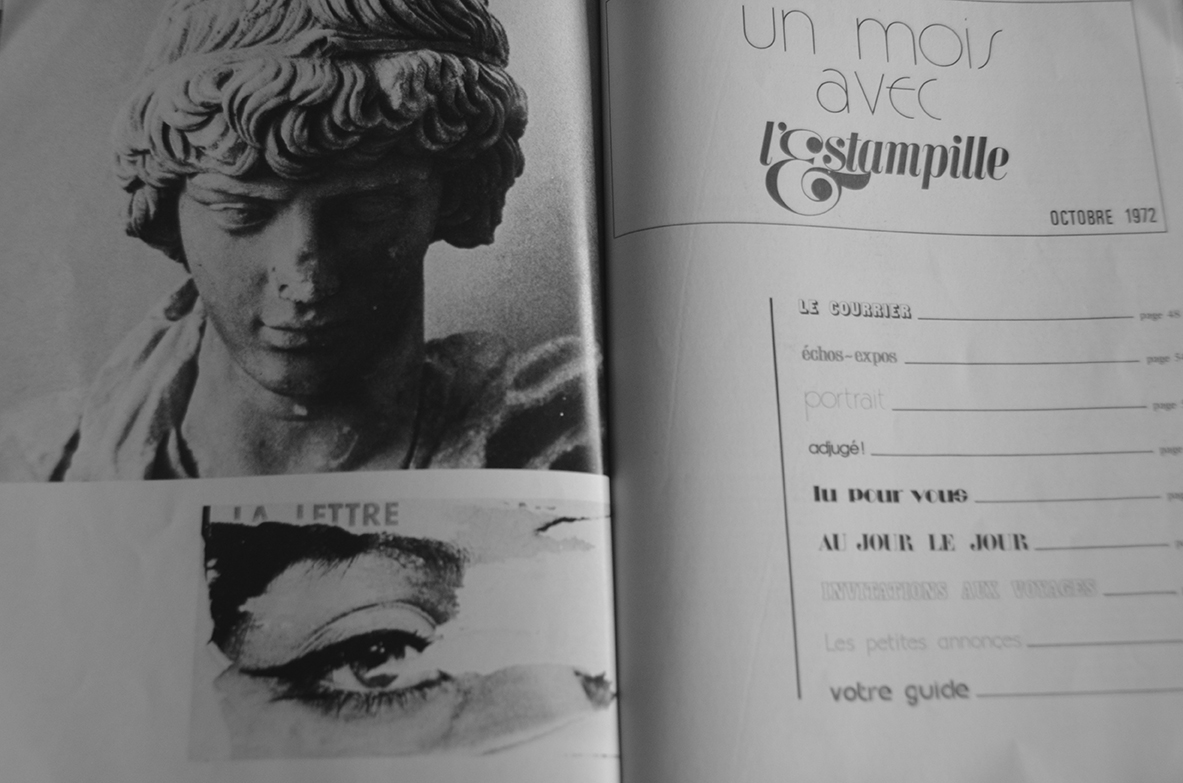
C'est pour m'excuser auprès du légitime possesseur de cette rubrique, qui cache sous les initiales H. Q. un des plus grands noms de France, que j'emprunte cette citation, devenue proverbiale (et qui se dit, comme chacun sait, de qui va empiéter sur un domaine qui n'est pas le sien), au vieil auteur germain Joseph von der Geist. Car il s'agit de la vie quotidienne, et il s'agit de l'Allemagne.
Allemagne occupée. Vie quotidienne. Pigeon vole. A mesure que l'occupation est plus dense, la vie est moins quotidienne, le pigeon ne vole plus. Quelles que soient ses vertus, la présence de l'occupant stérilise, pèse, ralentit, embrume, dément son intention : on ne guérit pas un malade par vivisection. La présence de l'observateur fausse l'objet de son observation. De même qu'à une certaine profondeur l'introspection ne découvre qu'elle-même, ici l'occupation ne maîtrise que soi. Au delà est l'Allemagne, la vérité de l'Allemagne, aussi lointaine, aussi insaisissable que jamais. Aussi impossible à contenir que cette eau bleue du paysage allemand, du regard allemand, cette vitre peinte qui n'ouvre que sur des nuées. Nous avons beau être là, questionner, remarquer, organiser, nous n'avons pas encore le mot de cette conjuration nocturne qui donne à volonté la guerre et la poésie. La vie quotidienne, pour autant que cela désigne un rythme de vie proche du nôtre, on la trouve hors des villes, quand se taillent les vignes, quand les files d'écoliers conduits par des prêtres qui ressemblent tous à don Bazile imitent le cri du loup au passage des voitures françaises ; quand les prisonniers évadés, conduits sûrement depuis la France par des flèches numérotées sur les murs, retrouvent leur terre, tandis que des colonels égarés faute de signalisation et à court d'essence passent la nuit dans leur auto ; quand Martin Heidegger, dans une cabane de berger pleine d'images pieuses, retrouve le mode de vie des anachorètes, acceptant les présents de ses admirateurs et substituant aux entretiens avec les bêtes une correspondance non moins miraculeuse avec les philosophes du monde entier ; quand le garçon de quatorze ans, qui avait conservé du Landsturm une carabine sans cartouches est condamné, après une paternelle semonce, à demeurer en prison jusqu'à sa majorité. Pigeon vole. A mesure qu'on se rapproche des villes, le rythme se ralentit, la vie devient hebdomadaire, voire mensuelle. Pigeon marche. Les petites bourgades aux volets clos s'éveillent quand le gouverneur de passage vient boire, après mille autorités qui se suivent et ne se ressemblent pas, le verre de vin symbolique que l'empereur inaugura ; quand les habitants de Tübingen vont déposer sur l'autel d'une chapelle princière des choux-fleurs votifs ; quand une troupe d'étudiants, pelant des pommes de terre dans une auberge de jeunesse, affirme durant quarante minutes, sur le mode majeur, et à trois voix, afin que nul doute ne subsiste, que si la chatte était une poule elle pondrait des oeufs. Et puis les villes deviennent des villes, les soldats sont là, les vitrines sont vides, au milieu d'un cadre de planches un éléphant de bois découpé témoigne seul en faveur d'un meilleur monde possible, la faim dispose ses pièges, le rythme se ralentit encore, le temps n'a presque plus d'importance. Toute la zone est comme une roue, dont la vitesse diminue à mesure qu'on s'approche du centre. Et bientôt nous sommes au centré même, au point le plus précis du centre, où tout mouvement s'arrête, où clignotent pour l'éternité mille signaux immobiles, où règne l'enchantement d'Armide, où brille le soleil de Josué, nous sommes au nombril de ce monde, mais un nombril doué d'entendement, qui se contemple lui-même et se perd dans cette contemplation. Nous sommes à Shangri-Lassitude. Nous sommes à Vichy-sur-Alliés. Nous sommes à Baden-Baden. Pigeon dort.
Nous déambulons à travers cette casbah militaire, écoutant vaguement Scapin se plaindre des façons de Réquisimandre, coupable d'avoir employé le premier des procédés que lui, Scapin, se réservait d'habitude. C'est d'ailleurs dans ce pays un tic, une coutume quasi folklorique, de débiner les confrères. A l'heure où les anciens des villages et les pères de famille protestants puisent dans les contes ou dans la Bible un récit propre à édifier leur descendance,. il n'est pas un fonctionnaire de Baden qui ne dise du mal de son prochain, en de longues sagas, où Vichy, la DGER ou le spectre du bolchevisme endossent la paternité d'un fatum saboteur. « Gardez-vous de celui-ci, nous dit-on, il sort de la ze DB, c'est tout dire » et le geste d'exorcisme qui l'accompagne ferait croire sans peine aux ignorants que la 2e DB était une annexe de la Milice. « Palissandre, nous affirme cet autre, parle couramment le russe, et reçoit tous les jours Franc-Tireur. Il est donc bien ici pour nous noyauter au profit du marxisme international. « Laissons-les à leurs plaintes, et jouons plutôt au tennis-colonel. Mais en peu de temps nous voilà débordés, les points s'accumulent, et nous quittons cela pour admirer en paix les beaux officiers de la Démocratie. Quelles belles badines, quelles bonnes babines, ah mais surtout, comme dirait Paulhan, quels magnifiques uniformes ! « Qu'est-ce qu'un uniforme ? demande Euthime. - Un costume militaire qui ne ressemble à aucun autre. » Admirons comme cette veste américaine couleur prune s'accorde bien avec le golf des chantiers de jeunesse teint en brun, tandis que son pantalon lilas est allé s'accoupler au battle-dress anglais retaillé par notre Intendance. Et comment ce dolman un peu râpé, orné d'une seule croix de guerre à plusieurs palmes, tiendrait-il auprès de la tenue d'été de ce jeune assimilé, que rehaussent les rubans (faciles à se procurer, mais il fallait y penser) du Grand Dragon d'Annam, du Nichatn Alaouite et de la Croix-Rouge Française ? Il faut avouer que les assimilés ne le cèdent en rien aux militaires de carrière, et ne quittent je ne sais quel air de sérénité martiale que pour un farouche et indomptable regard de chef trahi par le sort, lorsqu'un soldat rencontré les a fait se ressouvenir qu'ils n'ont point droit au salut. A leurs épaules s'étalent ces courtes pyramides rognées, les clous ornementaux dont ils partagent l'emploi avec les ceintures de cow-boys et les bahuts bretons. La légende locale veut que le général Koening ayant répondu : « Des clous ! » à qui lui proposait de conserver les galons réglementaires aux assimilés, une interprétation trop littérale du sténotype ait été à l'origine de la chose. Au centre de Baden, face au Stéphanie (ce qui veut dire en allemand : « Hôtel du Parc et Majestic »), une étrange machine nous arrête. On dirait une excavatrice, de grands bras immobiles pendent, armés de crochets, cela tient de la grue et de la bête, c'est un robot de dinosaure... Scapin tente de nous abuser en parlant de travaux en cours, mais nous avons compris : nous avons devant nous la fameuse, l'unique machine à décerveler, celle qui fonctionne le dimanche avec des balançoires et des marchands de coco tout autour. Scapin inquiet parle toujours, tente de nous distraire de ce symbole en nous soumettant d'autres équivalences : un journal allemand annonce que les fonctionnaires du Ravitaillement seront pesés périodiquement après leur entrée en fonction. Les fêtes de la Passion à Oberammergau n'auront pas lieu cette année, car tous les personnages avaient adhéré au parti nazi, sauf Judas… Les sports de combat sont interdits sur toute l'étendue de la zone, afin de ne pas développer dans la jeunesse le pouvoir d'agressivité. Les livres ou apparaît la Gestapo ne seront plus diffusés, pour ne pas remuer des souvenirs trop proches. Heureux Allemands, qui après douze ans d'hitlérisme et six ans de guerre, ignoreront tout de l'agressivité et de la Gestapo... Tandis que la nuit tombe, et regroupe fraternellement militaires et assimilés, machine à décerveler et grands hôtels (ceux-ci, tout blancs et pleins de fenêtres ouvertes, comme de grands frigidaires percés où se corrompt notre victoire) nous déambulons, écoutant vaguement Scapin se plaindre de la politique internationale. Il s'indigne de la présence des communistes dans tous les gouvernements à l'Est du rideau de fer. Mais soudain il s'aperçoit qu'à l'Ouest, par contre, ils ont été aussi unilatéralement débarqués. Alors il se réconforte. « Il y a tout de même une liberté pour quelques-uns » dit-il, et il se dirige d'un pas plus ferme vers les fructueuses opérations que sa fonction lui permet, et que sa position lui commande. Nous ne resterons qu'une nuit à Baden, le temps d'enrichir notre scandalothèque de quelques récits édifiants. Puis nous finirons notre tour de la zone à toute allure, comme des personnages de Jules Verne, minutant les itinéraires, nous promettant des primes imaginaires. Nous fanchirons le lac de Constance sur un bateau à aubes en tous points semblable à ceux du lac Baïkal, tels que nous les avons connus à dix ans. Nous y trouverons un merveilleux personnage, Allemand antinazi exilé depuis longtemps, doux et amer, pacifiste et combattif, désenchanté et entreprenant, revenu ici parce que rien ne lui paraît plus urgent que d'enseigner Antigone aux jeunes filles du lycée. A Fribourg, nous aurons le souffle coupé par une fille à bottes et à cravache, à la porte d'un cinéma, dont le regard et le corps, et surtout les bottes, nous aimanteraient à coup sûr si elle n'était visiblement une de ces mines vénériennes à retardement que l'armée vaincue a laissées en arrière, pour être vengée au hasard. Nous assisterons à des conférences, à des concerts, à des inaugurations, à des consécrations, nous assisterons à ce spectacle déconcertant d'une foule allemande qui applaudit de la même façon à l'admirable interprétation d'une cantate de Bach, qu'à une fête de jeunesse où l'on braille en choeur les vertus des sapins de la Forêt-Noire, qui écoute de la même façon les discours de louanges à la démocratie que... Non, il n'y a pas de discours contraires. Pas encore. Mais de même que l'on s'aperçoit, après un premier réflexe d'admiration pour son goût musical, que cette foule est plus sensible au seul fait du chant, qu'à sa couleur et son contenu, de même on comprend que son attention va au ton du discours, et non à sa signification. Et le ton est toujours le même, les paroles de paix tombent comme des imprécations, le bourgmestre ou l'instituteur qui représente l'Autorité en ces lieux vous ordonne d'être des hommes libres... En face, des rangs de jeunes garçons et de jeunes filles, sept cents fois le même regard clair et dépoli, à travers quoi le discours filtre sans rien déposer, que son rythme familier. Étonnante faculté d'intégration et d'oubli, étonnante absence de révolte. La pensée comme la musique s'y absorbe, s'y dissout, s'y élimine. Comme on laisse une carotte au fond des pots à tabac pour y assumer toute l'humidité, ces esprits recèlent dans un coin une éponge de brume, où vont se défaire toutes les émotions, toutes les inquiétudes. Et c'est pourquoi les universités populaires préfèrent enseigner l'astronomie ou la philosophie éléatique, que l'économie ou que l'histoire. Et c'est pourquoi ceux que nous interrogeons préfèrent la métaphysique à la politique. Comme ces êtres invisibles de la légende, qu'il fallait sans cesse tenir à la main pour les empêcher de disparaître dans la nature, ils ont à leur portée un domaine nuageux, où se dérober sitôt qu'une main ferme ne les conduit plus. Comment les en délivrer ? Peut-être en les forçant à exprimer leurs mythes, à les alourdir d'un poids de chair, à leur faire livrer leurs correspondances de geste et de parole - en favorisant la naissance d'un style dramatique, d'un style pictural, d'un langage... C'est en méditant ces vues de l'esprit, bien dignes de la pitié des spécialistes et des réalistes, que nous nous apercevons soudain qu'autour de nous les chats miaulent en français...

Le vendredi 4 juillet 1947, tous les journaux ont publié un état récapitulatif du complot des cagoules (lequel, s'ajoutant au complot des soutanes et précédant de peu le complot des sandales, achève de dessiner à notre horizon la silhouette bien connue des Familiers du Saint Office). Chaque accusé faisait l'objet d'un petit paragraphe, où sa situation du moment était exposée et commentée avec cette précision dans la documentation et cette objectivité dans les conclusions dont s'honore à juste titre la presse française.
Et voilà ce que ça donne, en ce qui concerne Max Vignon :
FRANC-TIREUR. - « Il a été établi que le journaliste Max Vignon, appréhendé la veille, n'a aucun lien avec le journal clandestin Le Réseau. La palice s'est en effet aperçue qu'elle avait pris un Vignon pour un autre. L'autre, c'est Pascal Vignon, ancien milicien, animateur du Réseau ; c'est celui que l'on recherche. Max, lui, résistant depuis septembre 40 au réseau Georges-France, ex-directeur politique de XXe siècle, fondateur d'un journal clandestin sous l'occupation, a été rapidement remis en liberté par le juge.
L'HUMANITÉ. - « Les renseignements généraux ont interrogé Max Vignon. Et l'ancien collaborateur de Radio-Paris a eu l'audace d'exhiber une attestation de « résistance » signée du lieutenant-colonel Josset du service des Renseignements des Forces Françaises Combattantes. Décidément, certains officiers supérieurs de l'entourage de de Gaulle utilisent tous les moyens pour sauver leurs amis compromis dans le complot de la Cagoule... Toujours est-il que Je juge d'instruction Lévy n'a pas hésité à le mettre en liberté provisoire. N'avait-il pas promis récemment pourtant que les cagoulards seraient châtiés ? "
L'ÉPOQUE. - « Après avoir été entendu par M. Robert Lévy, juge d'instruction, M. Max Vignon, ex-directeur politique de l'hebdomadaire XXe siècle, a été remis en liberté. « Je n'ai, a-t-il dit, aucune déclaration à faire, en raison du caractère secret de l'instruction. Je puis toutefois préciser qu'une enquête minutieuse a établi qu'un individu s'était servi de mon nom dans une affaire délictueuse. »
Comme disait notre grand camarade Pascal, tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne peuvent se tenir à un journal.
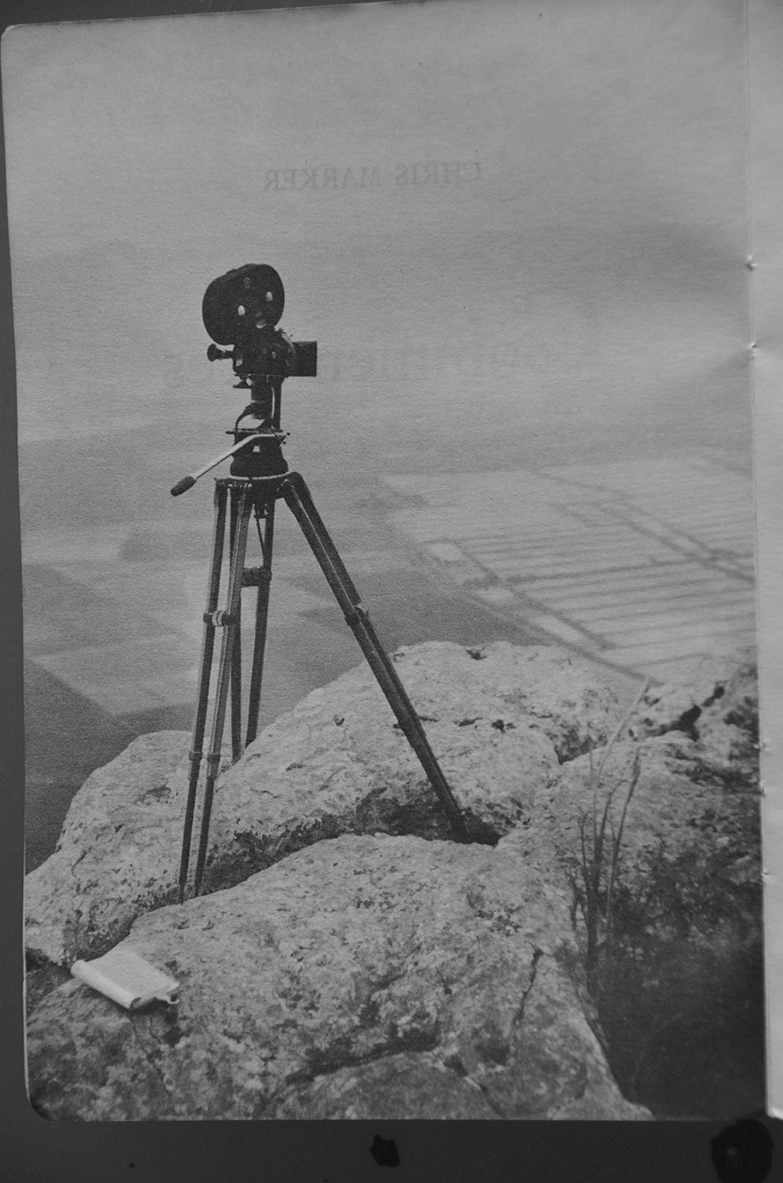
Une facétie, que l'on attribuait à un professeur d'histoire, courait, vers 1930, les lycées parisiens : « Mis au pied du mur, Alexandre recula... » Notre vie quotidienne accomplit tous les jours de ces ridicules prouesses. On l'épuise, on la bouscule, on la tenaille, on la ratatine... elle refuse de crever ! Sans cesse de miraculeuses positions de repli surgissent pour elle où dormir un quart d'heure, debout, dans le fracas, et les gens s'assurent que pour rien au monde ils ne reprendront la marche et puis, quand il le faut, ils repartent tout de même...
Les vitrines continuent de s'orner des petits placards : « Baisse de 10%», «5% + 5% », « Ici, véritable baisse de 10% », etc. ; le camouflage n'aveugle personne et chacun sait que les prix montent. Que des prix montent serait exact, mais ceux qui ne montent pas regardent leurs collègues de travers et s'efforcent de monter à leur tour. (Les produits pharmaceutiques ne sont pas « à leur prix » et jalousent les denrées alimentaires.) Mardi, le 8 juillet, date fixée par le gouvernement à la hausse du timbre, une bouteille d'apéritif qui se vendait 180 francs tout le samedi 5 et encore dans la matinée du 6, mais qui avait réfléchi derrière le rideau de fer et compris son devoir, se vendait deux cent vingt francs. L'ami qui en fit l'ennuyeuse expérience voulut protester : jamais le commerçant n'avait été aussi aimable. Un flot de paroles. Il devinait, bien sûr, et il cherchait à étouffer les cris de la victime. Et ces vacances ? Et ce temps froid ? «Oui, mais... » essayait de dire le malheureux client... Peine perdue.
Le pain quotidien est un triste pain jaune, mauvais à la bouche, à l'estomac et aux intestins - nous voulons parler du pain de Paris, car le pain varie d'une province à l'autre, sinon d'un canton à l'autre. Chaque jour on devrait pouvoir dresser une carte de la consommation du pain comme on en dresse pour la prononciation du « r » ou pour l'absorption de l'alcool. Régions hachurées : majorité de pain blanc sans tickets. Pointillées : majorité de pain blanc avec tickets. Noires : pain jaune. Grises : pain gris, etc... Charmante et douloureuse variété, qui fait passer de vaines visions de blanches miches craquantes dans les yeux des gens de Ménilmuche ou de Charonne. Pour l'année 1948 on nous annonce du pain aux pommes de terre. Heureux sommes-nous que Parmentier, jadis, se soit montré persévérant. Du pain aux pommes de terre. Heureux sommes-nous, aussi, que la récolte de pommes de terre ait du moins été belle, ou nous aurions eu du pain de navets.
A défaut de pain, les « circenses » abondent puisque le Tour de France a recommencé de vivre. Les journaux ont dépêché dans son escorte la fine fleur de leurs chroniqueurs sportifs et c'est, dans toute la presse, une débauche de lyrisme pneumatique et viril, avec des « masques ravagés par l'effort » des « plans de campagne » des « hommes qui secouent l'atonie du peloton ». Chaque coureur, en attendant d'être remisé, le Tour achevé, dans ce grenier de musée provincial qui se nomme l'oubli, touche une personnalité complète de vedette populaire, au même titre qu'un acteur ... Une triste volonté d'alibi se reconnaît là-dedans. Ce n'est pas : « Ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ! » encore que cela y ressemble. « Leur pain est mauvais, collez-leur du tour de France !... « Certains journaux, autrefois, étaient renommés pour leur art de détendre les esprits agacés dans une crise ministérielle, par un beau titre : « Après avoir étranglé sa femme, il tue sa fille de trois coups de revolver et se suicide. « Tous les journaux, ou presque, suivent cette méthode et nous servent des plats de ce genre : « Après une course qui fut un miracle d'intelligence et d'énergie, X termine premier à Besançon. »
D'autres circenses individuels eussent bien intéressé les gens, nous voulons parler des vacances. Des vacances, il y en aura, et beaucoup de Français « partiront en vacances » : il n'est pas sûr que le mouvement ait l'ampleur souhaitable. Les chemins de fer ont « revu » leurs tarifs. Les villas, les pièces chez l'habitant, coûtent cher. Les hôtels raisonnables risquent, deux jours après l'arrivée, de se transformer en hôtels déraisonnables et qui ne peuvent s'en tirer s'ils ne reviennent pas sur leurs premiers prix. Les gens y regardent à deux fois. Ils casent très souvent leurs enfants dans des colonies de vacances et eux, ils se débrouillent. Par exemple, ils restent sur place à ranger la maison.
La crise des loyers dure toujours. Elle a la peau dure, et, par deux fois, on avait annoncé sa mort. Le traitement auquel échappent les fruits et les étoffes, les viandes et les produits d'entretien, les logements ne sauraient y couper : ils restent au même prix. En théorie ! Car un principe économique familier intervient ici : ce qui est rare et contingenté passe au « marché noir ». Qui cherche un appartement - et qui s'appelle Légion- se heurte à un complot dans la manière d'Eugène Sue ou des films américains. Des gens à figure de messieurs et qui se nomment, et qui sont réellement, gérants d'immeubles, propriétaires, directeurs d'agences de location, lui réclament, par téléphone ou dans des pièces discrètes, des commissions qui se chiffrent par centaines de mille. Souvent le locataire est dans le coup. On s'enrichit de cette manière, pourquoi pas lui ; honni soit qui mal y pense ! Il met en avant le terme de « reprise », la réalité de quelques meubles bizarres et de tapis fantastiques et, avec flegme, il réclame une somme gigantesque...
Les gangs pullulent, et dans tous les domaines. Heureusement, si, à part chez les techniciens de la police, il n'existe pas de contregangs, l'entr'aide joue en France un rôle très important. Naturellement la vertu n'y explique pas tout ou, du moins, elle s'y associe à l'intérêt (dans les gangs eux-mêmes on voit agir l'entr'aide) et il arrive que des bourgeois sans enfants prennent comme bonnes des filles-mères, accompagnées de leurs gosses, car elles peuvent mieux protéger l'appartement contre une réquisition de pièces particulières. Et ainsi de suite. L'entr'aide qui ne poursuit nulle autre fin que l'accomplissement d'un devoir, ou le respect d'une loi naturelle, existe aussi. D'un côté les Français vivent selon les lois de la jungle, la fortune est à qui se débrouillera, plutôt marcher sur la tête d'un ami que d'échouer dans un dessein, d'un autre côté notre époque a bien lieu sous le signe du dévouement. Devant certains spectacles, et quand on connaît la gêne financière où se trouvent tant de Français, on pense, comme devant une affiche de parti, « d'où vient l'argent » ? La ruée sur les homards, dans les marchés populaires ; le chiffre-record des départs ea vacance,; au moment de la Pentecôte ... De nombreuses raisons peuvent être invoquées. Parmi les Français qui dépensent, les petits commerçants, qui souvent ne paient pas de mine, forment une minorité qui compte. Par ailleurs, les gens n'épargnent plus. Ils vivent comme ils mangent, c'est-à-dire au jour le jour. Je viens de voir un calicot: «Souscrivez à l'emprunt " attirer les quolibets de la foule dans un bureau de poste. Oh, évidemment, chacun sait que la monnaie ne tient plus le coup, mais il s'agit d'un autre phénomène : comment ? on a déjà tant de peine à se nourrir et on irait encore prêter de l'argent à l'État ? Pour une bonne plaisanterie, c'est une bonne plaisanterie !... Quoi qu'il en soit, le dévouement explique bien aussi, dans une certaine mesure, l'impression d'aisance relative que les Français donnent parfois. A l'intérieur des familles, les éléments qui s'estiment favorisés secourent les autres. Les jeunes assurent des pensions aux vieux qui n'en peuvent plus. Le frère muni d'un bon poste donne un coup d'épaule au cadet qui n'a pas la même chance. Jamais il n'y a eu autant de voleurs, dit-on. II ne serait pas moins juste de dire, alors, que jamais l'entr'aide ne se manifesta d'une manière à la fois aussi discrète ni aussi effective. Notre société suggère pêle-mêle une foire d'empoigne et une « Veillée des Chaumières ». Un sentimentalisme - qui ne craint même pas d'aboutir à la niaiserie - fleurit en même temps qu'une brutalité, un réalisme tenaces.
Grâce à de tels piliers, les gens résistent. Les prix montent, les salauds remportent des victoires, les journaux parlent de guerre, de grèves, de restrictions, de pain aux pommes de terre et de vin ordinaire à 6o francs le litre pour le mois d'octobre ; entre temps de nouveaux asiles de calme sont découverts, accomplis de nouveaux actes de charité. La vie à la petite semaine, au jour le jour, est peut-être la fidèle destinée de l'homme. Ce sont les ministères des Finances qui ont créé les comptes à l'année. Il est question de rétablir les maisons closes et, dans le métro, les wagons de « Première ». Encore des paroles qui s'en seront allées au fil de l'eau. La vie quotidienne reprend son havresac et cherche sa route entre les fondrières, engueulée par des gendarmes qui la suspectent, quand elle perd ses papiers, de les avoir volés, guidée par les Syndicats qui la freinent quand elle veut courir et la bousculent quand elle veut dormir, matraquée par le bâton blanc des règlements, exaltée par les journaux - qui ne font rien d'autre que de brouiller les cartes et de lui réclamer quatre francs - et, en définitive, elle trouve d'abord ses ressources en elle-même, dans des souvenirs, des illusions, l'instinct du bricolage, l'accoutumance à la poisse et même l'amour du travail.
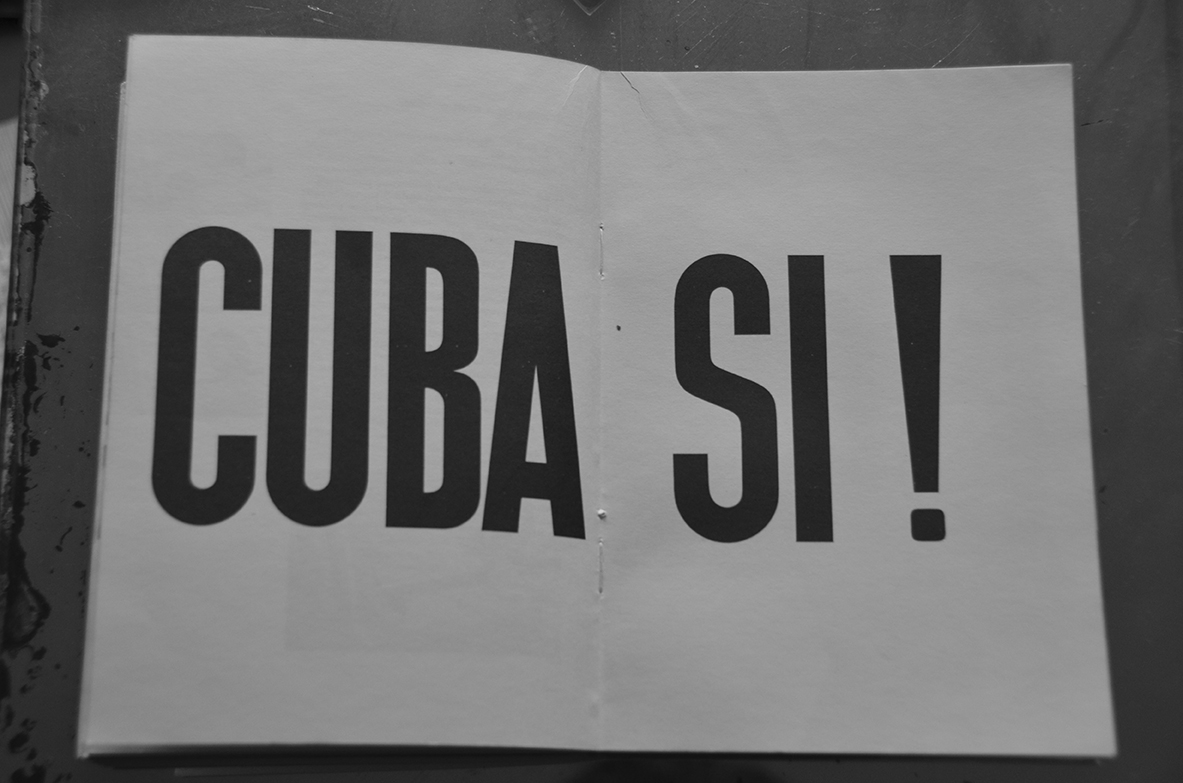
La réception du général de Gaulle à l'Académie Française, dans le fauteuil laissé par Philippe Pétain, avait rassemblé force pékins aux alentours du quai Conti, par ce phénomène de plus en plus courant parmi les classes dirigeantes, qu'en termes d'école on nomme maintenant le gallotropisme. Le chroniqueur mondain d'Esprit eut toutes les peines du monde à pénétrer dans l'enceinte bruyante où la semaine précédente, caché dans une cagoule en forme de housse, il avait pu surprendre les préparatifs de la cérémonie. On se souvient en effet que c'est au tout dernier moment, alors que l'élection semblait assurée pour M. Jean Rivain, comte du Pape, que le général de Gaulle fit brusquement acte de candidature, et prévint par la voix des ondes ses futurs collègues qu'il leur adressait le même jour une visite collective afin de préserver tout à la fois la fidélité aux usages et l'économie de son temps. Une visite de général ne saurait être qu'une inspection. Aussi l'émotion fut-elle grande parmi les académiciens, qui coururent à leur poste au moyen d'une voiture de pompiers bienheureusement disponible, tandis que l'un des derniers élus, M. Gustave Thibon, grimpant à la grande échelle, sonnait le rassemblement sur une petite trompette de fer-blanc. A l'Académie elle-même, ils entreprirent de savonner le plancher et de passer les murs à la chaux, après quoi, les chaussures cirées, chacun se tint immobile à sa place, son paquetage littéraire bien en ordre devant lui, tandis que M. Georges Duhamel, secrétaire perpétuel, allait et venait nerveusement, comptant et recomptant les boutons de guêtres. Puis le général entra, salua, et passa rapidement entre les rangs d'un air impénétrable. Devant M. François Mauriac, il s'arrêta « Où t'ai-je vu, toi ? » dit-il en lui pinçant familièrement l'oreille. « La soupe est bonne » ajouta-t-il après un coup d'oeil au dictionnaire, disposé tout exprès pour qu'il pût y goûter. Après quoi eut lieu la répétition de la cérémonie, sa mise au point avant que de la livrer au public : ce qu'au théâtre on nomme précisément une générale.
Le discours de bienvenue semblait revenir de droit à M. Marcel Pagnol, auteur de César. Toutefois, on jugea que son immortalité trop récente ne lui permettrait pas de dégager avec suffisamment de rigueur la position profonde de l'Académie vis-à-vis du nouvel élu. Et l'on demanda au doyen d'âge, Me Pédoncule, de définir cette position, ce qu'il fit avec autant de bonhomie que de brillant :
« Souvenez-vous, monsieur, dit-il, que nous n'accueillons point en vous l'homme public, non plus que le symbole d'une Résistance dont les échos n'ont guère traversé ces murs, mais le chef d'une armée glorieuse, le rejeton d'une bonne famille, et plus encore que tout cela l'homme qui a déclaré se retirer du forum ; rien en effet ne pouvait s'accorder mieux au sens même de notre Compagnie, que cette décision. Entrer ici, c'est renoncer au monde. Nous sommes les grands retraités de l'histoire. Cette ascèse que les Hindous accordent à leurs édiles, l'âge venu, ce droit qu'ils ont de s'en aller vivre en ermites parmi les bêtes sauvages et les oboles du peuple, la France en offre à ses fils les plus méritoires, une république adoucie par son génie, où les bêtes dévorantes cèdent la place au public lettré, et les oboles incertaines à la libéralité de l'État... Ainsi, dans cette salle d'attente de l'Éternité, l'académicien, tournant le dos au tumulte de la place publique, se consacre, par le truchement du Dictionnaire, à cette juste désignation des choses dont Platon faisait la suprême définition de la Vertu. Ne vous étonnez donc point, monsieur, de trouver ici tant d'écrivains épuisés, tant de prélats canoniques, tant de penseurs inoffensifs, tant d'historiens illisibles : c'est que notre but est de réunir des personnalités désormais à l'abri de toute tentation, qui sous l'effet de l'âge, de la maladie ou d'un tempérament particulièrement débonnaire, sont comme anesthésiées et, si je puis dire, désamorcées. Et c'est le bon sens même : ne sommes-nous pas un Musée ? Ne sommes-nous pas le section vivante de ce Musée de l'Homme que baigne le même fleuve un peu plus tôt que nous ? Et ne serait-ce pas une grande imprudence, par exemple, qu'un Musée de l'Armée où les bombes seraient exposées avec leurs détonateurs, et les obus avec leurs fusées ? »
Des applaudissements nourris (bien nourris) récompensèrent l'orateur, qui rentra dans le rang pour écouter à son tour le général de Gaulle, dont la première tâche, redoutable, allait être l'éloge de son prédécesseur :
« Le fauteuil
de Philippe Pétain,
commença-t-il,
Nous ne cacherons
point qu'il a toujours
été
Notre but.
Le sens même de
Notre
destinée
semble être
de Nous
faire asseoir
à sa place
dès q..t'il vient de la
quitter.
Qu'il s'agisse de son
fauteuil
à l'Académie,
qu'il s'agisse
de son siège
au char de l'État,
de son poste
de chef
suprême
des armées
ou de cette place plus
subtile
qu'il occupa
dans les consciences
bourgeoises
de ce pays,
c'est à Nous
et à Nous seul
qu'il appartient
de le relever.
Certains même,
ajouta en souriant : le
général,
prétendent
que la place qu'il
occupe actuellement
Nous est
d'ores et déjà
réservée... »
Un murmure courut dans l'assemblée à ces paroles, qui se résolut en applaudissements, dominés par la voix d'une dame : « Non, jamais, plutôt mourir ! »
« Que si,
poursuivit le général
d'aucuns s'étonnent
de cette parenté
après nos luttes,
Nous leur répondrons :
ne pouvons-nous être
proches
par la substance, et
irrémédiablement
séparés,
comme les deux faces
d'une
médaille ?
L'un de vous,
Messieurs,
au moins
ne s'y est pas trompé.
C'est Notre
éminent
collègue
Paul
Claudel,
qui nous a célébrés
l'un et l'autre
successivement
et dans des termes
presque
identiques. »
M. Paul Claudel, qui jusqu'alors avait semblé sommeiller, se redressa avec un sourire aimable...
[Notre typographe, haletant et pris d'un douloureux va-et-vient des deux pupilles, nous demande de poursuivre sa composition sans plus de typographie rythmique. Soucieux de rassemblement, nous l'y autorisons bien volontiers.]
« Et il ne fallait pas s'y tromper, » reprit le général en étendant les bras d'un geste qui lui est familier, et qui est celui-là même du prêtre annonçant que la Messe est dite, « car s'il existe un écart entre nous, s'il existe un écart entre l'appel à la révolte et le maintien de l'Ordre, entre l'exaltation du peuple français et l'encasernement des masses, entre le règne de l'argent et le rétablissement de la chrétienté, cet écart nous unit plus qu'il ne nous sépare, puisqu'il mesure aussi bien la distance entre nos principes et nos actes. C'est la distance même de l'Église à la Communauté, de l'État à la Nation. Et cet écart se résout dans une prise de conscience plus vieille que nous, vieille comme notre foi, vieille comme notre terre, telle qu'elle se résume en ce beau mot français de Contradiction, qui sonne haut et clair, et que des intellectuels fumeux au service d'une idéologie étrangère ont déshonoré sous le nom de Dialectique. »
I
(Fragment)
Cette rôdeuse nuit qui parle de victoire
Cette chanteuse nue en robe de saison
Cet éclat des écueils dans la tourbe des rêves
Cette frôleuse nuit qui parle de retour
Ne l'écoute pas sentinelle
Ne l'écoute pas
Si par hasard tu l'écoutais
prends garde de ne pas comprendre
Si malgré toi tu comprenais
feins de ne pas pouvoir répondre
Si jamais tu lui répondais
alors garde-toi de la suivre
Et si un jour tu la suivais
ne reviens jamais parmi nous
Va z1ers les hommes ennemis
ton coeur arraché dans la main
Donne-leur comme un fruit tombé
ton coeur arraché par ta main
Ou lance-leur comme une pierre
ton coeur arraché de ta main
Ou remets-le dans ta blessure
Caillou de la route
lié au cou d'un chien abandonné ton coeur sera si lourd à ta faiblesse
que tu t'enfonceras avec lui
dans une moite et sombre gloire
Et la rôdeuse nuit chantera ta mémoire
Au fil de la montagne
la peur monte
vêtue en pauvresse
Elle saigne dans les ravines
Elle se prend aux ronces
Elle avance à grand'peine
Loin derrière elle
des troupeaux de cuivre
courent le long du crépuscule
réveillés par l'haleine chaude
de cette heure
qui gonfle au-dessus des bassins
mille montgolfières d'argent
Au fond de la vallée sonnent les cloches de pierre
des tours s'allument
Ceux qui rentrent
s'entre-demandent
qui est cette femme
à la robe de feuilles mortes
couronnée de roses sauvages
dont le pas dans les cailloux
est comme un animal qui fouille
C'est la reine
C'est la mort
C'est madame sainte Ursule
C'est un insecte masqué
C'est une grenouille brune
C'est la soif
C'est la lune
On ne sait pas ce que c'est
Sentinelle sentinelle
à qui donc es-tu fidèle
quelle est cette bête morte
quelle est cette plainte qu' apporte
la cavalerie du soir
Le cortège s'assemble
dans ce coin de ciel en corail
Sur la peau tendue
battent des tambours funèbres
Les dragons de fumée
perchés au bout des bambous
encombrent tout l'horizon
Les cavaliers
empanachés de brouillard
lèvent des mains gantées de noir
vers les anges pressés au balcon
qui veulent hurler de peur
et ne parviennent à former
que le chant du rossignol
Les anges se pressent en grappes
à la grâce des lances
Chacun a sur la gorge
un mouchoir plein de sang
Le mal de la nuit s'étend
comme une marque de lèpre
Il prend tout le corps du ciel
qui se tord dans son armure
où la rouille découpe de grandes taches
de braise et de silence
Ne l'écoute pas sentinelle
ne l'écoute pas
N'as-tu pas au fond de ton casque
l'image d'un jardin perdu
Tandis que cette lèpre ronge
le visage blêmi du jour
n'as-tu pas dans tes mains jointes
la forme d'une fleur incrustée
plantée entre les cygnes de marbre
pour la saison d'une fille
A cette centurie de nuées
qui roule sur toi en grondant
quel nom jetteras-tu en face
Quelle branche agiteras-tu
devant ces chevaliers de givre
N'as-tu pas au fond des yeux
un jardin aux fruits de neige
enclos dans les vasques dorées
comme tm médaillon liquide
Ne l'écoute pas sentinelle
ne l'écoute pas
Penche-toi penche-toi
N'es-tu pas curieux
de savoir si ce jardin
existe encore
si ces degrés de granit
n'y descendent pas en baignant
dans une source glacée
aux fleurs étendues
où se déploie une plongeuse
claquant ses chevilles humides
sous une jupe d'eau
tandis que les esprits de la terre
frappent des tambourins en cadence
Il suffit que tu te penches
Il suffit d'un seul regard
pour savoir si tu délires
si c'est la peur qui te prend
ou si entre tes lèvres
tu sentiras couler ton nom
comme le seul fruit véritable
qu'un être au monde puisse t'offrir
Laisse-toi guider sentinelle
laisse-toi guider
et maintenant ouvre les yeux
et viens plus près
plus près encore
Au fil de la montagne descend
la peur
vêtue en reine
des lanternes de cristal
autour de son corsage blanc
les mains jointes sur des bagues
Des pointes d'or s'allument
sous la doublure de ses yeux
Elle est riche
Bientôt le sommeil et le repos
la demanderont en mariage
Elle claque des talons
en passant sur les ravines
à son doigt s'écartent les ronces
Elle a deux pierres sur les seins
toutes semblables à des yeux d'homme
La nuit pose des pas étranges
sur tous les jardins de la terre
Cette rôdeuse nuit qui parle de victoire
cette chanteuse nue en robe de velours
cet éclat des écueils dans la tourbe des rêves
cette frôleuse nuit qui parle de retour
II ( Psaume pour un camarade mort)
Toi qui ne m'entends pas Toi qui ne me vois pas
Camarade que je n'ai point connu
Toi qui as revêtu cette armure glacée pour descendre sur l'autre route
Ils disent que tu es mort
mais j'appartiens pour un temps à la saison des morts
Et c'est ta langue que je parle
et c'est toi mon plus proche ami
Pourquoi cette course dans l'aube
quelle clameur t'avait appelé
Ne voyais-tu pas ce grand mur de cristal
où tu es venu donner de la tête
A quelle rencontre allais-tu
Qui te faisait signe de l'autre côté
Pour quelle moisson de fleurs en papier
tes mains se sont-elles refermées sur l'herbe ?
On a retrouvé sur tes lèvres
la pulpe rouge des fruits de la mort
Ta place est vide et les mots qu'on te lance
vont blesser les passants comme des balles perdues
Je suis un passant - J'ai reçu des mots qui allaient à toi
J'ai bu des larmes qui tombaient sur toi
Je t'ai voilé de mon ombre
J'ai tendu mon corps entre une lumière qui t' appartenait
et le puits sans fond de ton absence
J'ai séparé ton règne du mien
J'ai borné cette mer que tu habites
En t'arrachant aux lèvres d'une vivante
je t'ai rendu ta liberté
Alors ils m'ont pris la mienne
pour que ces choses soient dites
Tu as vécu là où je vis
Tu as suivi ces routes
Le même désir a brûlé devant tes yeux
comme une colonne de flammes devant l'armée
Tu as frissonné comme un chasseur
à ce cri perdu des trains dans la vallée
Tu as trouvé dans le souffle des collines
la même odeur de cheveux dénoués
Et celui qui veille au fond de la nuit
pourrait voir nos images rejointes
Marcher du même pas en silence
dans un désert de ciment construit par la lune
Ce pas que j'entendais doubler le mien à chaque retour
était-ce là ton pas
Etaient-ce tes coups dans la citerne de pierre
qu'ils ont refermée sur toi
Clouais-tu un pont de bois creux
par-dessus les fumées inertes de la plaine
0u frappais-tu à la porte des maisons de la nuit
sans y trouver personne ?
Es-tu donc revenu de ton voyage
La terre est-elle ronde
Aussi pour les enfants des morts
et peuvent-ils en faire le tour ?
Pourtant je ne crois pas en toi
Ce sont les meurtriers qui reviennent
Je ne sais même pas si tu as combattu
ou si tu n'as existé
Que dans ces yeux gonflés comme des oiseaux à naître
qui s'ouvrent dans un écrin de larmes
Je ne sais où ton corps est mêlé
à la terre de France ou au sable de ses rêves
Qu'importe Je connais ses jambes brûlantes
et l' odeur de lait de sa bouche
Et cadavre ou image
tu ne peux que rôder comne un pauvre autour de mon repas
Mais tu ne dois pas me haïr
Nous avons communié au même sang.
Et moi je ne hais plus
Je regarde ma haine
Comme l'arme rouillée d'une autre guerre
comme la cuirasse ternie
Souvenir d'anciennes campagnes
que je ne revêtirai jamais plus
Ceux qui t'ont vaincu
se joignent à leur tour aux morts en lourdes grappes
Et moi à la limite des deux règnes
je ne me reconnais plus d'ennemis
Ceux qui sont morts dans la montagne
et les autres dans d'autres neiges
Toi qui es tombé en criant un nom
que maintenant je sais
Comme une montre brisée
qui marque pour toujours la même heure
Ceux qui se sont couchés dans la mer
et ceux qui se confondent au désert
Vous tous que nous tirons au bout de la mémoire
comme des chaloupes démarrées
Encore liés à notre garde
mais que nous ne pouvons plus entendre
Vous tous cavalerie des morts
et toi mon camarade
Je vous regarde disparaître comme un vaisseau
que je n'ai pas eu la force de prendre
Je reste dans mon île
parmi le peuple jaune
De ceux que vous avez délivrés
et qui ne vous ont pas suivis
Votre lumière coule encore sur la terre
comme une semence inutile
Il n'y a plus assez d'amour
pour une vivante et pour un mort
Mais cette vivante que tu appelais
moi aussi je l'ai perdue
Ils m'ont entouré d'un mur et toi peux-tu donc sortir ?
j'habite la maison des morts
pour un temps je suis ton compagnon de chaine
Seulement tu as perdu toutes les heures
et moi je me souviens
Mon cri va de tour en tour
il réveille les oiseaux de la peur
Et chaque femme porte un mort
qui frappe et recherche le jour.
Toi qui ne m'entends pas
Toi qui ne me vois pas
Il valait peut-être que tu meures
Que tu deviennes ce signe
cette grande découpure de fer sur notre ciel
Cette girouette au souffle de nos prières
Pour que ces choses fussent dites
Pour que nous ne connaissions pas de victoire
avant de t'avoir oublié.
(pages 1092)
(pages 882-883)
(pages 874-877)
(pages 844-847)
(pages 836-838)
(pages 824-825)
par Chris Marker
par Chris Marker
LE YOGI ET LE COMMISSAIRE
Stefan ZWEIG : Castellion contre Calvin (Grasset)
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Marker
Qui eût dit que d'un Marker à un Parker la distance fût si courte ? Depuis que j'ai lu le premier tome de ces Expériences, je ne rêve plus que d'autodafés, de cartels d'action morale, de bastonnades aux pornographes et d'amendes aux éditeurs (chacun pris par son endroit sensible). Il est vrai que mes motifs ont peu de rapports avec la morale courante, et que si je proposais aux Tartufes de l'antimillerisme de se donner le mal d'une protestation enfin justifiée contre les abîmeurs de l'amour (pas celui qu'on chante, celui qu'on fait), ils éviteraient sans doute de s'aventurer sur ce terrain glissant.
Il me reste donc à déclarer tout seul que ce livre est une ordure, une palotinerie, un gargarisme et un roman de curé : rien ne distingue cette représentation de l'amour physique de celle que pourrait se faire une bigote écoutant aux portes, si ce n'est une grimace de semi-complicité qui n'arrange nullement les choses. Rien n'y manque : le héros est un porc, entouré de porcs, tour à tour suborneur d'oies blanches, trompeur mondain, mufle à la Porto-Riche, voyeur... jusqu'à un soupçon de pédérastie glissé là sans insister, pour que la fête soit complète. Et pour justifier tout cela, le plus beau prétexte : un romancier qui cherche à se documenter « sur le vif », Le truc de l'« information scientifique » dans les librairies spéciales, quoi. Je sais bien que M. Berry déconseille la lecture de son livre aux esprits « non assez subtils pour discerner l'ironie », mais c'est précisément de cette ironie que je lui fais grief ; c'est beaucoup que 233 pages, et beaucoup de talent perdu (car il n'en manque pas, ni d'un certain sens de la drôlerie, mais tout cela est mal huilé, et ça grince). Autrement, rien, que l'impuissance, ne peut expliquer cet acharnement dans la bassesse. Bon Dieu, quand on sort de là, on a envie de crier « Vive Miller, vive Lawrence, vive Sartre » (et Dieu sait ... ). Vivent ceux qui y croient, même si c'est pour se révolter. Plutôt le blasphème que le « trait d'esprit ». Plutôt l'obscénité que cet érotisme à faux col. M. Berry fait penser à cet autre pornographe frigide, M. Jules Romains (lequel a le culot, après avoir doté ses malheureux personnages d'un Tapis Magique qui a tout l'air d'une descente de lit, de joindre sa voix académique au choeur des Ku-Klux-Kartel). A voir le petit sourire satisfait qu'arbore M. Berry au coin de sa prière d'insérer, on le devine persuadé d'être le Voltaire de l'Eros. Erreur, M. Berry, erreur : vous n'en êtes que le Homais.

Revue Esprit, juin 1947 - numéro 134
(pages 1089)
Le pain et le chien
par Chris Marker
Depuis quelques temps, je constate qu'Oxyde, le chien affectueux, honneur et délices de ma maison, se refuse obstinément à bouffer la moindre miette de pain. Avec le bel égoïsme de ma race, je m'en inquiète peu jusqu'à ce qu'un rappel involontaire m'enseigne que le chien Oxyde a cessé de toucher au pain du jour où celui-ci a subi certaines modifications exigées par le gouvernement. Cela ne me laisse pas de m'émouvoir. Oxyde ne lit pas les journaux, ne sort jamais : l'observation n'a donc pu venir que de lui. Qu'entre-t-il donc en ce pain, Seigneur, qui dégoûte à ce point un animal moyennement raffiné ? Tous les jours, je tente l'expérience le cœur battant. Son refus persiste. Le voisinage s'y intéresse. Des paris dont engagés. Ingénieux gouvernement, qui nous donne le pain et les jeux tout à la fois, sous la même forme, et comme le magicien noir nous fait manger des énigmes..
D'autre part, les arguments de la liberté de pensée, transposés dans le domaine de l'action, perdent leur force. Ils ne la retrouvent qu'au prix d'un acte de foi préliminaire qui tout ensemble les justifie et les rend inutiles. Lorsqu'on proteste contre les exécutions de maquisards espagnols par Franco au nom de la liberté, on a bien raison, non pas du fait d'un libéralisme de la joue droite qui demanderait à Franco de laisser démolir ses phalangistes sans piper, mais du fait d'une démonstration initiale de ses torts, d'une prise de position politique à laquelle la sanction morale n'ajoute que la liquidation de quelques scrupules. Et trop souvent, la remontrance des champions de la liberté ne vient remplir que le temps d'une volte-face, le temps qu'il aurait fallu aux victimes pour devenir à leur tour des bourreaux.
C'est pourquoi le débat entre Calvin et Castellion, que nous propose Stefan Zweig, a le rare mérite de bien poser la question, du fait de la personnalité même de Castellion, qui est l'homme du « tiers parti » (le Niniste, dirait-on aujourd'hui avec le mépris du chien pour le loup), qui représente en cette affaire le défenseur d'une liberté idéale dans une querelle sans espoir, où sa propre sécurité n'est engagée que par sa volonté, et dont il pourrait aussi bien se désintéresser, sans autre risque que le secret malaise de n'avoir pas « témoigné ». « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire » disait à peu près Voltaire. Chez Castellion, ces mots « jusqu'à la mort » vont prendre leur pleine signification.
En effet, alors qu'on s'accorde généralement à faire partir de Voltaire et de Hume la revendication désintéressée de la Tolérance, l'histoire de la Réforme nous apprend qu'en plein milieu du XVIè siècle, un humaniste oublié du nom de Sébastien Castellion engageait contre l'orthodoxie calviniste la plus pure des batailles pour la liberté de conscience. S'étant intéressé à cet épisode sous l'influence du pasteur Schoerer, Stefan Zweig y oppose une vue plus personnelle de la dictature de Calvin sur Genève. Les calvinistes auraient beaucoup de choses à dire là contre : qu'en réalité il existait à Genève un parti d'opposition, et que ce parti était au pouvoir lors de l'affaire qui déclencha la protestation de Castellion - que Calvin, tyran et policier, est quand même aussi le Réformateur et qu'à ne voir en lui que le contempteur des libertés, sans un mot pour la doctrine à laquelle ces libertés sont sacrifiées, on risque de déformer dangereusement son image. Je me garderai bien de prendre parti, le recul de quatre siècles étant aussi troublant pour la compréhension d'un événement que la lecture d'un quotidien. D'ailleurs le personnage important est ici Castellion, dont le refus brise les excuses de la raison d'Église ou d'État, et demeure indépendant des justifications futures que l'histoire fournit au crime. Admettons donc l'optique de Zweig, et retraçons les faits. En face d'une Inquisition catholique qui se substituait au pouvoir plutôt qu'elle ne s'identifiait à lui, le règne de Calvin nous apparaîtra comme une préfiguration de la société totalitaire moderne, avec son régime de police et de délation, sa liaison de la vérité politique avec la vérité spirituelle, son hypocrite substitution d'une idée au poids des armes, et la mortelle stérilité qu'elle engendre.
Après un premier échec, le Français Jean Calvin, appelé à Genève par l'apôtre de la Réforme, Farel, parvient donc à ce pouvoir sans limite. Outre l'excommunication, son arme la plus redoutable, qui lui a permis de mettre à ses genoux toute la ville, il obtient des pouvoirs politiques l'emploi de mesures de coercition qui ne manquent ni de variété ni de pittoresque : « Un bourgeois a souri lors d'un baptême : trois jours de prison. Un autre, fatigué par la chaleur, s'est endormi pendant le prêche : la prison. Des ouvriers ont mangé du pâté à leur petit déjeuner : trois jours au pain et à l'eau. Deux bourgeois ont été surpris jouant aux quilles : la prison. Un homme s'est refusé à donner à son fils le nom d'Abraham : la prison. Un violoniste aveugle a fait danser au son de son instrument : expulsé de la ville. Une jeune fille a été surprise en train de patiner, une femme s'est prosternée sur la tombe de son mari, un bourgeois a pendant le service divin, offert à son voisin une prise de tabac : convocation devant le Consistoire, avertissement et pénitence. Un bourgeois a dit : « Monsieur, Calvin au lieu de « Maître » Calvin ; des paysans ont, selon l'antique coutume, parlé de leurs affaires en sortant de l'église : la prison, et encore la prison. Un homme a joué aux cartes : au pilori, les cartes autour du cou... Un imprimeur, qui a eu l'audace, étant en état d'ivresse, de lancer des insultes contre Calvin, est condamné à avoir la langue percée avec un fer rouge, puis on le chasse de la ville... » J'en passe...
Aussi, lorsque, dans ce climat libéral, le savant théologien Sébastien Castellion entre en conflit avec Calvin sur deux points secondaires d'interprétation des Écritures, le dictateur de Genève ne doute-t-il pas de le ramener promptement à l'orthodoxie par sa seule emprise. Mais quand Castellion maintient ses positions, et préfère un exil dans la pauvreté à une soumission fructueuse, on comprend tout à la fois que celui-là n'est pas de la même race que les autres « clercs », et que c'est beaucoup plus pour avoir pressenti en lui cette force, que pour une question théologique, que Calvin s'attache ainsi à lui barrer le chemin.
Pourtant, Castellion installé Bâle, Calvin pris à Genève par les soucis du pouvoir, le choc de leurs deux personnalités ne se renouvellerait peut-être pas sans un fait nouveau : l'affaire Servet.
Michel Servet est une sorte de « Don Quichotte de la pensée ». Cet espagnol ardent, brouillon, intelligent mais versatile et incapable d'aller jusqu'au bout de ses recherches, s'arrange assez rapidement pour être dénoncé par l'Eglise catholique comme hérétique, par le Parlement comme charlatan, et par Calvin lui-même comme suppôt de Satan. Par quelle mystérieuse direction vient-il se livrer à Genève, a son pire ennemi, on l'ignore. Toujours est-il qu'à peine Calvin l'a-t-il fait arrêter (illégalement d'ailleurs) qu'il n'a de cesse d'avoir obtenu contre lui une sentence de mort. Emprisonné dans des conditions atroces, jugé iniquement, Michel Servet est brûlé vif le 27 octobre I553. Auparavant, Calvin avait tenté de le faire arrêter en France, en le faisant dénoncer à l'Inquisition, c'est-à-dire à ceux dont chaque jour il flétrissait la cruauté.
De tout cela, la réputation de Calvin ne sort pas très embellie. Mais si certains murmurent, si des savants étrangers quittent ostensiblement la ville, si certains de ses amis lui écrivent de prudentes remontrances, rien de sérieux ne menace encore sa dictature. Il faut que Castellion, que cette affaire ne concernait pas directement, entre en lice, pour qu'elle atteigne sa réelle gravité. Il l'exprimera par deux ouvrages : la préface à son Traité des Hérétiques, et le Contra libellum Calvini, ou, jetant le masque et dénonçant, au delà du cas Servet, la monstruosité de la théocratie calviniste, il prend position dans l'éternelle querelle du yogi et du commissaire.
Avec quelle élévation de pensée, avec quelle qualité de langage... Ecoutez : « O Christ, roi du monde, vois-tu ces choses ? Es-tu si changé et devenu si sauvage et contraire à toi-même ? Quand tu étais sur terre, il n'y avait rien plus bénin ni plus doux que toi, ni plus patient à souffrir injures. Non plus que la brebis devant celui qui la tond, tu n'as pas ouvert la bouche étant de tous côtés battu de verges, moqué, couronné d'épines : tu as prié pour ceux qui t'ont fait ces outrages... Commandes-tu que ceux qui n'entendent pas tes ordonnances et enseignements, ainsi que requièrent nos maîtres, soient noyés, battus de verges, transpercés jusqu'aux entrailles, qu'on leur coupe la tête, qu'ils soient brûlés à petit feu et tourmentés, si longtemps qu'il sera possible, de toutes sortes de tourments ?... O Christ, commandes-tu et approuves-tu ces choses ? Ceux qui font ces sacrifices, sont-ils tes vicaires à cet écorchement et démembrement ? Te trouves-tu, quand on t'y appelle, à cette cruelle boucherie, et manges-tu chair humaine ? Si toi, Christ, fais ces choses ou commandes être faites, qu'as-tu réservé au diable qu'il puisse faire ?... »
On imagine la réaction des pieux docteurs devant cette pensée non conformiste et ces audaces de langage. Dans le Contra libellum Calvini, il ira plus loin encore, annotant presque phrase par phrase le petit ouvrage par lequel Calvin avait prétendu se justifier du meurtre de Servet. Et la force de sa position éclate dans cette formule. « On ne prouve pas sa foi en brûlant un homme, mais en se faisant brûler pour elle. »
Pourtant son cri restera sans écho. La censure de Calvin empêchera l'impression de l'ouvrage, enfermera l'auteur dans un réseau d'espionnage et de proscription. Seule la mort, due à la misère et la fatigue, le sauvera du sort de ce Servet qu'il a défendu. Pour n'être pas sur le bûcher, cette mort n'en sera pas moins l'oeuvre de la patience et de la haine. Cette haine se poursuivra longtemps, jusqu'à ce que les écrits de Castellion brûlés, sa mémoire accusée, son nom même devienne presque inconnu à ceux qui plus tard reprendront sa lutte, avec mille fois plus de sécurité et d'encouragement que cet homme seul - jusqu'à ce qu'un ouvrage écrit en 1936, pour servir d'exemple à une autre tyrannie et à une autre résistance nous en ressouvienne - jusqu'à ce que la traduction nous en parvienne en 1947, sans avoir rien perdu de son actualité.
Toutefois le débat n'est tranché que pour les Castellion, qui sont rares, et pour les Calvin. La pureté de la protestation de Castellion est liée à son caractère d'exception. Il semble vain d'en tirer une sociologie. Les Calvin auraient beau jeu de répondre, comme l'apôtre, qu'ils savent ce qu'il y a dans l'homme ». L'austérité du christianisme genevois, combien de croyants et d'incroyants la conçoivent : « Que faites-vous dans le monde si vous croyez ? écrit Costals. Un verre d'eau qui vous plaît à la bouche, et vous souffletez Jésus-Christ ». Et Claudel : « La tolérance ? Il y a des maisons pour ça. » Ou est la limite ? Pas dans le souci d'efficacité, en tout cas, comme l'honnête Castellion le croyait en recommandant la clémence aux princes. Pour les Eglises costaudes, le plus sûr moyen d'agrandissement reste la politique de ce bon roi dont il est question parmi les contes de la Table ronde, qui « devint si prud'homme qu'il fit occire tous ceux qui ne voulurent pas devenir chrétiens comme lui, de manière que tout le pays fut converti en moins d'un mois ».
Pourtant, il ne sera jamais trop tard pour tenter de réveiller ces innombrables témoins qui dorment du sommeil de l'injuste : tous ceux qui ont pris appui sur la faiblesse d'un homme pour se faire une bonne conscience à peu de frais - tous ceux qui l'ont renié pour mieux feindre la vertu offensée - tous ceux qui l'ont utilisé, analysé, condamné, prôné, justifié, photographié, expliqué, caricaturé, publié, commenté, sans que jamais se substitue à sa valeur d'argument ou de menace cet élémentaire souci d'une dignité humaine pour laquelle il est dit que nos meilleurs amis sont morts.
Hardy, c'est le négatif de Dreyfus. Dreyfus n'avait pas grand'chose pour lui, à part son innocence. En dehors de sa culpabilité, Hardy ferait plutôt bonne impression. Si sa « presse » comme on dit d'une pièce de théâtre, est mauvaise, le public ne le boude pas. C'est que les accusateurs se gourent : ils en font trop, ils se laissent par trop envahir de cette généreuse émulation, de cet enivrement de passage à tabac, et l'on est bien forcé de constater qu'en consacrant à un ancien résistant un luxe d'injures que nul traître patenté, nul délateur reconnu n'a encouru aussi continûment, ce n'est pas la seule vertu qui les fait agir. Ce n'est pas une haine sacrée qui pousse à des loufoqueries aussi concertées que « Hardy arrêté à 12 km de Colombey-les-deux-Eglises » (autrement dit, faites gaffe si Joanovici est retrouvé à 100 m. du carrefour Châteaudun), ou bien « Les communistes savent reconnaître un honnête homme d'un traître (et les personnalistes, povre, ils repèrent la truite saumonée sans la sortir de l'eau). Le jour où Hardy, reconnaissant son arrestation, maintient qu'il n'a pas trahi, on peut lire en énormes lettres : « Hardy avoue être un agent de la Gestapo ». On réclame des sanctions contre ses témoins à décharge, mais les témoins à charge, après la clôture du procès qui les mettait dans une situation identique, n'ont pas été inquiétés. On organise un « contre-procès » qui est en effet une assez belle manifestation de contre-justice, sans témoins et sans défenseurs. Cela rappelle singulièrement le procès de Barrès par les dadaïstes, en 1921, où la défense, assurée par Aragon (tiens, tiens, déjà...) « mettait » nous dit Nadeau « plus d'acharnement que l'accusateur public à demander la tête de son client ».
Sans parler des protestations qui saluent une interruption de l'interrogatoire de Hardy (si on ne demande pas qu'il soit mis à la torture, c'est tout juste). Sans parler de l'attente gourmande des journalistes devant les fenêtres où on « interroge » Lydie Bastien. Sans parler du contrôleur des wagons-lits qui apparaît et disparaît comme le fantôme de Laïus. Sans parler des trois ou quatre versions vraisemblables qui courent, et où chacun pioche au mieux de ses petites cuisines. Sans parler du rebondissement providentiel de cette affaire, au moment où d'autres scandales risquent d'éclairer l'opinion sur l'impéritie de ses représentants, qui nous laisse penser que le sort des hommes se joue en des lieux aussi distincts des cours de Justice, que le sort de la nation, de son Parlement.
Tout cela lève le coeur. Mais nous sommes quelques-uns à ne plus nous étonner que de l'étonnement de quelques autres : on commence à entendre dire un peu partout : « Tout de même, ces journaux... Etalage... Impudeur... Curiosité suspecte... Déformation volontaire... » Et alors ? Parce que pour beaucoup de gens Hardy est un peu « quelqu'un de la famille », quelqu'un dont on est quand même plus proche que de l'assassin ou du satyre, on découvre la lune, à savoir : que la matière première du journalisme est le mensonge et l'abjection. J'ai déjà parlé ici de ce camarade de régiment arrêté, tabassé sur la dénonciation d'une dame-vedette (après coup, si j'ose dire, la dame-vedette s'est aperçue qu'elle s'était trompée, médiocre cautérisation. En attendant, il est toujours en taule...) Sa photo est parue dans la « presse » avec les mentions de repris de justice et de déserteur, ce qui est absolument faux, mais quoi ? On ne va pas se gêner pour un gars qui ne peut rien répondre, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le moment, pour lui, de faire le malin, et il y a comme cela assez d'occasions de se dégonfler, pour ne pas négliger de mener tambour battant une attaque où l'on ne risque rien... Et c'est de la même façon qu'on se vautre dans les titres mensongers, les nouvelles tronquées, ou l'exploitation éhontée du plus secret domaine de l'homme : « Les extraordinaires amours de Lydie », « Les lettres bouleversantes de René », « L'aime-t-elle toujours ? ». « L'a-t-il aimée ? »... Qui est en mesure de comprendre que l'amour en cette affaire n'est ni une excuse, ni une preuve d'innocence, mais comme un gage de gravité ? Il ne s'agit pas de justifier Hardy par Roméo - comme Brasillach par Chénier - mais de le juger et de le condamner, s'il y a lieu, avec gravité, et non dans une explosion indécente de haine et de dérision. Indépendamment de tout crime, l'amour d'un homme peut être ce qu'il y a de meilleur en lui. Je ne m'en porterais pas garant en ce qui concerne le couple René-Lydie, mais je suis bien obligé de voir qu'entre tous, ceux qui se refusent à priori à entendre parler de cette possibilité de rachat, sont précisément ceux qui disent fonder leur foi sur la confiance en l'homme. Il serait superflu de s'étendre sur l'image de la Résistance soumise à cet éclairage. Si l'on mettait bout à bout les définitions que les anciens camarades de combat publient les uns des autres, on obtiendrait un curieux tableau de ce passé qu'on s'obstine à croire glorieux : qui a servi la France ? qui était désintéressé ? De Gaulle ne suivait que sa propre ambition, les communistes leur plan de montée au pouvoir, Fresnay défendait les bourgeois, Mauriac les soutanes, les gens de Londres étaient des aventuriers, les maquisards des bandits... bref tous ces hommes n'entraient dans la clandestinité que pour se faire échec les uns aux autres. Philippe Henriot n'en aurait pas tant dit. Et Charles Lesca, quelque part en Amérique du Sud, doit se pâmer d'aise en lisant dans toute la presse française, par morceaux, le plus virulent numéro-spécial que Je suis partout ait rêvé de consacrer à ses ennemis. Aussi, qu'on ne croie pas s'en tirer à bon compte en rejetant toute la responsabilité sur l'adversaire. Tout le monde est dans le bain. Après le partage du risque et de l'espoir, voici le partage de la honte, suprême et dérisoire communion. Personne ici n'a les mains nettes, surtout pas vous, Monsieur Jean-Louis Vigier, qui vous drapez de vertu pour crier aux diviseurs de la Résistance. Diviseurs de la Résistance, sans blague ? Et vos articles du lendemain de la libération, quand sous l'étiquette « Banditisme et lâcheté » vous attaquiez comme par hasard uniquement les communistes, c'était quoi ? Certes, le prétexte n'était pas mal trouvé. J'aurais pu voir citer bien d'autres exemples de « terrorisme ». J'aurais pu aussi vous en fournir quelques uns de l'autre bord, tel ce chef de l'A.S. qui, apprenant l'arrestation imminente d'un F.T.P., négligeait de l'avertir en disant : « Après tout, que les communistes se débrouillent ». J'aurais pu vous citer cela, mais parions que vous auriez passé outre. Et quand vous sautez sur chaque occasion de replacer le bateau indéfendable de la « désertion » de Thorez, vous vous souciez ; de raffermir l'unité de la Résistance ? Non, n'essayez pas de vous sauver tout seul, monsieur Vigier. Vous n'aurez peut-être pas de Tchiang-kaï-chek pour passer dans les fourneaux des locomotives ceux qui vous ont aidé à remporter la victoire. Vous leur êtes lié malgré vous - et malgré eux. Vous êtes tributaire de ce que vous dénoncez, au même titre que ceux que vous attaquez, à cette r éserve près que vous ne portez pas, vous, l'espoir des meilleurs hommes de ce pays pour vous servir de rédemption, et que ce n'est pas avec vous que nous accepterons, si vraiment c'est le seul choix qui nous reste, de danser le pas d'armes sur les cendres séparées de la rose et du réséda
Le prix de la vie. I. - Parce qu'elle ne trouvait décidément pas de logement, une jeune mariée se jette dans la Scarpe.
Avez-vous UN AVENIR ATOMIQUE ?
(Annonce de l'Écran Français.)
Il reste encore dans l'île de Peloliu
à l'est des Philippines
un groupe de soldats japonais
ignorants de l'issue de la guerre
qui continuent de résister aux Américains
Le prix de la vie. 2. - Parce qu'elle avait fait un faux serment, une lycéenne de Sèvres se jette dans la Seine.
« On va nous appeler les moscoutaires au couvent. »
(Florimond Bonte.)
La production des poissons rouges au japon a baissé de10 % depuis la guerre.
Le prix de la vie. 3. - Parce qu'il n'arrivait pas à remplir sa feuille d'impôts, un ancien contrôleur des contributions se pend.
Le Roi de Grèce est mort d'une thrombose. Il est remplacé par son frère, le diadoque.
« Si j'étais roi, je serais rad. soc. »
(Le Comte de Paris.)
Le prix de la vie. 4. - Pendant l'office du Vendredi-Saint, à Mexico, deux frères poignardent le meurtrier de leur frère sur les marches de l'autel, et sont lynchés par les fidèles, dont l'un est tué.
Le prix de la vie. 5. - Parce que son regard ne lui plaisait pas, A.B. tranche la carotide de R.R.
Dans un cinéma de Turin, des bandes de propagande fasciste sont mystérieusement substituées à des documentaires anglais.
« Si le général de Gaulle revient, ce sera vous, monsieur Ramadier, qui l'aurez appelé. »
(J.-L. Vigier.)
Vivants séparés
le mari et la femme
se retrouvaient
pour cambrioler.
(Libé-Soir.)
« La Résistance a fait place au Résistantialisme. »
(Alexandre Varenne.)
Le prix de la vie. 6. - Parce qu'ils ne trouvaient pas de place pour assister à un match de boxe, les gens
de Port-Saïd chargent la police, qui se défend : 4 morts, 100 blessés.
Jean Cassou a été arrêté comme escroc.
Il s'agit
bien entendu
d'un autre.
L'Etat a nationalisé les houillères de Trémolin. Sous ce nom, on a découvert l'affleurement qui permettait à un paysan de dépanner ses voisins en charbon.
Le prix de la vie. 7. - Parce que...
Martine Carol...
Parfum d'amour radio-actif.
Magnétisé et irradié, ce parfum
d'amour provoque, fixe et retient
affection et attachement sincère,
même à distance.
(Annonce de l'Écran Français.)
Le prix de la vie. 8. - En Grèce...
Pour jongler, ils jonglent, et premièrement avec la probité poétique. Mais voyez plutôt : le théâtre est d'un coup plongé dans les ténèbres, desquelles jaillissent d'inquiétants craquements. On songe aux pleurs et aux grincements de dents, et on va applaudir à cette création du climat biblique, lorsque ça s'éclaire, et voici : à gauche, une dame en chemise, qui récite. A droite, à plat ventre sur les marches de la scène et jusqu'à l'entrée des coulisses, une demi-douzaine de forcenés disparaissant dans des manteaux couleur de muraille, qui de temps en temps s'emparent d'un vers jeté par la dame, et le remâchent comme une meute ferait d'un os, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Enfin, sur scène, un monsieur vêtu en Hamlet, avec un joli corsage de dentelle noire et un collant de rat d'hôtel, la grand'croix de la Légion d'Honneur sur l'ombilic, qui « mime ». (Exemple de mime : « Voici mon coeur, mon Dieu » - geste des deux mains ramenées contre la mamelle gauche, suivi d'une extension du type deuxième-classe-tendant-sa-gamelle-au-cuistot -dans-l'espoir-d'avoir-du-rab. « Donne-moi Marguerite brune, avec ses tresses de nuit » - remontée des mains aux oreilles, puis effilochement d'imaginaires rouflaquettes jusqu'au diaphragme, accompagné d'un frémissement luxurieux du thorax, et ainsi de suite... (Tout ceci ne serait que burlesque si, par le procédé décrit plus haut, ces jeunes présomptueux ne se permettaient d'intervertir les phrases du poème, de réintroduire à la fin des vers du début, de répéter indéfiniment un fragment ou un mot, quitte à rompre le rythme et à fausser la valeur des termes, et en fin de compte de faire de ce chant triomphal et désespéré une espèce de pleurnicherie édifiante, à grand renfort de râclements de plexus et de vallées de larmes).
Inutile de dire qu'après cette entrée (laquelle on avait fait précéder d'un hors-d'oeuvre critique où un monsieur en frac, ressemblant au prestidigitateur du Musée Grevin, nous avait expliqué durant un quart d'heure que Claudel c'était vraiment très bien) j'étais assez mal disposé pour écouter le Chemin de Croix. Mettons donc que ma mauvaise humeur m'ait empêché d'en goûter les délices : je n'y ai vu pour ma part qu'une utilisation sans génie de tous les vieux trucs scouts : choeur parlé où une phrase se distribue mot par mot à chacun des participants (on a fait là-dessus un jeu de société assez drôle). Poses hiératiques à mi-chemin entre l'académisme et l'ankylose. Contresens à tous les coins du texte, sans parler du seul moment où le choeur délègue un de ses membres pour « jouer » la Vierge Marie, et qui est, bien involontairement, une sorte de blasphème incarné. Pour finir, obscurité et projection d'une croix lumineuse sur le rideau, tout comme dans Le Signe de la Croix vu par Hollywood. Qu'à la longue une certaine émotion se dégage de ces litanies et de ces pantomimes lentes, je n'en disconviens pas. Mais j'affirme que d'un article de Pierre Hervé ou d'une page de l'Indicateur Chaix, traités par les mêmes procédés, la même émotion se dégagerait à coup sûr. Il y a un certain nombre de trucs éprouvés pour faire venir les larmes aux yeux (Un panoramique accompagné de voix faisant A A A A, comme dans Les Portes de la Nuit - ou bien la superposition de cloches à un cantique). Ce n'est pas exactement ce que l'on appelle servir un texte. Et qu'une des actrices ait eu les yeux pleins de vraies larmes en finissant de jouer, ne prouve que sa sincérité et - je pense - sa Foi. Je la louerai donc en tant que moraliste et que croyant, mais pour ce qui est du théâtre, j'avouerai que je n'ai trouvé de consolation que dans le choeur qui chantait fort bellement du Bach, avec une allégresse que justifiait sa présence derrière le rideau, et par conséquent son ignorance du rite barbare qui se déroulait sur la scène.
(pages 808-812)
(pages 808-812)
(pages 710)
(pages 703-707)
(pages 531)
(pages 482 à 483)
- II.
par Chris Marker
- I. Moscou, 1er avril
par Chris Marker
par Chris Marker
Henri QUEFFÉLEC : La Culbute (Stock).
Célia BERTIN : La Parade des Impies (Grasset)
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Marker
C'est avec ces intentions qu'Ellis Arnall, en 1945, commentait son travail de gouverneur de la Georgie. Il disait des choses choquantes, telles que « La question dite des races est une question économique, pas sociale ». « Les dix millions de citoyens nègres du Sud ne sont pas plus un problème spécial et séparé qu'ils ne sont une ressource spéciale et séparée... Ils ont droit à être décemment logés, décemment vêtus, ils ont droit à de bonnes écoles, à !a liberté économique et à la justice... » Bon.
La fin de l'histoire, on la trouve dans Life du 17 février. Les idées du nouveau gouverneur, le caractère de son administration, l'évincement des politiciens, tout cela eut la conséquence la plus morale qui soit : au moment de la réélection, ce fut Talmadge père, Ol'Gene, champion de la suprématie des blancs et ami du Ku-Klux-Klan, qui gagna. Comme c'était un vieillard malade, on s'aida d'un article de la constitution pour faire passer un certain nombre de votes au nom de son fils, lequel se présenta ensuite pour recueillir la succession, et finalement l'obtint. Je renvoie donc les lecteurs curieux au reportage de Life, pour assister par l'image aux tripotages des Talmadgites, à leur procession triomphale après la victoire, quand ils enfoncent les portes du bureau d'Arnall, quand le garde du corps du vieux Gene, John Nahara, tombe à bras raccourcis sur le secrétaire d'Arnall, quand celui-ci est expulsé de son domicile par la police qui jusqu'alors le servait, quand Mme Talmadge commente ironiquement l'état dans lequel Mme Arnall a laissé la maison, etc. Que ceci serve de pièce au dossier des progrès de la démocratie, quand on la prend au sérieux.
Tout ne va pas très bien au Conseil d'Administration du Monde (I), même à des yeux apolitiques. Les quatre principaux actionnaires n'arrivent pas à s'accorder, ni sur les querelles de familles qu'ils tiennent à transporter avec eux dans le domaine des affaires, ni sur l'objet précis de leur rencontre, qui est le droit des peuples à disposer des autres.
Cela entraîne d'ailleurs un nouvel aspect de la fonction diplomatique : autrefois, une conférence internationale était une sorte de champ clos, ou des hommes d'Etat jouaient aux Horaces et aux Curiaces jusqu'à ce qu'un champion remportât l'avantage qui enrageait sa nation. Maintenant, le rôle du diplomate oscille entre les uniformes de l'agent de liaison et du facteur, et ses exploits sont ceux de l'huissier. Un ministre n'a plus guère l'occasion d'être véritablement plénipotentiaire que pour apporter la capitulation que pour apporter la capitulation sans conditions de son pays. Sorti de là, c'est le « courtier » - comme disait déjà Bismark - ou bien le valet de comédie : « Mon maître me charge de vous dire, princesse, qu'il feint de partir avec l'armée... » Adieu la belle maîtrise d'un Talleyrand jouant le destin de la France sur son audace et son prestige. On le verrait maintenant comme les autres ligoté, gouverné par mille liens qui ne cessent de le retenir en arrière que pour le faire trébucher en s'emmêlant. Il est vrai qu'il dispose à son tour de serviteurs et d'auxiliaires qui, après son échec, s'assènent encore longtemps leurs arguments. Lorsque, après un certain nombre de ces délégations de pouvoirs, l'écho des grands principes directeurs commence de se déformer et de s'affaiblir, ouvrant peut-être la porte à une entente, un coup de téléphone ou une nouvelle conférence, remontant la file, remet les choses au point, précise à nouveau les motifs inébranlés de discorde, et on se donne rendez-vous au mois prochain.
A vrai dire, on ne voit pas très bien sur quoi porterait l'entente. On se demande par quelle illumination l'U.R.S.S. Se mettrait à rêver d'une Allemagne confédérée, ou la France d'une Ruhr inviolable - et par quel jugement de Salomon des positions aussi résolument contradictoires pourraient bien être conciliées. On se demande quelle solution saurait satisfaire des concurrents dont le point de vue en cette affaire est si mêlé aux idéologies, que toute concession serait nécessairement prise pour un signe de faiblesse. On pourrait espérer un accord par malentendu, mais les forces qui président aux malentendus n'agissent pas sans discernement, et les hommes ne sont jamais aussi lucides que pour définir ce par quoi ils s'opposent.
Rien n'est plus criminel actuellement que de crier à la guerre imminente. Mais enfin, on ne peut pas dire que l'exercice Musk-Ox et les expériences de Bikini nous endorment dans une sécurité trompeuse, même si l'on nous affirme que l'amiral Byrd s'en va conquérir le fabuleux métal à seule fin de nous approcher des délices de l'Age d'Uranium. Dans ces conditions, et considérant malgré tout le péril et les aventures d'une guerre par trop perfectionnées, on ne peut envisager, au mieux, que la prolongation indéterminée de l'état actuel des choses, la conservation jalouse des positions conquises et des territoires occupés... Bref, l'avenir de l'Europe ne serait plus que l'homologation à contre-coeur du fait accompli, avec dans la coulisse une hargne et une observation de tous les instants, versant dans une lutte sourde d'influences et de phynances toutes les forces qui auraient reculé devant les armes.
Car un des moindres paradoxes de cette aventure n'est pas l'absence de vaincus. De par leur affaiblissement même, et la disponibilité qui en résulte, les pays de l'Axe européens, dans la mesure où ils ont le choix entre leurs vainqueurs, se voient pour ainsi dire courtisés, et par l'appartenance sans limite qu'ils peuvent offrir au plus habile, font de leur ruine une sorte de dot. Si bien que dans le règlement final, il leur reste peut-être plus de poids qu'à certains vainqueurs ou assimilés. Et en somme la conférence de la Paix n'est plus un diktat des vainqueurs aux vaincus, mais un partage d'influence entre les uns et les autres, certains se trouvant maintenant dans le même camp (tels les Etats balkaniques avec lesquels l'U.R.S.S. A signé es traités séparés). Le distinguo des peuples innocents des fautes de leurs gouvernements autoritaires n'aide pas médiocrement cette manœuvre. Si bien enfin que la position des partenaires autour de cette paix n'est pas celle de la guerre qui vient de s'achever, mais celle d'une guerre supposée, comme en mathématiques, pour la commodité du raisonnement - celle de la prochaine guerre, celle qui n'aura pas lieu, bien sûr, mais dont chacun peut imaginer le déroulement.
N'est-ce-pas en vertu de cette évolution que les Etats-Unis, grands vainqueurs en 1945, sont aujourd'hui une nation inquiète, déroutée et comme paralysée. EN vérité, il apparaît que leurs succès auprès de l'Europe du temps de guerre étaient dus surtout à l'inexistence de cette Europe, et à la nécessité où ils étaient de transporter avec eux une sorte d'Amérique portative où les problèmes se résolvaient à leur façon habituelle. Maintenant, l'Europe reprenant plus ou moins ses structures propres, l'écart se fait sensible entre deux conceptions du monde réellement étrangères. On sait que la largeur de l'Atlantique s'augmente de quelques centimètres chaque année. Le monde des idées accompagne la fuite des continents, et la dépasse.
Nous n'en voulons pour preuve que les ahurissantes déclarations du président Truman dans Collier's, après sa prise de pouvoir, où, faisant le tour d'horizon européen - comme on fait le tour du propriétaire - le premier citoyen des Etats-Unis se montre incapable de mesurer les réalités d'overseas autrement qu'à l'aune américaine. Et de s'étonner que les pays d'Europe ne réalisent pas l'union aussi facilement que ses Etats (puisqu'en somme il suffirait de réaliser l'unité de langage, de culture, de mythes, de passé, et la politique serait bien forcée de suivre...) Et de citer Mazzini, Garibaldi, Victor Hugo et - le comble ! - Briand. Et de citer la Suisse, comme si un consortium économique pouvait servir de modèle à des nations vivantes.
Il est vrai que M. Truman se déclare dans le même article « profondément convaincu que la forme de gouvernement américaine est la meilleure au monde ». Si cette conviction inspire à un chef d'État de semblables puérilités, on en conçoit certaines inquiétudes quant à l'esprit du gouvernement mondial que nous font miroiter les plus représentatifs des États-Uniens - le pôle le plus bas étant représenté par les divagations primaires du Prof. Einstein, qui pacifie atomiquement le monde avec la belle assurance des hommes de science batifolant dans le réel (divagations d'ailleurs allégrement disséquées par Sumner Welles dans l'Atlantic Monthly de janvier 1946) - et le pôle le plus haut par les réflexions d'Emery Reves dans son beau livre Anatomie de la Paix (II), où, concevant très pertinemment l'impossibilité où sont les démocraties de faire résider effectivement le pouvoir entre les mains du peuple, il ne peut pourtant trouver de solution que dans la délégation de cette souveraineté à un gouvernement du monde, par un tour de passe-passe ou une bonne volonté mutuelle qui rendrait presque inutile ce super-contrôle, si un jour elle s'avisait d'exister.
Nous ne doutons pas du désintéressement de ces hommes. Mais n'est-ce pas à leur insu, parce que les États-Unis n'ayant que des relations économiques avec l'Europe ne sont pas intéressés à une évolution proprement politique du continent, qu'ils s'attachent tellement à une consécration de la stabilité qui ne satisferait en fin de compte que leur égoïsme ? Ce serait la Pax Americana. Ces paix trop longues et trop satisfaites d'elles-mêmes sont généralement inquiétées par un mouvement ou une nation qui rappelle les données de la condition humaine, et que la satisfaction se paye toujours par l'injustice. (Un monde pacifié par la police atomique et le Plan Beveridge ne serait évidemment pas habitable.) Mais ce rappel semble inopportun et dangereux. Pourtant, il se fait toujours : les vainqueurs n'osent jamais suivre le conseil pratique de Machiavel, qui enjoint au prince de ne laisser en vie personne de la famille ennemie. Alors il subsiste toujours une Antigone, un chrétien, un sans-culotte ou un communiste pour protester contre le prix de l'Ordre. Et si cette liste a l'air d'une dégression, et si la nation qui incarne aujourd'hui cette revendication semble à certains mal venue pour jouer son rôle, c'est qu'en fin de compte la pureté d'une cause dépend de ce qu'elle trouve en face d'elle.
Lorsqu'il s'agit de l'U.R.S.S., la conscience américaine s'émeut et parle d'impérialisme, d'expansionnisme, de visées territoriales, oublieuse qu'elle est de cette période de l'histoire où le monde a semblé se liguer contre elle. Lorsque l'Europe dit « Rideau de Fer » (d'après une expression tirée textuellement d'un discours du Dr Goebbels), l'U.R.S.S. peut répondre « Cordon sanitaire ? ». Rien ne peut empêcher que la Russie ait gagné ses bases en Méditerranée, ni qu'elle ait le droit, à la place des bastions dressés contre elle par l'Europe de Versailles, de mettre des gouvernements plus conformes à ses espoirs, même si le régime de Mme Dragoicheva n'est pas idolâtré des Bulgares. Comment la Russie se fierait-elle sans arrière-pensée à ces démocraties qui successivement l'ont mise au ban du monde civilisé, l'ont combattue sur tous les terrains en Extrême-Orient, ont laissé l'Allemagne se réarmer, l'Italie bâtir son empire, Franco prendre le pouvoir, et n'ont pas fini de lui reprocher la manoeuvre par laquelle, en 1939, elle a évité de les suivre dans la fosse qu'elles avaient elles-mêmes creusée. On ne peut que voir là une impuissance peu rassurante - à moins que l'on n'admette l'hypothèse d'une vaste conspiration antisoviétique ourdie dès 1919, et pour laquelle tout, même les antagonismes, a servi. Parvenu à ce point, l'Apolitique tire ses conclusions, qui sont simples. Elles tiennent en trois formules, toujours les mêmes, qu'il place partout et qui collent toujours : « Il n'y a pas de solutions », « Faut pas se mordre le front. », « Les choses ont une manière à elles d'arriver ». Tout au plus pouvons-nous rêver un peu sur la manière des choses : ne serait-il pas piquant, par exemple, que ce soit à cette petite France qu'il appartienne de sortir les trois grands actionnaires du monde de leur cercle vicieux ? Actuellement, elle se tient un peu en retrait au Conseil d'Administration, ayant dû vendre la plupart de ses actions pour faire face à de douloureuses échéances. On la tolère cependant dans de justes limites, en raison de services rendus, et quelquefois, quand la digestion a été bonne, on lui fait des politesses. Il faudrait que les maîtres du monde se souviennent d'elle, quand ils distingueront le contour de leurs futures ruines. Il faudrait qu'ils retrouvent, dans leur souci de ne rien laisser perdre, ces vieilles valeurs oubliées qui furent celles de la chrétienté. Il faudrait... Mais il y a des limites au rêve, car il faudrait que tout change, jusqu'à leurs chimères, et qu'au lieu de chercher le paradis terrestre, ils songent à bâtir le monde de l'honneur.
C.M
(I) Argus, il ne s'agit pas du journal du même nom, attention !
(II) Editeur, Taillander
Voltaire ? Eh oui, Voltaire. Ce Mandib qui traverse tous les pays d'une planète voisine, et entrecoupe ses réflexions philosophiques et ses exploits involontaires de conversations instructives avec les fonctionnaires, ressemble évidemment à quelqu'un de connaissance. Qu'importe, si notre époque nourrit au moins avec d'autant de richesse que celle de Voltaire, le goût du burlesque et la critique des mœurs, si l'amusement ne faiblit pas, et si la qualité littéraire reste à chaque instant digne de son modèle.



S'il était nécessaire de lier la notion de roman à une idée essentielle, ce serait sans doute à l'idée de séparation. Il semble que si par roman nous entendons un genre historiquement définir, un effort d'incarnation du récit par quoi l'homme moderne se raconte (comme le grec par l'incarnation de la tragédie), ce genre est l'expression même d'une rupture avec le monde qui l'entoure. Certes, toute activité littéraire est une protestation, et souvent la création commence par la catastrophe : le monde effondré, il s'agit pour survivre de le reconstruire. L'oeuvre d'art devient alors un délai accordé par la mort. Mais si l'univers poétique s'accommode du déracinement absolu, du dépaysement absolu( (quitte à encourir, comme Patrice de la Tour du Pin, le reprcohe de la stérilité), l'univers romanesque n'acquiert sa profondeur qu'au prix de cette confrontation, de ce décalage qui donnent leur relief aux images du stéréoscope, et dont le héros est précisément la mesure. Le monde de Stendhal, le monde de Balzac, c'est le monde du XIXème siècle vu à la distance Rastignac, à la distance Julien Sorel. « Fanatisme de la différence, individualisme d'artistes » disait Malraux lui-même qui tombe sous le coup de ces accusations. Et il serait absurde de lui reprocher ce qui est une loi du genre. Ses héros, Garine, Manuel, ne sont liés au monde que par leurs actes. Que le roman les prenne dans son faisceau de rayons X, et leur solitude apparaît. Lorsque Malraux écrit « Romain de l'Empire, chrétien, soldat de l'armée du Rhin, ouvrier soviétique, l'homme est lié à la collectivité qui l'entoure. Alexandrin, écrivain du XVIIIè siècle, il en est séparé » qui ne s'apercevrait que la différence n'est pas dans le choix des églises, mais dans le choix des activités : action d'une part, expression de l'autre. De même que Malraux-révolutionnaire de Chine ou d'Espagne était lié à un monde, dont Malraux-romancier est séparé - on le lui fait bien voir. Et la preuve par l'absurde de cette nécessité de la séparation, c'est l'impuissance où sont les régimes totalitaires de faire œuvre romanesque, la nécessité pour les écrivains liés à un système de se réfugier hors du roman, dans son infra-rouge ou son ultra-violet, la chronique et les mythes.
Il est vrai que Malraux admettait la séparation du monde qui nous entoure, au prix d'une liaison avec celui qui suivra. C'était la condition d'une « expression héroïque ». Mais n'est pas aussi un messianisme ? Le monde qui nous suivra, c'est peut-être seulement celui de nos rêves, et en fin de compte cette collectivité de la fraternité virile, ce monde de la réconciliation où le héros ici retranché s'accordera enfin, n'ont peut-être pas plus d'existence que le Parnasse. Car si chaque pas de Manuel ou de Garine les rapproche sûrement de la cité invisible, il les éloigne d'autant du reste des hommes. Ils en conviennent. Et l'aboutissement de leur effort de réunion les trouve murés dans une solitude dramatique. De même que, nous le verrons plus loin par l'exemple de deux romans récents, dès qu'on échappe à la tentation de fabriquer un monde romanesque par l'amalgame de souvenirs personnels, de quelques fantoches, du climat d'une époque facilement écrasante, et qu'on se soucie de recréer des personnages, ceux-ci entrent automatiquement dans le monde de la séparation, qu'il s'agisse du Salaud d'Henri Queffélec ou des Impies de Célia Bertin. Avec le Nain de Pâr Lagerkvist, la séparation s'identifie avec ce qu'il y a de plus profond en l'homme. Si bien que l'effort de réconciliation dont témoignait la préface du Temps du Mépris, s'il est démenti par tout ce que nous savons du roman moderne, et par l'oeuvre même de son auteur, nous touche maintenant comme une protestation désespérée, comme le cri de l'homme qui veut exorciser ses démons.
« Le roi qui se cache en tout homme » disait Kipling au terme d'un de ses plus beaux poèmes « Le Nain qui se cache en tout homme » pourrait-on dire après avoir lu le récit de Pâr Lagerkvist. Car ce récit est à double fond : d'une part, c'est le journal intime d'un nain, attaché au prince d'une petite cour italienne de la Renaissance, qui décrit minutieusement les événements et les personnages dont il est témoin et confident. Mais au delà du récit, à certains signes, à certaines insistances, nous entrons dans l'intention de l'auteur : le Nain revient sans cesse sur les liens qui l'unissent au prince. C'est à lui que vont les seules confidences, c'est lui qui exécute les volontés les plus secrètes, et qui parfois les dépasse : par exemple, lorsque le prince a résolu d'empoisonner ses ennemis au cours d'un repas, c'est le nain qui verse le poison. Et une fois sa mission accomplie, c'est le verres d'un ami du prince qu'il remplit, sans en avoir reçu l'ordre, mais après qu'on ait ressenti à plusieurs reprises, entre le prince et cet homme, une jalousie inexprimée. A ce moment, il rencontre le regard du prince. Et ce regard était étrange...
On aurait cru que le fond de son âme remontait à la surface, tandis qu'il suivait mes gestes avec un mélange de crainte, d'angoisse et de désir. On parvient donc bientôt à cette conviction que le nain fait partie de l'âme du prince, qu'il est cette part souterraine de l'homme où les actes prennent leurs racines secrètes, cette vieille ombre « remplie d'une expérience millénaire » où s'agitent le mépris des hommes et la crainte de la mort, où se composent « cette inimitable saveur - que tu ne trouves qu'à toi-même » et son corollaire, le goût de la solitude : « Assis à ma fenêtre de nain, je contemple la nuit... ».
Séparé, le nain l'est par sa nature. Et non seulement séparé des hommes, mais de ses semblables, à qui il reproche d'être lâches et sans dignité. Le livre s'ouvre sur le récit de la lutte où il étrangla Josaphat, son compagnon. Depuis, je suis le seul nain à la cour. Rien de plus significatif que cet épisode de guerre, où, surprenant sans armes un nain de la cour ennemie, il le pourchasse et le tue, avec un désir irrésistible d'anéantir ma propre tribu. C'est que la part nocturne de l'homme est aussi incommunicable. Rien ne peut être fondé sur elle, qu'une recherche solitaire et haineuse, qui n'exclut rien ni personne, ne pardonne pas davantage à son semblable qu'à son ennemi, et parfois se retourne contre elle-même avec horreur. A la fin du livre, le prince fait emprisonner le nain. Mais ses dernières paroles sont celles-ci : Je pense au jour où l'on viendra me délivrer de mes chaînes, parce qu'il m'aura envoyé chercher.
Le Nain est-il un chef-d'oeuvre ? Il faudrait mieux connaître le reste de l'oeuvre de Pâr Lagerkvist pour en décider. Disons seulement qu'il donne un son peut-être unique dans la littérature contemporaine, celui d'une voix humaine inattendue au cœur de cette culture scandinave que nous soupçonnions volontiers de se complaire dans une certaine mustagogie, et qui, par sa force et son langage, comme le prophète dans Green Pastures, nous contraint à l'écouter.
Retour aux personnages, disions-nous à propos d'Henri Queffélec et de Célia Bertin. C'est que le héros de roman avait subi une éclipse, en partie explicable par son écrasement sous le poids de l'époque, due peut-être aussi à ce fameux souci de « liaison », mais principalement à une grande paresse et à un certain narcissisme. Combien de « romans de résistance », par exemple, sont autre chose qu'une espèce de reportage autobiographique sans effort de recréation ? On peut toujours être le Joinville de quelqu'un (pas le général, le chroniqueur). Mais il est encore bien plus drôle d'être tout à la fois Joinville et Saint-Louis. Avec le bon alibi du roman américain pour justifier la sécheresse, l'absence de style et les fautes de français. Tout ceci pour expliquer à quel point un auteur qui se donne la peine de recomposer ses personnages et d'écrire son roman mérite d'être lu, même si le personnage est peu croyable, comme le héros de Queffélec, ou s'il reste hors de notre portée, comme ceux de Célia Bertin.
Le personnage prenant sur lui tout l'appareil dramatique, l'Epoque n'apparaît plus qu'en biseau, dans la mesure où elle infléchit sa destinée.
A part ces brèves lueurs, l'action se situe dans le domaine du nain, à ce carrefour de la conscience qui échappe précisément aux simplifications lyriques d'une Comédie Humaine à l'usage des adultes attardés. Et si Henri Queffélec ne nous offre pas la « présentation de Paris en 1942 », que M. Jules Romains ne manquera pas de nous asséner quelque jour, son évocation de cette période incroyablement factice et gangrénée par le mensonge, par son cheminement dans l'esprit et la sensibilité d'un personnage prédestiné à s'y plaire, ne nous apparaît ni moins fidèle, ni moins convaincante.
La culbute fait suite au Journal d'un Salaud. Georges Renaud de la Motte, toujours désireux de mériter ce titre de gloire, se donne un mal fou pour rester indigne. Il fait souffrir les femmes, trompe ses amis, écrit des lettres de dénonciation. On jugera peut-être qu'il manque d'imagination, et qu'après tout l'époque lui offrait bien d'autres chemins vers la Saloperie. Il est vrai qu'il y a ce désir de « ne pas se mouiller ». Mais d'ailleurs la crédulité ne s'achoppe pas tant à cette limitation des actes, qu'à la forme même de leur récit. L'emploi du journal dans ces conditions est une sorte de défi, et notre gêne vient de ce que la vraisemblance y perd, au profit d'une qualité littéraire d'ailleurs incontestable. Il semble incroyable qu'autant de lucidité, de pénétration, ne s'accompagne pas forcément d'un contrepoids de pureté qui en rachèterait l'objet. Il semble incroyable que le mouvement même par lequel le Salaud juge ses actes dans l'absolu, ne serve pas en même temps à un jugement plus secret qui rende sa démarche moins ferme. Il n'y a pas de milieu : ou bien Queffélec est lui-même le Salaud. Je dois dire que, pour qui le connaît, la question est réglée. Il reste alors que cet élément de pureté, dont la présence est certaine bien qu'elle ne soit pas définie (comme la planète de M. Le Verrier), ne peut appartenir qu'à l'auteur, et que ce déséquilibre entre deux tempéraments présents dans l'oeuvre à leur insu, l'un parce qu'il sert de modèle, l'autre parce qu'il se trahit, ferait échouer tout ce qui, dans l'entreprise de Queffélec, vise à la reconstitution d'un personnage « historique ». Il reste du moins la beauté du langage, l'étonnant climat de bassesse de cette société et de ceux qui l'acceptaient, et un sens du tragique de l'homme dont l'énoncé court les rues, mais qui se présente rarement avec une authenticité aussi irréfutable.
La notion d' « impie » chez Célia Bertin peut se rattacher à la séparation, comme celle de salaud chez Queffélec, encore que je me méfie un peu de ces titres agréables à la vue, qui trouvent leur justification dans un dialogue récapitulatif. Ici, les impies sont « ceux qui trichent avec la vie, ceux qui trichent avec eux-mêmes ». Tout le monde, quoi. Il est curieux qu'un roman qui renonce si visiblement aux prestiges du langage pour épouser une certaine weltanschaung, trouve en fin de compte son plus rare mérite dans cette forme même qu'il prétends dédaigner. A cette plantation plutôt vague des êtres suivant leur degré d'impiété, combien je préfère l'atmosphère un peu diffuse, la buée de mots simples à travers laquelle se réfractent assez mystérieusement des êtres aussi peu prestigieux que les habitués du Flore. Ce gros volume de 300 pages peut irriter parfois, parfois décourager, il faut néanmoins aller jusqu'à la dernière page pour en ressentir tout l'envoûtement, toute la patiente séduction. Avec de-ci de-là des réussites frappantes. Je n'en citerai qu'une, particulièrement remarquable : Pourquoi n'êtes-vous pas venue hier, dit Délia, le premier jour... Et un autre jour, elle dit : Et pourquoi m'aimez-vous donc ? Un tel raccourci est d'un écrivain.
Mais si le monde du roman est le monde de la séparation, on peut se demander quel en est l'avenir. S'il est lié à la découverte de l'individualisation, s'usera-t-il avec lui ? Notre propos n'est pas de digresser là-dessus. Tout au plus est-il possible de découvrir dans l'apparente vitalité du genre, les premières rides et les premières scléroses. Le roman aujourd'hui appartient à tout le monde. C'est un lieu commun de comparer cette fortune à celle de la tragédie au XVIIIème siècle, dont elle fut précisément le fossoyeur. Thibaudet y répondait en rattachant la tragédie aux exercices scolaires, et le roman aux expériences vivantes. Mais un certain contact avec la vie peut tenir dans notre sensibilité la place que tenaient les humanités pour une autre génération. Et si nos expériences romanesques n'enferment en réalité que notre désaccord avec le monde qui nous entoure, elles peuvent céder demain devant un mode d'expression plus purement dramatique. C'est demain que nous saurons si la floraison contemporaine brille des derniers feux du roman, et si le romans lui-même fera place à un nouveau lyrisme, dont Lautréamont aura été l'initiateur, les surréalistes, les primitifs, et Antonin Artaud peut-être le premier grand classique.
Au milieu d'une génération pour qui tous les problèmes essentiels sont résolus (par d'autres) et qui rougirait de reconsidérer une question élémentaire, avouons qu'il est sympathique de lire sous la plume d'un jeune auteur : « Qu'est-ce que l'esprit ? Qu'est-ce que que cette puissance qui m'habite, qui me parle et qui, littéralement, m'anime ?... » Et quand, poursuivant sa question, il arrive à poser ainsi le problème : « L'homme par son corps est une chose, mais par l'image qu'il est susceptible d'avoir des choses et parmi elles, de son corps, il est verbe, c'est-à-dire qu'il entre dans une certaine résonance avec l'Absolu spirituel chez lequel existence et langage ne font qu'un », on éprouve le sentiment d'accord et de respect que mérite toute pensée librement développée, qui accepte de faire table rase au départ et de se reconstruire en utilisant ses seules ressources d'intelligence et d'honnêteté. S'il est impossible de résumer en dix lignes le cheminement de cette pensée fondée sur un approfondissement de la notion même de langage, il reste à recommander la lecture de ce petit livre clair et dense. L'auteur de Où sont les révolutionnaires ? Y montre les mêmes qualités et le même défaut : clairvoyance et générosité d'une part, mais de l'autre un lyrisme un peu facile, quelquefois péguysant, qui risque de détourner ou d'obscurcir la rigueur du raisonnement : dans ce qu'elle a de périssable, la pensée, comme la viande, se conserve mieux à froid, et c'est pourquoi peut-être la conclusion du livre, traversée de bouffée de chaleur (« Que notre Durance est belle... ») nous déçoit. Mais cette déception même nous sert, dans la mesure où elle marque involontairement les limites de l'entreprise : il n'y a que le langage qui puisse rendre hommage au langage, et ceci, non par la critique ou l'analyse, mais par l'oeuvre. En fin de compte, l'apologie du Logos appartient au poète plus qu'à l'essayiste.
Revue Esprit, avril 1947 - numéro 132
(pages 709-710)
Frank Villier, La vie et la mort de Richard Winslow
par Chris Marker
Si Franz était un auteur Elizabéthain, son livre serait probablement dans toutes les bibliothèques, comme un de ces chefs-d'oeuvre mineurs qui font les délices des lettrés et auxquels on se réfère pour comprendre une époque. S'il était un romancier anglais du siècle dernier, on s'extasierait sur cet éternel retour qui ramène à chaque époque, comme une marée, les signes et les repères d'une culture unique et profonde. Comme Franz Villier est un auteur contemporain français, qu'il se permet de tourner le dos à toutes les modes du jour (Dieu sait pourtant s'il avait le choix!) et d'écrire une œuvre longuement concertée, avec le seul but de tracer la courbe d'une vie et d'exalter un monde qui lui est cher, on ignore quel accueil lui réservait le public. « L'ombre blanche d'un roman noir », a dit Jean Cocteau. C'est vrai, la vie s'y rachète à chaque instant par son contre poids d'innocence, de même que la dureté du monde moderne s'y équilibre avec la fraîcheur d'une mythologie antique constamment recréée. Enfin, n'est-ce-pas par une étonnante prescience de cet univers plus vrai que l'histoire, qu'un des premiers lecteurs du titre de l'ouvrage, pris au piège de ce Richard Winslow imaginaire, déclarait : « Est-ce qu'il ne vient pas de paraître justement en Angleterre quelques chose sur lui ? »
Puisque Toesca accroche le grelot de l'expression populaire ne laissons pas passer cette occasion de montrer notre savoir, et rappelons nos souvenirs militaires.
Pour exprimer le rapport essentiel de son Moi à tel problème extérieur, comme le conflit du CNE ou faut-il brûler Miller, le caporal Milo déclare : « Je m'en tamponne le coquillard avec une plume de hérisson. » On goûtera le procédé qui consiste à renforcer une première proposition un peu décevante à cause de l'assimilation prévue de la boîte crânienne à un coquillard (encore que ce terme reste un peu vague, par l'évocation saisissante d'un hérisson à plumes, variété occidentale, n'en doutons pas, du serpent bien connu).
Pour arrêter le discours de son interlocuteur qui s'embrouille, on dit : « Arrête ton char, manque une roue. » Cette locution ne vient pas des tankistes, comme on pourrait croire. Certains y voient une assimilation de l'individu à l'Etat, à cause de M. Prudhomme. Mais une minorité veut que char s'écrive charre, et soit la forme substantivée du verbe charrier (exemple : « Aragon, tu charries »). Grammatici certant.
Afin de calmer un scrupule, de dissuader d'une recherche intellectuelle on dit : « Te mords pas le front. » Ceci éclaire d'un jour nouveau les constantes physiques de l'homme de lettres : cet effort de la mâchoire et de l'arcade sourcilière pour se rejoindre, ce repli de la bouche à l'intérieur d'elle-même qu'on attribuait un peu légèrement à l'habitude de la médisance, ces mille plis et boursouflures qui sont au visage de l'écrivain ce que la cicatrice est au soldat - ce sont en fin de compte les témoignages du travail accompli par l'intellectuel pour se mordre le front. Certains y parviennent. On dit alors qu'ils vivent en eux-mêmes (N.-B. : Ne pas confondre «se mordre le front» avec « se bouffer le nez » qui exprime une position diamétralement opposée.).
Enfin, pour éconduire un importun, on lui dit vivement : « Va te faire voir par les Grecs. » Mestre propose également l'exégèse suivante : l'importuné renvoie son adversaire à l'exemple de mesure et de bon goût donné au monde civilisé par la culture grecque incarnée dans ses héros. Blatgé au contraire me soumet une interprétation beaucoup plus grossière, tellement grossière que, ne répondant pas au critère d'excellence dans les sentiments et de pureté morale que Toesca voit en toute expression sortie du peuple, je rejette cette explication comme petite bourgeoise, et machinée dans un but politique par ceux qui pêchent entre deux chaises, qui ne mettent pas tous leurs oeufs pour régner, et qui s'entendent comme grenouilles en bénitier.
Revue Esprit, mars 1947 - numéro 131
(pages 488)
Deux petits nègres
par Chris Marker
On l'a déjà remarqué à propos du Dakota perdu dans la montagne. C'est au moment où une certaine saturation de l'horreur émousse la pitié que notre société se découvre des trésors d'inquiétude, pour la personne humaine. Ainsi, c'est au moment où des millions d'enfants grecs, hindous ou palestiniens vivent dans le royaume même de la mort, que les députés travaillistes demandent instamment la grâce de deux petits nègres américains condamnés à l'électrocution. Cela me rappelle quelque chose de très précis : le patron qui le jour de sa fête serre la main d'un ouvrier choisi, ému de tant d'honneur, pour que tout le monde reprenne plus allégrement le travail le lendemain.
Revue Esprit, mars 1947 - numéro 131
(pages 425-526)
Maurice Collis, La cité interdite
par Chris Marker
C'est une bien intéressante chose que de découvrir la Chine sur les traces même de nos ancêtres, qu'ils soient hollandais, portugais ou jésuites. Erudit, familier et plein de mouvement en dépit de quelques incertitudes de traduction, le livre de M. Collis arrive facilement à passionner. Comme tous les livres d'histoire, il présente cet échantillonnage impressionnant d'abominations à rallonges, d'horreurs partagées, de vertus sacrifiées et de crimes récompensés dont la Bible reste le dictionnaire. On s'y pénètre salutairement de cette vérité contemporaine : lorsqu'il y a conflit entre deux factions, l'une d'elles n'a pas forcément raison. Et quand nous lisons « en 1924, Hsüan T'ung (dernier descendant des empereurs Ching) vivait encore... cette année-là le crépuscule allait, pour lui, se transformer en nuit complète. Il devait chercher un refuge dans la concession britannique de Tien-Tsin et porter dans le son nom personnel de Pu-Yi, étrangement précédé su prénom de Henri... » notre intérêt augmente, car nous savons maintenant que cette nuit n'était pas éternelle, que cet Henri Pu-Yi fut repêché par les Japonais et placé sur le trône de Mandchourie jusqu'à ce que les Russes l'en chassent. Et voici le cycle renoué : c'est toujours la vieille machine qui s'ébranle à nouveau, avec son mécanisme de meurtres et de destructions, pour nous broyer à notre tour.
(pages 663)
(pages 644-645)
(pages 643-644)
(pages 470)
(pages 158)
(pages 170 à 172)
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Markerr
par Chris Marker
par Chris Marker
On le voit, chacun a sur l'événement l'ouverture que lui permet sa place, et les hommes sincères du premier et du douzième rang, s'ils n'en sont pas encore à se haïr, bifurquent un peu de l'entendement. Pour moi, j'avoue qu'il m'est impossible de prendre parti : l'argument « Breton au Figaro » vaut bien « Tzara au Panthéon », la Sorbonne n'est après tout qu'une université, pas si différente de ces universités américaines où Breton s'excusait de parler aux jeunes, et il n'est guère plus drôle de voir le Vieux de la Montagne surréaliste s'offrir aux quolibets des analphabètes du Quartier latin, que d'entendre Dada réciter son catéchisme tout neuf sous l'oeil sévère et naïf de ses jeunes directeurs de conscience. Tout cela n'était pas très sérieux, mais comme le faible poids de ces fantômes diminuait encore, en face du masque abîmé d'Antonin Artaud, debout au fond de la salle, qui portait sur le visage la marque de ces années passées à refuser le monde que Breton rêve - et Tzara parle - de transformer.

On a quelquefois cette impression apaisante que le réel bat l'imagination avec ses propres armes. Certaines phrases qu'on découvre au hasard d'une lecture sonnent comme des aveux fabriqués tout exprès.
Par exemple, quand on lit dans les Rhumbs de Paul Valéry : « La cause de la dénatalité est claire, c'est la présence d'Esprit. »
Ou bien, sur les murs de Paris, annonçant trois conférences de M. Winandy :
« Le Secret du Sépulcre. »
« Qui a tué Jésus ? »
« Le souverain Pontife. »
Ce que les surréalistes appellent fort justement un « cadavre exquis ».
Tandis que s'achevaient les préparatifs, la presse mondiale commentait la chose avec une grande variété de points de vue : «Les expériences de Sakhaline, écrivait la Pravda, n'ont d'autre but que de servir la Paix, et de montrer au monde des provocateurs fascistes et des marchands de canons que le peuple russe dispose des moyens de détruire les fauteurs de guerre jusqu'au dernier.» « Et nous alors ?» demandait anxieusement le Times, dont un éditorial acéré laissait peser sur le gouvernement travailliste un soupçon de mollesse et de négligence, dont le résultat était un retard de la science britannique sur les deux autres alliés. Le pape rappelait au monde que qui se servait des rayons cosmiques périrait par les rayons cosmiques, tandis que l'anti-pape d'Avignon (le laïc Aragon, récemment converti), plus au fait des choses scientifiques, affirmait que c'est précisément par cette brèche du firmament que descendraient les légions célestes. Enfin, aux U.S.A., la revue officieuse des jésuites, Brain, publiait un long article de son directeur, Emmanuel Moonlight, qui concluait ainsi : «Il est évident que c'est dans la conscience de plus en plus aiguë de notre refus de l'événement, que tempère le souci d'un vrai réalisme, joint à une adhésion de principes, avec toutes les réserves d'un idéalisme vrai, que se trouve notre voie.»
Le jour venu, une assistance soigneusement sélectionnée mais très diverse, qui comprenait à côté des représentants du maréchal Staline des personnalités indépendantes telles que Pierre Courtade ou Mgr. Spellmann, se pressaient sur des radeaux halés du rivage par un corps de bateliers appelés spécialement de la Volga, pour suivre le déroulement de l'expérience. Arthur Koestler, invité, s'était excusé. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Nul ne savait où se cachait la machine génératrice de rayons. On distinguait seulement au loin les contours de l'île, et à la lorgnette les condamnés à mort faisant leur examen de conscience marxiste-léniniste sur des questionnaires imprimés qui leur avaient été distribués à cet effet. Sur un radeau à part, les savants responsables de l'opération, couchés à plat ventre, tremblaient de terreur. On a déjà rapporté à propos des savants américains ce trait, imputable à une louable conscience des responsabilités. La dite conscience était renforcée ici par la présence derrière chaque savant d'un fonctionnaire armé d'un parabellum du type Sivipachem, qui avait ordre de tirer sans attendre, s'il s'avérait que, négligence ou sabotage, l'expérience commençait en retard.
Un haut-parleur monté sur une bouée comptait les secondes à mesure que l'instant fatal approchait. Lorsqu'il prononça « Poum », ce qui comme chacun sait signifie en russe «Maintenant», un déclic se fit dans les cieux, on entendit nettement les radiations de la machine grignoter la couche d'ozone, et par cette porte ouverte on vit se ruer à grand bruit une bande de rayons cosmiques, chahutant et caracolant comme des étudiants des quat'z'arts.
L'instant d'après, la terre brûlait. Mais par on ne sait quelle erreur (certains murmurent avec crainte qu'il s'agissait d'une manoeuvre longuement préméditée), c'était l'autre moitié de l'île Sakhaline, ancienne possession japonaise, qui était touchée. Aux cendres qu'on y trouva, on sut que s'étaient embusqués là, parmi des montagnes de boîtes de haricots sucrés et de bouteilles de coca-cola, des observateurs de nationalité inconnue.
C'est ainsi que je les désignerais si j'étais le Grand Méchant Loup. Qui ? Attendez : peut-être, lorsque vous pensez à la guerre d'Espagne, avez-vous trois titres qui vous viennent à l'esprit, comme les plus belles expressions de ce drame : « Pour qui sonne le glas », « L'Espoir » et « Un Testament espagnol ». C'est là que je vous arrête. Pour comprendre qu'Hemingway n'est « pas un homme de gauche », il suffit de lire « Pour qui sonne le glas ? » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un de beaucoup plus « dans la ligne ». Et saviez-vous que Koestler, à la veille d'être arrêté par les franquistes, disait qu'il n'avait rien à craindre ? (Courtade, dans Action) Suspect, n'est-ce-pas ? Quant à Malraux, il serait de mauvais goût d'insister. Dommage tout de même, quand on y pense, que l'histoire héroïque du prolétariat (texte d'une annonce d'Europe pour « le Temps des Mépris » avant-guerre) soit écrite par des fascistes.
Revue Esprit, mars 1947 - numéro 131
(pages 475)
Le musicien errant
par Chris Marker
aître Cortot, perché sur un arbre généalogique, tenait en son bec un fromage : la régence de la Musique, au sein de la Famille, à Vichy. A ce titre, il se fit un certain nombre d'ennemis parmi les musiciens évincés par ses soins, qui se jurèrent de lui garder un violon de leur viole. D'où une interdiction temporaire de paraître en public, à la Libération. Les temps étant venus, le voilà qui annonce des concerts. Mais point d'affaire : les musiciens le chahutent, et toutes les villes où il annonce sa venue lui font rebrousser chemin. Curieux spectacle d'un pianiste que chacun se renvoie, comme au billard Nicolas. Comme légalement il est blanchi, et que d'autre part un public impatient de le revoir conteste même son temps d'interdiction, une seule constatation s'impose : c'est que de part et d'autre, on s'accorde à considérer la Loi comme nulle, et les décisions officielles comme une plaisanterie. C'est peut-être dans ce secteur limité mais sûr qu'il convient de rechercher les fondements de l'Unité Française.
Revue Esprit, mars 1947 - numéro 131
(pages 524)
e jeune homme endormi - Yves Salgues
par Chris Marker
L'auteur nous apprend que tout jeune homme mort devient un ange, et « souffle » à ces mauvais élèves que sont les vivants. Nul doute que l'ange-Giraudoux et l'ange-Cocteau, qui sont morts très jeunes comme chacun sait, n'aient beaucoup soufflé à Yves Salgues. Du côté Cocteau, ce sont les anges eux-mêmes, les boules de neige, la drogue, la vitesse immobile, une certaine conception de la pureté, les cascades de verbes et les adolescents nus. Du côté Giraudoux, les énumérations laborieusement cocasses, les personnages définis par leurs exceptions, les lettres au présent de l'indicatif et les prénoms de Jérôme et de Maléna. De l'auteur lui-même, il reste : d'abord un don étonnant du langage, jusque dans le pastiche, qui donne au livre une « classe » que lui refuseraient peut-être ses idées et ses symboles, mais qui nous le signale comme d'un véritable écrivain. Ensuite un curieux parti-pris d'utiliser les restes : il y a de tout dans ce bouquin, des fragments de journaux intimes, des réflexions philosophiques, des jugements littéraires, des fééries personnelles, des tentations sans nombre. Enfin, au milieu d'hésitations et de maladresses plus ou moins plaisantes, de monologues très bons et de de dialogues franchement mauvais, 25 pages intitulées Aventures de Pavel Saleimbéni, qui témoignent d'une maîtrise telle que le prochain roman d'Yves Salgues sera de ceux qu'on attend.
« Et cela continue, voyez, enchaîna Hardy. Plus d'adultère, plus de prostitution, plus d'union libre, plus de perversion... Que voulez-vous, au fond, je trouve cela plutôt encourageant », conclut-il, en reposant la Pravda.
Revue Esprit, janvier 1947 - numéro 129
(pages 312)
En attendant la société sans classes
par Chris Marker
Comment justifier cet emploi du terme «secondes classes» s'il n'y a plus de premières ? Non seulement on laisse passer l'occasion de faire une expérience préfigurative de la Démocratie idéale (celle où, comme chacun sait, l'élite c'est tout le monde), mais encore, par l'emploi de ce chiffre Deux, on laisse planer sur l'opération je ne sais quel spectre de ci-devantisme, une sorte d'émigration des Premières dans une Abstraction d'où elles reviendront un jour en force pour rejeter le peuple sous les pieds de la table rase, un fantôme de privilèges qui hante ces couloirs souterrains, le silence temporaire d'un espace défini. Ajoutez à cela le fait que les rares élus qui parvenaient à trouver place assise dans les Premières (à Neuilly, à Passy ou aux Champs-Elysées) habitant généralement aux têtes de lignes, ils continuent d'occuper les mêmes places pour un haricot de moins, tandis que les autres conservent les leurs à double prix et vous voyez, pour parler le langage de l'Etat, la psychose qui peut s'en suivre. Tels sont les faits qui font dire aux petits-fils de 47 des grands aïeux de 89 : les Socialistes ne sont plus les amis du peuple. Tout au plus des relations.
Revue Esprit, janvier 1947 - numéro 129
(pages 326)
Importé d'Amérique
par Chris Marker
Lorsque, dans l'obscurité de ce cinéma new-yorkais, notre Don Juan de Brooklyn frôla une fourrure veloutée et fleurant le musc, aussitôt imagina-t-il la tendre créature luxurieusement nippée par un homme d'affaires qui lui apporterait, d'une oeillade, la paix du coeur et les douceurs de l'entretien. Et sans plus tarder dériva sa main soignée vers les doigts qu'une large expérience lui promettait revêtus de gemmes et lunés de sang. Quel ne fut donc pas son étonnement de rencontrer, au terme de la fourrure splendide, une griffe crochue quoique rognée, tapie dans les poils comme un piège à loup. Et quand son regard habitué aux ténèbres découvrit, où il attendait voilette et rimmel, le museau courtois d'un fort bel ours, dare-dare s'en fut Don Juan protester auprès de la Direction contre l'admission des plantigrades dans les cinémas de Broadway. S'en vint alors la Direction, prudemment, auprès du second voisin de l'ours, et lui dit : «Monsieur, n'est-ce pas là votre ours ? - Si fait, répondit l'homme. - Comment donc, repartit la Direction, trouvez-vous raisonnable d'emmener un ours voir un film ? - J'ai peut-être eu tort, convint l'homme d'un ton penaud, mais quoi, il avait tant aimé le roman... »
C'est pour le Père Aragon, de la Compagnie de Jésus, qui monte en chaire le premier. Il est toute douceur, toute onction. Il démontre rapidement l'absurdité du titre que des intermédiaires mal informés ont donné à son prêche : non, il ne nous parlera pas de la culture des masses, mais de «tout autre chose». Et là dessus roule un sermon de fort bonne tenue pour la précision du langage. Est-ce pour en illustrer la pertinence que tombe des tribunes ce cri d'une précision lapidaire : «Ta gueule !», jeté par la voix lubrique d'une vipère avinée ? Les ouailles s'en consternent, tandis que d'avoir réchauffé ce serpent au sein de son discours, le Père Aragon, du Saint Office, qui part en guerre contre l'esprit du mal. Bien difféærent est le ton du nouvel orateur : l'élégance ecclésiastique du geste ne gêne point la vigueur de son propos, et jusque dans son langage on retrouve la rude simplicité des pères de l'Eglise : sans avoir peur des mots, il dénonce violemment les grues métaphysiques, et le peuple déjà prévenu contre les putains respectueuses est parcouru de frémissements. Pourquoi faut-il que notre Inquisiteur créé un malentendu en citant un long passage de l'hérétique Malraux ? Les hérétiques de la salle applaudissent immédiatement leur maître, tandis que les vrais croyants applaudissent l'emploi qui va être fait de cette citation, bref, tout le monde applaudit, et de cette fausse communion va sortir le plus grand désordre. Quand après nous avoir prévenus honnêtement que «être n'importe quoi, c'est être fasciste» le Frère Aragon nous dissèque ledit faisceau composé, outre Malraux, de Bernanos, Trotzky, Denis de Rougemont, Jaspers, Spengler, le Figaro, l'Unesco, l'Homme, l'Europe et... les métaphysiques - les éléments non-scientifiques de la salle. ceux qui ignorent que l'Erreur même peut servir, protestent violemment. Et c'est l'Acopalypse. On crie : «Vive Malraux», on siffle, on fait : «hou, hou», tandis qu'une voix - celle d'un professeur de Faculté sans aucun doute - laisse tomber : « Traitez le sujet », remarque pertinente reprise par la salle sur l'air des lampions. Puis, comme ça a l'air de s'apaiser un peu, quelqu'un a l'idée saugrenue de crier :»Vive de Gaulle» (comme les filles Fenouillard criant : « Hurrah pour Fumisty »). Du coup, chacun va rechercher ce qu'il pourrait bien crier. On entend un : « Vive Joseph », mais il ne s'agit pas de Staline. Comme il est question de Maurras, une voix flutée perce le tumulte : « Maurras n'a pas trahi ». «Voilà le visage de la contradiction », réplique l'orateur, qui sait à quel point les maurassiens ont à coeur de défendre Malraux et Bernanos. Mais déjà, à la surprise générale, Aragon s'est transformé en Elvire Unesco, la dynamique vedette, et sur le rythme inimitable qui lui a assuré sa gloire, achève de déverser ce qu'il a sur le coeur, après quoi, du geste même qui accompagne le grand air de « la Traviata », il lève sa coupe à la santé des tribunes hurlantes. Il reste un court laps de temps au Père Ubu, roi de Pologne et d'Aragon, pour tirer les conclusions du débat, tandis que Stephen Spender, qui a congratulé Malraux lors de sa conférence, s'enfonce à chaque phrase un peu plus loin dans son fauteuil, et que les bibliocrates de l'assistance s'en vont indignés...
Arrêtons là la plaisanterie. Tout cela est infiniment triste. Parce qu'il est triste que cet homme chahuté ait eu raison dans ce qu'il disait, ait eu raison de le dire, et que pourtant il ait mérité sa cabale. Nous sommes parfaitement d'accord sur le danger que la formule actuelle de l'Unesco fait courir à la Paix. Nous savons parfaitement que la position d'Aragon en face de Malraux est, dans l'ordre de l'action du moins, la seule vivable. Nous savons aussi qu'une partie des chahuteurs était trop heureuse de trouver de pieux prétextes pour jouer par la bande le jeu de la Réaction. Il n'en est que plus lamentable que le contenu constructif de cet exposé ait disparu, noyé dans les lieux communs, les fausses profondeurs, les fausses simplicités et de petits règlement de comptes qui n'intéressaient personne - que le resserrement et l'exigence de cette position soient apparus, dans la bouche d'Aragon, de l'étroitesse et de la gaterie - qu'enfin ce soit l'homo communistus lui-même qui fournisse ses prétextes les plus apparemment généreux à son ennemi du fond des âges, le pithecanthropus reactio. Si j'étais quelque chose au Parti Communisme, je sais bien le sort que je réserverais au héros d'une semblable exhibition. Quant à juger le spectacle lui-même, de ce monsieur pâle et bien vêtu vaticinant au nom d'une orthodoxie, il y faudrait au moins la verve rageuse, la belle intransigeance de l'Aragon de 1925. Mais celui-là est bien mort, et combien d'autres avec lui, dont les fantômes fous s'agitent aux lieux encombrés, et laissent désespérément vides les places oubliées de la franchise et du refus.
(page 158)
(page 1092)
(pages 488 à 491)
(pages 1097 à 1099)
(pages 329 à 330)
(pages 320 à 321)
(page 312)
(pages 170 à 172)
(pages 511 à 513)
(pages 768 à 785)
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Marker
LE PASSAGER CLANDESTIN
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Marker
par Chris Marker
Les gens se mettaient à courir ou entraient dans les maisons. Le ciel s'était vidé d'un coup, comme un terrain de jeu. Quelque part au dessus de la tête de Pat, une réclame lumineuse tourneboulait et baignait les façades de gros coups de langue bleue, mouvante, balancée, qui donnaient le mal de mer. Au ras du trottoir, une conduite crevée sculptait des gargouilles d'eau. Petit à petit, un fantôme de ville renversée creusait la rue, et des bonshommes doubles, comme des découpages dépliés, voltigeaient dans le vide.
Jerry apparut dans la boutique comme le monde créé du chaos. Les sept jours de la Création, roulés en boule dans sa canadienne, filèrent à travers la pièce-chaos, dans l'éclairage-chaos pointillé de la pluie-chaos, laissant Jerry-Adam en uniforme des Marines, couleur de Paradis Terrestre. L'Eternel, je veux dire Pat, l'accueillit d'assez mauvaise grâce, mais Jerry ne sembla pas s'en préoccuper du tout.
On l'a quand même finie, cette bonne vieille guerre, dit-il avec satisfaction.
Nous avions le Droit pour nous, dit gravement Pat.
Sûr, dit Jerry. C'est une bonne chose. Deux bonnes choses pour nous, eh Pat ? Nous sommes un grand pays.
Un soldat ne doit pas plaisanter sur ces choses, dit Pat.
Excusez-moi, dit Jerry. Je n'ai pas encore eu le temps d'apprendre comment un soldat se comporte chez les civils. A force de vivre dans les trous à renard, on devient tout à fait renard soi-même. Il va falloir que j'apprenne le langage des poules. Alors je pourrai faire la conversation sans vous choquer.
Dites-donc, sacré fils de...
Ne soyez pas grossier, Pat. Si les anges vous entendent, ils iront le répéter à tous les gens bien de cette ville, et ils vous retireront de la
Je suis désolé que vous soyez fou, dit Pat.
J'en suis ravi, dit Jerry.
La nuit tombait. La lessive de lumière continuait, houleuse, de plus en plus écoeurante.
Fichu temps, dit Jerry. J'avais une date au Parc, elle est noyée. J'irai plutôt au Flit Flat. Vous n'irez pas ?
Sûrement, dit Pat, sûrement que je vais courir par un temps pareil pour entendre un sacré sale nègre baver dans une trompette.
Je vois, dit Jerry, Vous avez encore des idées sur les nègres. C'est un préjugé, si vous savez ce que cela veut dire. J'en ai rencontré de l'autre côté des mers qui buvaient tout à fait comme des hommes.
Si vous voulez savoir ce que je pense, vous êtes un type fichu, Jerry, dit Pat. Mon garçon, vous vous êtes mis à plaisanter et à divaguer sur les choses. Vous n'êtes plus bon à rien si vous voulez savoir mon avis.
Vous êtes rudement bien comme cela, Pat, dit Jerry. Vous gesticulez devant la vitrine ; et la pluie vous allume de tous les côtés, tout à fait comme le singe dans cette bonne vieille chose de Sandburg, vous savez...
Et Jerry se planta devant la porte, dans la lessive de lumière, en déclamant gaîment :
C'était un arbre d'étoiles planté sur la carte verticale du Sud. Et un singe d'étoiles grimpait et descendait dans cet arbre d'étoiles...
Voilà maintenant votre damnée poésie, grogna Pat, et il lui tourna le dos.
La nuit était maintenant tout à fait tombée. Un flot de serpentins en papier jetés d'une fenêtre, la veille, s'était entortillée autour du bras d'un lampadaire au-dessus de la boutique, et cette branche lumineuse, raturée par la pluie, avait l'air poudrée de la neige phosphorescente que l'on met sur les arbres de Noël.
C'était seulement un rêve, oh hoh, yah yah, loo loo, seulement un rêve, cinq, six, sept, achevait Jerry dans l'enthousiasme.
Il n'y a pas un grain de sens dans tout ce que vous dites, remarqua aimablement Pat.
Vous ne comprendrez jamais qu'il y a des mots qui déboulonnent le monde, dit Jerry très excité. Rien ne tient plus en place, tout à fait comme si la baraque où nous sommes se mettait tout d'un coup en route, tenez, et allait se balader à travers toute la ville.
Moi, j'ai les pieds par terre, dit rageusement Pat. Et vous pourriez parler comme cela pendant des semaines, sans que ni vous ni moi ne cessions d'avoir les pieds par terre, et la même rue à la même place, et toute la vieille cambuse autour, jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin, dit Jerry. Mais justement, il faudra bien qu'elle vienne, la fin. Hein, si la vieille cambuse craquait, hein, Pat ?
Pat haussa les épaules avec exaspération. Il haïssait Jerry, qui venait toujours lui raconter des histoires à moitié rêvées, on ne pouvait pas savoir si c'était sérieux ou s'il se moquait de vous, je me demande s'il trouve tout ça dans les livres ou bien, et le comble, on ne peut pas envoyer promener comme cela un soldat décoré, blessé, et tout. Et cette espèce de malaise qui suivait ses visites, comme si dans les folies il avait touché en vous une plaie, quelque chose de caché, de honteux, une douleur endormie dont le sens était perdu, mais qui durait, qui durait comme le remords. Et rien que d'y penser, la douleur se réveillait, une espèce d'opressement, de dégoût, comme si le monde d'un coup perdait sa raison d'être, comme si une femme à votre côté brusquement se décomposait. Justement, Pat voyait une femme sortir de la pluie, et son visage de morte dans le tournis bleu et violet de la lumière. Sur la porte maintenant, puis dans la boutique, et demandant la permission de s'abriter pendant l'averse. Pat grognait un vague acquiescement, tout pris dans une nausée de lumière violette et de fin de monde. Les gargouilles d'eau prises de hoquet. La branche d'arbre de Noël lustrée par l'éclairage mouvant, vibrant sous cette lueur morte, ondoyante, cette espèce de caresse obscène, veule, obstinée.
Vous savez ce que j'ai pensé, continuait Jerry plus bas. C'est une chose à ne pas trop dire, mais vous, ça n'a pas d'importance, vous n'y croirez pas. Vous savez ce que nous sommes des tas à avoir pensé, dans les trous à renards et ailleurs ? La seule chose que nous ayons ramenée avec nous ?
Je ne vous écoute pas, dit Pat. Il appliquait toute sa volonté à ne pas mettre ses poings sur sa bouche, à les garder dans ses poches.
C'est cela, Pat, tout juste. La fin de la vieille cambuse. Ne me prenez pas pour un de ces cinglés qui braillent que le monde va sauter parce que nous avons offensé l'Eternel. Pas du tout comme une explosion, ou une colère céleste. Quelque chose, si vous voulez, comme... la pourriture. Les villes en cendres, vos jambes et vos mains et la table et les pierres qui se mélangent, qui ne font plus qu'un, comme les chaînes et les pieds des prisonniers. Et une boutique comme la vôtre, Pat, qui se démantibule et avance à travers les rues, jusqu'à la mer.
La femme le regarda avec surprise. Elle avait un beau visage de guerrière du Nord, et une bouche violente, gonflée, brillante de pluie. Le haut du visage était voilé par l'ombre de la porte. La bouche demeurait en pleine lumière, étrangement désarmée et offerte. Depuis qu'il l'avait vue, Pat sentait son souffle se faire plus court.
Jerry semblait avoir perdu complètement de vue la fin du monde et ses prophéties. Perché sur un coin de comptoir, il faisait une imitation de Frankie Boy Sinatra. Dehors, l'éclairage mouvant paraissait plus rapide, plus impitoyable, entraînant les façades dans son manège, tirant la ville à la faire craquer. Pat regardait la bouche de la femme, luisante comme un fanal. Ma Nancy chantait Jerry, les mains ouvertes dans un geste d'adoration. Les gargouilles d'eau couleur de vitrail. Sur les lèvres de la femme, la lumière versait sa caresse violette, impure. Pat tremblait. Jerry sauta sur ses pieds, enfila sa canadienne, toujours chantant.
… Vous ne pouvez pas lui résister, désolé pour vous, elle n'a pas de sœur, pas une... Je m'en vais au Flit Flat, c'est trop triste chez vous, Pat. Je vous laisse, tâchez d'être correct avec la fille. Adieu, soeurette. Je vous reverrai, Pat. Il plongea dans la pluie, la lumière morte, les façades dansantes. Pat et la femme demeurèrent un long moment immobiles, derrière la vitrine, dans le silence. Et le mouvement frôleur des ombres sur la bouche de la femme, dans une lumière de péché.
Ici se place une chose bizarre. Pat Cormon croyait connaître à fond sa rue et son paysage quotidien. Dans cette ville construite à l'équerre, tout coïncidait, tout s'imbriquait. Lorsqu'on était debout au centre de sa porte, la porte d'en face s'encastrait dans la vitre plus petite. Dans ses heures de désœuvrement, Pat en avait fait plus d'une fois l'expérience, clignant d'un œil, puis de l'autre pour la voir faire un saut de côté. S'était-il toujours trompé, ou était-ce encore un effet de cette sacré lumière, on aurait juré que la porte, de l'autre côté de la rue, débordait nettement sur la vitre. Pat se mit à cligner des yeux, puis s'aperçut qu'il devait avoir l'air complètement idiot, et s'arrêta. Sacrée lumière.
Il avait l'air agité, votre ami, dit la femme. Par regarda sa bouche avec stupéfaction, comme s'il découvrait seulement qu'elle pouvait AUSSI parler. Elle avait une belle voix lisse, sombre, vivante, comme ses lèvres.
Je pense qu'il était saoul, dit Pat. Il parlait de la fin du monde.
C'est intéressant, dit la femme avec un petit rire. Ca m'intéresse même tout particulièrement. Elle appuya son front à la vitre. La lumière monta le long de son visage. La chair autour de ses yeux était un peu plus pâle. Quand elle baissait les paupières, on eût dit deux tombes fraîchement recouvertes. J'avais un ami, qui m'a donné rendez-vous pour la fin du monde. Depuis, j'attends.
« Allons bon, pensa Pat avec haine, voilà des confidences, maintenant. » Et en même temps il regarda de l'autre côté de la rue. Ses yeux se plissèrent . Sacrée lumière. L'autre porte avait encore l'air d'avoir bougé.
Vous avez une belle voix, dit Pat. Et il s'étonna d'avoir dit cela.
Oui... Lui aussi me parlait de ma voix. Il disait... qu'elle existait en dehors des mots, comme la musique. Et aussi que l'Ange de la Mort l'appellerait avec ma voix.
Il est mort ? Demanda Pat, pour dire quelque chose.
Même pas, dit la femme. Elle releva la tête. L'ombre retomba jusqu'au ras de la bouche, mordant un peu de la lèvre supérieure. Pat la regardait de biais, le souffle court et s'apercevait en même temps avec crainte qu'il n'osait plus regarder l'autre porte.
Il m'écrivait : « Ta voix reste en moi comme une blessure ouverte. Comme une blessure qui m'appellerait avec des lèvres vivantes, avec tes lèvres. » Vous écrivez des choses comme cela, vous ?
En l'entendant parler de ses lèvres, Pat s'était mis à frissonner comme une bête qui souffre.
Non, je n'écris pas des choses comme cela. Je ne pense pas, je ne dis pas des choses comme cela. Je ne pense pas, je ne dis pas des choses comme cela. C'est encore des balivernes, cria-t-il, comme l'autre avec sa fin du monde.
Oui, dit-elle, et vous n'y croyez pas. Et pourtant...
Sa voix était restée très calme. Et pourtant l'autre côté de la rue n'est plus tout à fait à sa place. Et vous le savez.
Pat se retourna avec épouvante.
Qu'est-ce que vous dîtes ?
Et vous n'osez plus le regarder.
Elle baissa la tête. Et de nouveau la montée de la lumière jusqu'à ses cheveux pâles, de nouveau ses yeux fermés, fraîches tombes, de nouveau des morsures mauves et bleues, comme des cernes sur sa bouche.
Pat sentit que quelque chose dans sa tête devenait dur et se recroquevillait, pendant que tout le reste bougeait terriblement. Il osa regarder au dehors. La porte d'en face était maintenant à la hauteur de la vitrine droite. Elle dérivait encore nettement. Les deux côtés de la rue glissaient lentement, comme deux vaisseaux se croisant bord à bord. Pat suffoquait de peur. Il entendit vaguement la femme prononcer un nom, un nom de cinéma, le nom d'un cinéma qui se trouvait un peu plus loin, vers la gauche, de l'autre côté de la rue. Il le répéta machinalement, et le répéta encore, à la limite du bafouillement, quand il vit le cinéma lui-même, masse étincelante, carrée, polaire, projeter un grand bloc de lumière blanche dans la décomposition ruisselante de la rue.
Vous avez peur ? dit la femme.
Alors Pat se met à trembler. Du fond de la nuit, les maisons s'ordonnent et se dressent comme des pans de décors. Elles ont la raideur et la menace des grands lions ailés assyriens. Un mouvement se fait dans la ville. Les démons chargent les façades sur leur dos pour apprêter le spectacle. Le manège écoeurant de la lumière violette, mauve, bleue, entraîne tout cela et dirige la marche. Comme un lourd plateau ébranlé, la rue tourne de plus en plus vite. Les fenêtres folles chassent à courre autour du fanal clair, de la bouche de cette femme. L'obsession de cette bouche saisit Pat. Les gargouilles d'eau hoquettent vers elle, guerriers mourants aux pieds d'une femme désirée. La lumière tire les maisons, égare et abandonne les maisons comme des enfants perdus, et s'échappe des maisons pour biffer cette bouche d'un coup de langue rageur et impur, avant que de disparaître. L'Ange de la Mort appelle avec Sa voix. Et du fond des trous à renards, Jerry et tous les morts font des signes aux villes qui passent. On fait de la maison-stop, mais personne ne s'arrête. Pat devine tout ce qui va se passer, la boutique jusqu'au bout de la ville, et puis la mer. Et devant les vitrines, aussi fixes, aussi inertes qu'avant, comme des passants ou des voitures, les phares vissés dans la nuit, images brouillées des appels de radio, quêtant le secours des étoiles, et les navires glissant en silence sous les fenêtres, dans la buée, marqués au fer rouge par leurs feux. Et cette bouche. Marqués au fer rouge par cette bouche. Les grands navires appelant au secours.
Les grands navires appelant au secours... dit la femme.
Ecoutez... dit Pat. Je ne sais pas ce que vous êtes venue faire ici...
Il frissonnait. La femme était près de lui, sa bouche chaude et désarmée comme un oiseau mort. Il s'aperçut qu'il n'avait même pas deviné son corps, perdu dans l'ombre et confus dans le mélange des lumières, mais d'où montait quelque chose qui était à la fois une promesse et une menace. Il n'osait pas regarder ses yeux, mais il sentait dans le souffle de plus en plus proche un parfum de corps mouillé de pluie, de fruit mordu, et comme un goût d'anéantissement.
D'un coup, il se jeta en arrière.
Filez, dit-il avec fureur, je ne sais pas ce que vous êtes venue faire ici, mais filez, avant que... avant que...
Elle resta un moment sans bouger, face à lui, sans même affecter de surprise. Ses mains à lui battaient le comptoir, sans parvenir à se poser. Dehors, on ne voyait plus que le bras du lampadaire, semblable à une branche d'arbre de Noël, étincelant dans la nuit sous le gribouillage de la pluie. Quelque part au-dessus de leur tête, une réclame lumineuse tourneboulait et baignait le monde de vos gros coups de langue bleue, caresse impure, lente, obstinée.
Et la bouche immobile, dans l'ombre maintenant, comme une bête prête à bondir.
Filez, répéta Pat.
Elle se retourna, mit son capuchon, posa la main sur la porte. Pat ferma les yeux, entendit le bruit de la porte. Il sortit à son tour, la suivit du regard. La rue était à sa place, les portes bien alignées. Il la suivit longtemps du regard. Elle avançait à petits pas dans la pluie, d'une démarche bien régulière, bien nette, la tête un peu baissée sous la capuchon. Une passante comme les autres.
Pat rentra, tout mouillé. La pluie tombait plus calme, plus droite. Un fantôme de ville renversée habitait la rue. La lumière tournait. Au ras du trottoir, une conduite crevée sculptait des gargouilles d'eau. Pat secoua la tête, comme pour en chasser, avec les gouttes de pluie, les spectres morts et les scories de cette si drôle, si drôle d'époque.
Chris MARKER
La Vertu déjà s'était manifestée dans l'existence de Capone. D'abord sous sa forme collective, en l'enrôlant sous la bannière étoilée pour la défense de la civilisation et la dernière des guerres. Il en avait ramené un goût prononcé pour les armes automatiques, qui lui permit par la suite de sortir ses frères gangsters de cet âge de pierre où les maintenait l'emploi du fusil scié, en préconisant l'usage de la mitraillette. Puis, encouragée par ce précédent, la Vertu pour l'aguicher se fit platonicienne : elle lui donna l'Intelligence, et sous sa forme sociale, la démocratie (Montesquieu l'a démontré) elle lui offrit tous les moyens politiques d'affermir son pouvoir. Ainsi pourvu, Al Capone devait aller de victoire en victoire. Regrettons seulement que Chicago soit un lieu de tiédeur ou d'hérésie : dans un pays plus profondément religieux, l'Eglise n'eût pas manqué de se joindre aux rois mages, et de déposer son présent aux pieds du fléau de Dieu, tout en admirant les effets de la colère du Très-Haut, et en faisant tendre la joue gauche à ses enfants. Ainsi les choses se passent-elles en terre chrétienne, qu'on dépose le sceptre dans les mains d'un général Franco, ou qu'on se le délègue à soi-même dans la personne de l'amiral d'Argenlieu.
La vie de Capone, vous la connaissez tous, qui avez vu jouer « Scarface » cette tragédie antique de l'Homme et de son Destin. Presque rien d'inventé dans ce film, sinon la fin, due elle aussi à l'attention incessante de la Vertu. Mais Tony Camonte, c'est Al Capone. La boutique du barbier est vraie : il s'appelait Amat et chaque gangster avait chez lui con plat à barbe, comme un écu dans une salle d'armes. Vrai le meurtre du gangster « arrivé » dans sa boîte de nuit : Big Jim Colosimo, un précurseur, dont les découvertes dans la technique du banditisme sont comparables à l'invention de la perspective dans la peinture. Vraie la scène des ombres abattues devant un mur : c'est le « massacre de la Saint-Valentin », où sept types d'une bande rivale furent descendus dans un garage (ces sept sont d'ailleurs devenus ving-huit dans Images du Monde, qui ne recule devant aucun sacrifice). Vraie la fusillade dans le restaurant : c'est le siège de l'hôtel Hawthorne, à Cicero, quand huit autos mitraillèrent la salle où se trouvait Capone. Un millier de coups tirés, les vitres pulvérisées, les murs troués, et pas une victime : c'est le type même de la chronique légendaire.
Toutefois le film passait sous silence les côtés touchants de son héros. Blaise Cendrars nous cite cette anecdote : Capone renvoyant chez lui un petit marchand de journaux, en le couvrant d'or et lui disant ; « Laisse tes menteries, et retourne chez ta mère. » Bon sens et bon sentiment. Plus belle est cette coutume, apparue en 1927, de laisser un « nickel » (25 cents) dans la main du gars qu'on vient de trucider. « Ironie » dirent les ignorants, oublieux du vieux rite de la « communication d'or », pièce de monnaie qu'on plaçait entre les dents de sa victime, afin qu'au moins une messe soit payée pour le repos de son âme. Enfin, ce qui pour moi réhabilite Al Capone, c'est l'invention du « meurtre à la poignée de main » : on va voir un copain, on lui tend la main, et pendant qu'on la serre, paralysant ainsi ses mouvement, un acolyte tire. Fred Pasley, biographe de Capone, et Blaise Cendrars, son adaptateur, nous le certifient : combien de gens sont morts ainsi, le sourire aux lèvres, croyant tenir la main d'un ami. Pour ma part, je ne sais pas de plus belle mort, et ce geste est de ceux que seul le cœur peut dicter.
Tant que la Vertu abonda, Capone surabonda. Pour comprendre le monde dans lequel il vivait, imaginons qu'un caïd du marché noir se met à nommer les préfets, à contrôler la police... Ah, elle était à son affaire, la police. Il lui restait assez de nègres à tabasser, de grévistes à charger, d'automobilistes à engueuler, pour tenir honorablement sa place. Quand à Capone, sa manière cordiale et compréhensive de subvenir aux besoins financiers et gastronomiques des gens en place décourageait la critique. Au surplus, c'eût été ingrat. Et lorsque des sous-ordres oubliaient la règle du jeu, on aboutissait à des gags de ce style : Deux gangsters relâchés avec le commentaire suivant : « Cas de légitime défense contre une agression non autorisée de la police. » Ou bien : « Des policemen raflent des armes dans un des « établissements » de Capone, et les rapportent à leur chef, qui leur passe un savon soigné et leur fait présenter des excuses à Scarface ».
Il y aurait beaucoup à dire sur les aspects souterrains de cette vie, quand elle se mêlait par exemple d'une guerre de races, entre Siciliens, Polonais ou Napolitains. Ou bien quand ces hommes retrouvaient les conditions même de la vie primitive, renonçant à une civilisation étouffante avec autant de grandeur que des ascètes. Notons seulement, fidèles à notre propos, que c'est lorsque la Vertu fléchit que Capone eut des ennuis. Il y avait un bon bout de temps qu'Al, fléau de Dieu, poursuivait son ardente et raspoutinienne exploration des profondeurs, quand la vertu, incarnée dans l'État, perdit de cette rigueur qui l'empêchait, en l'absence de toute preuve légale, de sévir. « Puisque tant d'argent est le prix du vice, et que je ne puis l'empêcher, se dit-elle, au moins que j'en aie ma part ». Et on se mit à poursuivre Al Capone pour dissimulation de revenus, ce qui ne manque pas de sel quand on sait que ses revenus venaient principalement du crime et de la prostitution. Mais rien d'humain n'est étranger à l'État, surtout sous la forme de banknotes. Et l'on dit que le président Hoover, dont la villa en Floride, voisine de celle de Capone, était éclaboussée par son luxe, se sentit atteint dans son prestige. On poursuivit donc, on jugea, et ce que cent crimes n'avaient pu entraîner, l'argent l'obtint : Al Capone fut emprisonné.
Prisonnier modèle, il devait à son tour requinquer la Vertu. Fidèle à leurs engagements, elle lui valut la liberté, en même temps d'ailleurs que des tas de jeunes gens se mettaient à leur tour à apprendre l'usage de la mitraillette, dont la flamme, comme chacun sait, doit se perpétuer sans défaillance pour que dure ce monde. Et Al Capone vient de s'éteindre, lui, confiant dans sa tradition. On nous a appris tout à la fois son retour au sein de l'Eglise, et que son intelligence était descendue au niveau d'un enfant de dix ans, ce qui n'est pas très gentil. On nous a appris aussi la sobriété de ses funérailles. Il n'a pas eu un arc de triomphe en fleurs marqué à son chiffre, comme son ami Lombardo, abattu en 1928. Son linceul ne fut pas le drapeau américain, comme Drucci, tué en 1927. Rien non plus du luxe qu'il accordait à ses victimes, comme O'Bannion, descendu par ses soins en 1924, dont le cercueil était en argent massif et en bronze, avec un couvercle de verre, capitonné de satin blanc, entouré d'anges en argent et de candélabres d'or, avec une plaque de marbre au_dessus de la tête portant l'inscription : « Laissez venir à moi les petits enfants. »
Capone prétendait volontiers qu'il ne tuait que les méchants. Nul doute qu'il ne soit mort avec la conscience aussi pure qu'une jeune militant de parti, qui ferait sauter le monde pour que le dernier homme soit libre. La position du monde à son égard est moins nette : il y avait en Capone un côté spadassin et un côté homme d'affaires. Les spadassins sont sympathiques, pas les hommes d'affaires. Il y avait de l'héroïsme et du crime. Mais la société où il vivait était aussi incapable d'exhausser l'héroïsme que de punir le crime. Il est mort au milieu d'un silence gêné, comme quelqu'un de la famille qui a fait de grosses blagues, mais qui a gagné beaucoup d'argent, qu'on n'ose pas accueillir mais qu'il ne faut pas écarter. Un temps plus pur l'aurait conduit au trône ou à la potence : il est mort dans sa villa. Le monde capitaliste a de ces lieux préservés, de ces abcès de fixation pour liquider les personnalités fortes, dont les deux plus connus sont la fortune et la prison.
Au fait, de quoi s'excuserait-on ? D'avoir gardé une jeune femme treize mois en prison ? (Cinq cent soixante et un mille cents minutes sans liberté, c'est plus long qu'on ne croirait). De l'avoir brutalisée, torturée ? (Evidemment, à notre époque de baignoires et de magnétos, les gifles et la station contre le mur, ça fait plutôt artisanal, plutôt anodin, mais passez-y donc cinq minutes !) De lui avoir gravé pour toute la vie sous la doublure de l'oeil ces images d'arrestation, d'interrogatoires, de prison, cette descente aux enfers ? D'avoir livré son nom, sa vie aux salauds qui font les journaux et aux coprophages qui les lisent ? («Simone Wadier voulait convertir son amant par-delà la chair» et autres ordures. Y-a-t-il pire insulte que d'entendre son nom prononcé par un goujat ?) Allons, parlons sérieusement : vous n'imaginez pas le Gros Professeur Important et ses experts dans leur position réglementaire, un doigt sur la couture du pantalon et l'autre fourré dans l'oeil jusqu'au coude, les flics tabasseurs, les journalistes baveurs, les témoins évasifs et les magistrats intègres se rendant en cortège auprès de Simone Wadier, lui disant : « Nous vous avons fait gravement tort, pardonnez-nous si vous le pouvez, et disposez de nos biens et de nos personnes jusqu'à réparation du mal qui vous est venu par notre faute ». En plein XXe siècle, vous jugez de l'effet ! Les choses sont beaucoup plus simples, Simone Wadier est relaxée, il semble d'après le ton de la petite cérémonie qu'elle doit s'en trouver très heureuse, et même remercier les braves magistrats qui l'ont acquittée. (Il y a dans toute la presse un véritable éblouissement devant ce tribunal qui est capable de reconnaître l'innocence, comme si ce n'était pas le moins qu'on puisse lui demander !) Et bien que dépourvu de culture juridique, je pense que j'aurais entendu parler, si elle existait, d'une loi qui garantît réparation matérielle et morale au prévenu acquitté. Mais non, l'acquittement est une récompense, un prix d'innocence comme il y a des prix de vertu, et plus exclusivement honorifique. Drôle de justice, qui du moment où, par quelque mécanisme, un être humain lui est tombé entre la pattes, le met instantanément dans son tort. Innocent ou coupable, il a perdu la première manche, c'est écrit, et le jugement n'est jamais qu'une partie de quitte ou double, où tous les risques sont du côté de l'accusé, et son seul gain possible le retour à une vie un peu plus abîmée, une peu plus vulnérable qu'auparavant. Que voulez-vous, si c'est cela la justice dans les pays où l'on choisit la liberté, laissez-moi me marrer doucement quand vous venez me servir le rideau de fer sur un plat d'argent. « Comment ? Mais la fréquence... l'importance... la systématisation... » Je m'excuse, mais la dignité humaine ne se mesure pas au gramme. Et n'y eût-il sur toute la terre qu'un seul être en proie à l'arbitraire, je ne vois pas comment un prétendu chrétien s'arrangerait encore pour bien dormir.
J'ai vu la photo de Simone Wadier, au-dessous précisément d'une de ces manchettes ignobles que les journaux lui consacraient. J'aime bien regarder les photos. Je suis d'un naturel sensible aux images. Une autre image m'avait frappé, dans le temps : elle représentait un passager clandestin, qui s'était caché sous le plancher des cales d'un navire, et qu'on avait trouvé mort en arrivant. J'ai à l'égard des symboles la même méfiance qu'à l'égard des dentistes ou des écrivains, et je ne connais pas Simone Wadier : rien ne peut faire pourtant qu'elle n'ait eu un jour le visage même de cet être en nous que les Etats, les polices, les fonctionnaires et les juges, les flics et les professeurs, les experts et les magistrats, ces voyous et ces saligauds comme disaient les surréalistes de leur vivant, affament et étouffent un peu plus chaque jour, ce passager clandestin qui fait la traversée à notre bord, qui serait peut-être la seule justice du voyage, et qu'on ne s'étonne plus de découvrir mort à l'arrivée, quand on décloue les planches.
≠≠≠
LES VACHES GRASSES. Paris, 14 heures, devant la « Samaritaine », un gosse, fort mal vêtu, s'enfuit, poursuivi par un flic, fort bien vêtu. « Arrêtez-le », gueule le flic, et il me semble (joie !) qu'il suffit de cet appel pour que la foule s'entr'ouvre devant le pourchassé. Mais un monsieur s'anime à la voix du flic (la voix du sang, pour ainsi dire) et barre le passage au gosse. Le gosse bute sur le monsieur, le flic bute sur le gosse, le monsieur et le flic attrapent chacun un bras du gosse, et en route pour voir les poissons rouges. Le monsieur ira jusqu'au commissariat, c'est certain, où il sera chaudement félicité, pendant qu'on tabassera le gosse. Pour le moment, il jette des regards victorieux à la galerie. Il est tout rasséréné, le brave homme. Il pense à ses gosses, à lui, et au bon exemple de morale pratique que cet épisode, un peu enjolivé (couteau entre les dents... à la main je veux dire) donnera à ses propos du dîner. Ce sera l'occasion de développer ses maximes favorites, telles que : « Bien mal acquis ne profite pas longtemps quand il y a un flic à proximité » , ou bien : « Qui prend aux riches prête au Diable. » Et il se réjouit de penser qu'ainsi jamais ses enfants ne seront de ceux qu'on emmène au commissariat, qu'ils seront plutôt de ceux qui aident à y conduire.
LES VACHES MOYENNES. Courte prière, dédiée au copain de régiment récemment arrêté pour un casse, un peu cassé à son tour pendant l'interrogatoire, et qui se demande quel sort on peut bien réserver alors aux fonctionnaires qui trafiquent de leur charge : Mon Dieu, qui avez créé les flics, nous n'en sommes plus à nous étonner des curiosités de votre Création. Mais alors donnez-nous le courage de refuser toute complicité avec eux, et d'aimer leurs victimes. On oublie tout reproche auprès des morts. Faites que l'homme qui avance, les joues saignantes, attaché à une grosse bête brutale, soit pour nous comme un mort, et que son crime lui soit remis. Faites que dans le monde entier, tout homme, quelle que soit sa faute, qui est aux mains de la police, nous touche au coeur, et que ce soit un peu nous qu'on frappe. Ce sera une des dernières formes de fraternité, en attendant que ce soit la seule. Amen.
Et quel sentiment de joie collective à la pensée que nous emprunterions le métro comme un simple trottoir roulant. Ce qu'il est, en fait. Un bon point à l'ingénieur.
C'est pour le Père Aragon, de la Compagnie de Jésus, qui monte en chaire le premier. Il est toute douceur, toute onction. Il démontre rapidement l'absurdité du titre que des intermédiaires mal informés ont donné à son prêche : non, il ne nous parlera pas de la culture des masses, mais de «tout autre chose». Et là dessus roule un sermon de fort bonne tenue pour la précision du langage. Est-ce pour en illustrer la pertinence que tombe des tribunes ce cri d'une précision lapidaire : «Ta gueule !», jeté par la voix lubrique d'une vipère avinée ? Les ouailles s'en consternent, tandis que d'avoir réchauffé ce serpent au sein de son discours, le Père Aragon, du Saint Office, qui part en guerre contre l'esprit du mal. Bien différent est le ton du nouvel orateur : l'élégance ecclésiastique du geste ne gêne point la vigueur de son propos, et jusque dans son langage on retrouve la rude simplicité des pères de l'Eglise : sans avoir peur des mots, il dénonce violemment les grues métaphysiques, et le peuple déjà prévenu contre les putains respectueuses est parcouru de frémissements. Pourquoi faut-il que notre Inquisiteur créé un malentendu en citant un long passage de l'hérétique Malraux ? Les hérétiques de la salle applaudissent immédiatement leur maître, tandis que les vrais croyants applaudissent l'emploi qui va être fait de cette citation, bref, tout le monde applaudit, et de cette fausse communion va sortir le plus grand désordre. Quand après nous avoir prévenus honnêtement que «être n'importe quoi, c'est être fasciste» le Frère Aragon nous dissèque ledit faisceau composé, outre Malraux, de Bernanos, Trotzky, Denis de Rougemont, Jaspers, Spengler, le Figaro, l'Unesco, l'Homme, l'Europe et... les métaphysiques - les éléments non-scientifiques de la salle. ceux qui ignorent que l'Erreur même peut servir, protestent violemment. Et c'est l'Acopalypse. On crie : «Vive Malraux», on siffle, on fait : «hou, hou», tandis qu'une voix - celle d'un professeur de Faculté sans aucun doute - laisse tomber : « Traitez le sujet », remarque pertinente reprise par la salle sur l'air des lampions. Puis, comme ça a l'air de s'apaiser un peu, quelqu'un a l'idée saugrenue de crier :»Vive de Gaulle» (comme les filles Fenouillard criant : « Hurrah pour Fumisty »). Du coup, chacun va rechercher ce qu'il pourrait bien crier. On entend un : « Vive Joseph », mais il ne s'agit pas de Staline. Comme il est question de Maurras, une voix flutée perce le tumulte : « Maurras n'a pas trahi ». «Voilà le visage de la contradiction », réplique l'orateur, qui sait à quel point les maurassiens ont à coeur de défendre Malraux et Bernanos. Mais déjà, à la surprise générale, Aragon s'est transformé en Elvire Unesco, la dynamique vedette, et sur le rythme inimitable qui lui a assuré sa gloire, achève de déverser ce qu'il a sur le coeur, après quoi, du geste même qui accompagne le grand air de « la Traviata », il lève sa coupe à la santé des tribunes hurlantes. Il reste un court laps de temps au Père Ubu, roi de Pologne et d'Aragon, pour tirer les conclusions du débat, tandis que Stephen Spender, qui a congratulé Malraux lors de sa conférence, s'enfonce à chaque phrase un peu plus loin dans son fauteuil, et que les bibliocrates de l'assistance s'en vont indignés...
Arrêtons là la plaisanterie. Tout cela est infiniment triste. Parce qu'il est triste que cet homme chahuté ait eu raison dans ce qu'il disait, ait eu raison de le dire, et que pourtant il ait mérité sa cabale. Nous sommes parfaitement d'accord sur le danger que la formule actuelle de l'Unesco fait courir à la Paix. Nous savons parfaitement que la position d'Aragon en face de Malraux est, dans l'ordre de l'action du moins, la seule vivable. Nous savons aussi qu'une partie des chahuteurs était trop heureuse de trouver de pieux prétextes pour jouer par la bande le jeu de la Réaction. Il n'en est que plus lamentable que le contenu constructif de cet exposé ait disparu, noyé dans les lieux communs, les fausses profondeurs, les fausses simplicités et de petits règlement de comptes qui n'intéressaient personne - que le resserrement et l'exigence de cette position soient apparus, dans la bouche d'Aragon, de l'étroitesse et de la gaterie - qu'enfin ce soit l'homo communistus lui-même qui fournisse ses prétextes les plus apparemment généreux à son ennemi du fond des âges, le pithecanthropus reactio. Si j'étais quelque chose au Parti Communisme, je sais bien le sort que je réserverais au héros d'une semblable exhibition. Quant à juger le spectacle lui-même, de ce monsieur pâle et bien vêtu vaticinant au nom d'une orthodoxie, il y faudrait au moins la verve rageuse, la belle intransigeance de l'Aragon de 1925. Mais celui-là est bien mort, et combien d'autres avec lui, dont les fantômes fous s'agitent aux lieux encombrés, et laissent désespérément vides les places oubliées de la franchise et du refus.
Parvenu au bout de ce second voyage en Amérique qu’a été pour lui la rédaction de son livre, M. Schaeffer est pris de scrupules plus vifs qu’à son retour. Est-il décent, se demande-t-il, de livrer aux lecteurs des jugements aussi personnels sur un pays que l’on a mis tout juste six mois à parcourir ? À vrai dire, j’ignore le temps que M. Duhamel, par exemple, a mis à étudier les États-Unis. Je voudrais bien le savoir, cela me permettrait une comparaison précise à l’appui de mon éloge. Mais de toute façon, je pense que l’intelligence de l’Amérique et de son esprit n’a qu’un rapport très lointain avec le temps passé à l’étudier, et dépend d’un tout autre élément, que faute de mieux j’appellerai le sens de la différence. Est-ce contamination de l’imagerie américaine évoquée par M. Schaeffer, mais je ne puis m’empêcher, en le voyant batifoler à l’écart des consignes officielles du « journaliste à l’étranger », de songer à ces familles d’animaux de Walt Disney où un petit dernier passe son temps à quitter la file, et à suivre toutes les tentations animales, végétales ou minérales. Peut-être est-ce d’avoir fait la traversée dans les locaux disciplinaires d’un liberty-ship (un heureux accès de sagesse de l’armée américaine ayant rendu disponibles ces locaux pour le transfert d’une équipe de journalistes français), que M. Schaeffer, à peine débarqué, a été pris d’un si furieux désir d’école buissonnière. En tout cas, rien dans son livre qui sente la caravane, les réceptions et les tournées de propagande. Peu de statistiques. Pour ainsi dire pas de « politique ». Mais des couleurs. Des sons. Des gens, rencontrés au hasard. Il est très documenté sur le board de l’essence, mais c’est parce qu’il a eu une panne. Il découvre les liens profonds unissant vendeurs et marchands de costumes, mais sa coquetterie en est la cause. Il flâne, il discute avec les M. Truman qui peuplent l’Amérique. (Le Président des États-Unis suscitant, à l’exemple du Bouddha, une profusion d’images de lui-même). Et de tout cela sort un tableau de l’Amérique qu’aucun sociologue, aucun historien, aucun reporter n’aurait pu faire si vivant. Il faut bien que M. Schaeffer ait été choisi par les dieux qui président à la légende des États-Unis, puisque même ses erreurs le servent. Parce que le soldat américain est vêtu comme un élégant officier français, il écrit : « On comprend pourquoi la tenue de l’officier est identique à celle de l’homme de troupe », ce qui ferait soupirer bien dans les G.I.s, mais lui permet ensuite de dire sur l’armée américaine des « civils en uniforme », les choses les plus justes qu’il m’ait été donné à lire. Même si la cité future, de par la rapidité des communications, tend à être composée d’immenses constructions basses et étirées, ce qui rendra le gratte-ciel aussi démodé qu’un boudoir Louis-Philippe, il n’en reste pas moins une fort belle interprétation de la troisième dimension de l’Amérique, que nous n’aurions pas eue sans cette divinisation du Building. Et les considérations de M. Schaeffer sur la psychologie américaine « au niveau des Comics du samedi que méprisaient nos enfants » sont fort justes, bien que précisément les journaux d’enfants à plus grand tirage de notre avant-guerre : « Mickey », « Robinson », « Hopla », etc., aient été à peu près entièrement composés des traductions et des reproductions de ces Comics, dont nous retrouvons maintenant les personnages poursuivant leur carrière de l’autre côté des mers, tout comme Charles Boyer, Henri Bernstein et Denis de Rougemont. Admirons donc cette disposition bénéfique qui veut que par l’intervention d’une espèce de vertu poétique, l’erreur se transmute en vérité, et qu’une promenade sans apprêt à travers les États-Unis devienne la plus fidèle reconstitution de leur corps et de leur âme. C’est que M. Schaeffer sait distinguer les choses sérieuses des balivernes. Il nous parle peu de politique, presque pas de littérature et pas du tout de philosophie, parce que ce sont là détails négligeables. Mais il nous parle d’Orson Welles, du lait pasteurisé, des cinémas pour automobiles et de Coney Island. Et de même que le mouvement zazou aura mille fois plus d’importance que l’existentialisme pour l’explication de notre époque, c’est par cette mythologie quotidienne de la rue, du cinéma, de la radio, que M. Schaeffer nous fait toucher la véritable profondeur de l’Amérique. Quel courage ne faut-il pas à un écrivain européen pour oser dire cette phrase inoubliable pour tous ceux qui ont connu et aimé l’armée américaine : « Le lait en boîte, le paquet de Chesterfields, le disque, les magazines, sont les sacrements du soldat américain ». Et ainsi les dieux reviennent sur la terre. Et nous qui les avons renvoyés depuis longtemps au ciel, nous retrouvons le totémisme à l’autre bout de la route. M. Schaeffer a un autre mérite en l'occurrence, c’est de ne pas trop se souvenir de sa formation mathématique et de nous épargner ces brillantes analogies qui ont frappé d’admiration et de terreur plus d’un congressiste de Jouy-en-Josas. Tout au plus fait-il œuvre de prophète en annonçant la machine à intégrer, qui est une chose faite à l’heure actuelle, je crois bien (cette restriction due au fait que l’information nous était donnée par « Life », et que le vocabulaire scientifique est presque aussi obscur en anglais qu’en français). Le livre, très habilement, tout en évitant l’ordre chronologique, épouse cependant les trois phases de la réflexion de l’auteur : enthousiasme au début, enthousiasme à base de couleur de cravates, de jambes de filles, de petits déjeuners catapultés et de chanteurs de radio (encore qu’il n’insiste pas assez, à mon sens, sur le rôle proprement divin desdits chanteurs, qui tenaient très exactement auprès de l’armée américaine en campagne le rôle des Dieux du Combat dans l’Iliade), lassitude au bout d’un certain temps, parce que trop de ressemblances, trop de nivellement, trop de satisfaction - et, au retour, entre la joie et le dégoût, cette espèce de lancinement d’amours perdues qu’il exprime très bellement : « New York aux bons soirs de soie grège. Mon cœur se serre à tes boulons. » Est-ce conclusion ? Non point. Très astucieusement, la conclusion s’adresse à la France, et le voyage s’achève en famille. Il reste posé ce problème, le plus grave peut-être, du bonheur à la mesure humaine. Tandis que les demi-dieux d’Europe, comme tous les demi-dieux, se donnent un mal fou pour modeler et circonvenir la pâte humaine, les puissances d’Amérique, à l’image de leur radio, offrent à leur peuple « ce qu’il demande dans la forme qu’il préfère », c’est-à-dire ne font que répondre aux prières, comme tous les dieux. Cela porte beaucoup de noms. Ce pourrait être également une définition de la démocratie.
Chris Mayor
Gabriel se hâtait maintenant par les jardins déserts du crépuscule. Un grand vent y apportait déjà de contrées perdues loin dans l'Est l'odeur et les images de l'hiver prochain. Le soleil s'y décomposait, et ses éclats de verre givrés, repris par le plomb du fleuve, faisaient un vitrail sombre sous l'ogive des ponts. La ville repliait frileusement ses arbres dans les avenues. Saisie de peur à l'approche des géants muets de la saison glacée, elle allumait en désordre une constellation tremblante de feux et de lampes d'alarme. Le ciel droit comme un front d'enfant malade avait une roseur de fièvre. Gabriel écoutait distraitement la ville geindre et frémir comme un dormeur, et la cadence régulière de sa pulsation la plus profonde : le pas des hommes d'armes dans les rues éloignées. Dans ces jardins royaux, peuplés de statues tristes, l'armée ennemie n'entrait pas. Le monde froid de brume et de métal qu'elle apportait entre les taches vives et ses drapeaux s'arrêtaient aux frontières de cette puissance morte. Les soldats eux-mêmes reculaient devant la saisissante douleur de ces sentinelles de pierre qui se souvenaient d'avoir été des hommes. Au-delà, c'était entre des chevaux cabrés l'ouverture d'une place rayonnante où se plantait, comme un manche de dague, une borne d'énigmes - puis l'avenue triomphale pleine d'images dansantes - puis, tout au fond, l'arc immobile et clair, le lourd aimant tirant la limaille étoilée des maisons et des brouillards. Les bruits s'étouffaient lentement, mer qui se retirait, laissant derrière elle comme des algues un entrelacs de rues désertes. Et Gabriel pensait à ce peuple nocturne qui attendait la marée.
Quelqu'un vint parmi les arbres. Gabriel reconnut le garçon qui lui avait demandé cet étrange rendez-vous, et fit quelques pas à sa rencontre. Il fut frappé de la dureté de son regard. La dureté, froide qu'il avait vue dans les yeux de certains guerriers n'avait pas ce cerne lumineux et riche, cette secrète profondeur de domaine interdit.
Je vous ai fait attendre, dit-il. Et sur le même ton uni : Je m'appelle Vincent.
Vous avez raison, dit Gabriel.
Je m'excuse de ce rendez-vous. Tout à l'heure, nous irons chez moi... mais je ne pouvais vraiment pas vous y attendre. Ce... ce n'est pas un endroit pour les anges. On... Il hésita et dit très vite : On n'y croit pas. Et puis...
Vous cherchiez un endroit libre, acheva Gabriel.
Vincent rougit : Libre, c'est aussi votre avis, n'est-ce pas ? C'est un endroit tellement extraordinaire. Ils n'y viennent pas. Son regard se durcit encore. Ne croyez surtout pas que j'aie peur... d'eux. Seulement, c'est comme pour parler des démons : il faut choisir un endroit qu'ils aient déserté. Cela ne vous fâche pas, que je parle des démons ?
J'en connais beaucoup, dit sérieusement Gabriel.
Evidemment... Vincent le regarda curieusement... Vous connaissez aussi l'Enfer ?
Non. C'est peut-être le seul point où vous soyez plus... avancés que nous. L'Enfer, c'est la séparation. Nous ne sommes jamais séparés.
Il... Vincent se mit à rire. J'allais dire une chose bête... J'allais dire qu'il vous manque quelque chose.
C'est vrai, dit Gabriel, il nous manque la réconciliation.
Le soleil grésilla au ras des collines. D'un coup, les ombres s'allongèrent jusqu'à se confondre avec la brume. Et ce furent, par des teintes de plus en plus sombres, les prologues de la nuit.
Mais c'est de votre aide que j'ai besoin, ajouta Vincent après un silence.
C'est pour cela que je suis venu, dit Gabriel.
Merci, dit Vincent. Ses idées tournèrent comme un phare. Il fit face à Gabriel. Il ne faudrait pas qu'ils détruisent cette ville.
EN tout cas, ils l'ont minée.
Au sens propre ?
Vous voulez dire : Par le sol ? Par le sol aussi. Mais par l'âme d'abord. Le sens propre, comme vous dites, vient toujours après l'image. Cette ville est encore intacte, et pourtant... Il y a en elle une tristesse qui est plus, et autre chose, que la tristesse de ses habitants.
Cela, c'est exact. J'avais cru que c'était mon inquiétude que j'y retrouvais, qu'elle me la renvoyait comme un miroir, mais c'est autre chose.
Je ne suis pas dans cette ville depuis longtemps, dit Gabriel, mais je n'ai pas encore entendu sa voix. On dirait qu'il y avait un timbre, un ton qui lui donnaient son vrai sens, sa vraie place, et que maintenant son angoisse est celle d'une femme muette qui passe sa nuit à essayer un cri, toujours le même, et jamais n'y arrive...
Vous parlez bien, pour un ange. C'est vous qui étiez de garde au Paradis Terrestre, après la faute ?
Non. C'est un autre. Il y est toujours, d'ailleurs. Toute cette vieille histoire vous intéresse encore ?
Oui. J'ai une grande tendresse pour l'enfance du monde... Quand on ne s'était pas aperçu que tout était à recommencer, perpétuellement...
Dans le jardin, les statues frémissaient. Les plus lointaines effleuraient déjà la nuit du bout du pied, pour la connaître avant d'y plonger. D'autres s'essayaient à marcher sur les pelouses. Les sentinelles sourdes se gantaient de noir.
Quand on n'avait pas appris cette belle tristesse, dit l'ombre de Vincent, statue de sable parmi les autres.
Vous parliez de mon aide, dit Gabriel. C'est cette menace contre votre ville qui vous inquiète ?
Pas exactement. Mais, à la hauteur où je vis en ce moment, toutes les lignes se confondent. Et comme cette ville est ce que j'aime le plus au monde...
Gabriel sentit monter vers lui un appel d'enlisé :
A quoi puis-je vous aider ?
A mourir, dit Vincent.
Ils sortirent du jardin. La nuit était tirée au ras des toits. Sous les arcades, des femmes rapides, des sentinelles droites, des groupes de soldats. Les vainqueurs assiégés n'osaient plus sortir seuls. Le sol tremblait de machines souterraines. Une voiture approcha en silence, feux éteints. Elle ralentit à peine pour prendre Gabriel et Vincent, et tourna aussitôt dans une rue gardée par un cavalier d'or. Un grand garçon aux cheveux en désordre la conduisait.
Il ne faudrait pas qu'ils nous arrêtent, dit Vincent.
Nous serions bons, précisa en riant le conducteur.
Gabriel sentait en lui le grand désir de les défendre, de les sauver. Il épia les barrières blanches, les guetteurs immobiles aux carrefours, les lanternes dansantes, tout ce qui aurait pu être un signe ou une menace.
Un appel éclata derrière eux. Rayonnante de faisceaux, vibrante de sirènes, une puissante machine les dépassa, mugit, reprit de la vitesse. Ils eurent le temps d'y reconnaître les parements rouges d'un officier. Vincent se pencha en avant, tandis que le conducteur, du même réflexe, tournait la tête. Les deux visages flottèrent un moment à la même hauteur. Ils se comprirent et sourirent. La voiture frémit, s'allongea dans le sillage de l'autre, tendit ses phares comme des antennes. Un barrage fut franchi en pleine vitesse. Des coups de sifflets partirent. Gabriel se retourna. Des ombres gesticulaient, ridiculement rapetissées par chaque seconde, retournaient à la nuit pleine d'étincelles. La ville s'animait d'une vie contenue, rassemblait ses maisons comme un troupeau de lions à demi éveillés, des taureaux assyriens brûlant des victimes, des figures immobiles aux ailes de pierre lentement métamorphosées en ailes de chair. La voiture militaire vira au frein sur une petite place. Ils la suivirent. Il semblait que les officiers comprenaient le sens de cette course, qu'ils se piquaient au jeu. Tout cela échappait encore à Gabriel. Il sentait seulement que cette joute engageait beaucoup plus qu'une lutte de vitesse. Pour défier ainsi toute prudence, il fallait qu'un enjeu inconnu fût en cause. C'était maintenant une longue avenue d'arbres mutilés. Les deux machines phosphorescentes s'enfonçaient dans la nuit comme des foreuses. Le bruit des moteurs se faisait plus aigu, s'affinait en hurlement de bête torturée. Vincent cria quand ils se rejoignirent. Les deux conducteurs avaient la même expression fermée, les lumières vibraient dans la ville sombre, balles traçantes. Lentement, l'autre voiture décolla, regagna du terrain. Vincent était courbé sur le dossier, entièrement pris par la course, inondé d'une nouvelle beauté. Gabriel n'y retrouvait plus les lèvres dures qui avaient parlé de la Mort. Un nouveau virage, puis le vide, un boulevard large entre des parcs, les maisons reculées, apeurées. Les autres gagnaient toujours. Le conducteur aux cheveux fous grogna quelque chose, et Gabriel s'aperçut qu'ils revenaient de toutes leurs forces. Sur cette ligne vertigineuse enfoncé dans la ville, c'était une lutte de planètes. La voiture cria de tout son corps. Gabriel vit de nouveau des parements rouges, à reculons cette fois et bientôt perdus dans l'éventail des phares. Ils coururent encore sur leur lancé, avec une route vide devant eux, puis le conducteur les jeta dans une rue de traverse, coupa ses lumières, et s'arrêta au bord du trottoir. Quelque part derrière eux, une course continua, folle et sans but. Enfin un silence bourdonnant s'installa. Vincent se mit à rire.
Ils ont été sport, dit le conducteur. S'ils nous avaient eus, c'était au moins deux ans.
Oui, mais ça valait la peine, dit Vincent.
Le pas d'une patrouille naquit du silence. Ils repartirent. Quelques rues plus loin, Vincent et Gabriel descendirent. A tout à l'heure, dit le conducteur. Ils sourirent à des choses secrètes. La maison pesait de toute son obscurité sur l'argent du sol. Très haut, un fil de lumière bleue découpait une fenêtre.
Mon père, dit Vincent. Toute la nuit, il reste assis devant sa table, les mains tombantes.
Il pense ? dit Gabriel.
Oh non, répondit vivement Vincent, c'est tout à fait différent. Il rêve.
Un nouvel ami, avait dit Vincent.
Vous conspirez aussi ? Demanda le Père.
A ma manière, dit Gabriel. Le vieil homme était immobile, raidi dans son fauteuil comme dans un tombeau. Ses mains pendaient, ouvertes. Durant ses heures de solitude, il se refusait au mouvement, se fiant à la sève ardente de ses songes pour gonfler son écorce de vivant. Le seul geste qui donnât à ses mots une expression était un demi-hochement de tête, une perpétuelle ébauche de négation. Au-dessus de lui, une très belle eau-forte figurait un gisant entouré de prières. Gabriel s'y arrêta.
Voilà ce que je vous souhaite à tous, dit le Père. Les jambes droites, les mains croisées, la bonne position pour plonger dans la mort.
Il y a beaucoup de morts, parmi les vôtres ?
Passablement, dit Vincent. Mais nous n'avons pas le droit d'y penser.
Je le sais, ce que vous pensez, dit le Père, et il sembla se démentir en hochant la tête. Mais nous n'avons plus peur de la mort. De mourir, tout au plus. Après...
Vous êtes croyant ? demanda Gabriel troublé.
Non, dit le Père.
Un timbre vibra dans la maison. Il y eut des pas, des portes fermées. Sous le voile bleu d'un abat-jour, une seule tache de lumière cernait un livre ouvert. Un signer plat aux lignes tourmentées divisait plusieurs colonnes de versets. Une Bible, pensa Gabriel.
Ce doit être Christel, dit Vincent. Je lui dis de monter ? Le Père hocha la tête. Les pas se rapprochaient. Vincent sortit et appela. Des horloges sonnaient sur la ville.
Christel entra.
Bonjour, dit-elle à Gabriel. Comment va ?
Elle embrassa rapidement le front du vieillard. Ses pommettes saillantes troublaient curieusement son visage de guerrière du Nord. La dureté des yeux répondait au regard de Vincent. Gabriel chercha lequel était le reflet de l'autre.
Des nouvelles ? dit Vincent.
Je sais ce qu'ils ont fait de Phil. Elle secoua la tête et s'éclaboussa de boucles. C'est... atroce. Ils l'ont attaché à une pelle plantée par le manche, et ils l'ont flagellé à coup de nerf de bœuf, en se relayant, pendant que la lame de la pelle lui entrait dans le dos...
C'est une nouvelle méthode, dit Vincent.
Oui... Ils ont dû recevoir une circulaire détaillée, expliquant la chose... scientifiquement. Peu de risques d'évanouissement, et la peur... Tu comprends cette chose ignoble, une pelle...
Il a parlé ?
Je ne sais pas. Moi, je crois que j'aurais parlé.
Elle se tourna vers Gabriel, sans défi :
Et pourtant je suis courageuse.
Contre l'horreur, il n'y a pas grand'chose qui tienne, dit le Père.
Où est-il, maintenant ? Demanda Vincent.
Elle prononça le nom d'une prison. Le Père hocha la tête. On ne connaissait personne qui en fût sorti. Au-delà, c'était la mort, ou bien le départ pour des pays froids, dans des travaux de damnés.
Encore un à oublier, dit Vincent.
Et il laissa sa main effeuiller sur les notes basses du piano le thème de l'Hymne à la Joie.
J'attends toujours, dit-il encore, parlant très vite, ce moment-là dans la Neuvième. Je voudrais que le chef se tourne vers le public et crie : « Et maintenant, tous en choeur ! Et que les gens chantent, et chantent... bien. »
On ne sait pas se servir de la vie, dit Christel à voix plus haute. Il devrait exister des commis-voyageurs pour annoncer dans les maisons que la Joie existe, et la preuve c'est qu'on a mis de la musique autour. Les gens croient toujours ce qui est imprimé.
Et, pour qu'ils s'en aperçoivent, on les priverait d'un sens pendant quelque temps.
Vincent jetait ses mots comme une incantation. On eût dit qu'il se hâtait, pour empêcher un absent d'élever la coix contre eux.
Pendant un mois, ils seraient aveugles, ou sourds, et le jour de leur guérison, on ferait une grande fête, où on leur montrerait tout ce qu'il y a de beau à voir, ou à entendre...
Et ils auraient vu et entendu de telles choses, dit le Père, qu'ils demanderaient tout de suite à redevenir aveugles et sourds.
Ils rirent tous les trois, et Christel, sans abandon, laissa tomber sa tête sur l'épaule de Vincent. Etrange peuple, pensa Gabriel. Il osa prononcer le nom de Phil. Vincent avait sur le visage un sourire absent.
C'était notre meilleur ami, dit Christel.
Dès que les jeunes gens furent sortis, Gabriel sentit la puissance de ce monde immobile que le Père s'était fait. Il luttait avec sa propre pensée, et lentement s'approfondissait, à la recherche d'un accord unique. Par une curieuse contradiction, son visage s'animait quand il fermait les yeux, et son sommeil devait être en lui l'image la plus éloignée de la mort. Devant cette chute arrêtée, aux bras tendus, Gabriel devinait une exigence peu commune, et sous ce masque d'intellectuel, une rigueur de paysan. Dans la rue, il y eut encore des pas cadencés. Le Père ouvrit les yeux et hocha la tête.
Pourquoi les haïssez-vous ? dit Gabriel.
Je ne crois pas les haïr... rien de ce qui exalte la vie ne peut le laisser indifférent. Ce n'est pas ce qui en eux est une fidélité ou la persistance d'une mythologie qui me choque... Au contraire. Mais ce qu'ils ont trahi.
Ce qu'ils ont trahi ?
Tout cela... Sa main enfin se leva et désigna vaguement les murs incrustés de livres, les eaux-fortes, les moulages de mains et de torses. Ils n'ont pas osé le nier. Moi, j'aurais pardonné. C'eût même été assez beau. Brûler les légendes pour les vivre. Brûler les images pour en garder de plus riches au fond de soi. Briser les statues pour sculpter un héros dans sa propre chair... Mais ils n'ont pas osé. Ils ont préféré créer de fausses légendes, des images grossières, des statues maladroites. Je crois que c'est cela, le péché contre l'esprit... Il sourit : Vous voyez que je ne tombe pas dans les mêmes pièges... Mais ceux qui combattent avec moi ne le savent pas. Ils croient combattre pour ds idées d'hommes. On ne combat que pour... une certaine beauté.
Ou pour Dieu, dit Gabriel.
La beauté, c'est Dieu...
Les mains retombèrent, mortes. De nouveau, un hochement de tête prolongea la phrase, comme s'il fallait y chercher plus, et autre chose. Sur la longue cheminée de marbre noir, les formes de pierre se dressaient, victorieuses des hommes. Toute œuvre s'y montrait comme une défaite consentie par les vivants. L'autre création n'était pas cela, pensa Gabriel, et il se prit à admirer les choses humaines.
C'est notre seule chance, vous comprenez, continuait le vieillard 'une voix plus faible. Dans cette solitude où nous sommes, sur quoi avons-nous encore des droits ? Sur la beauté, sur la souffrance. Sur la chair, sur le sang... Vous me parliez de Dieu. Pour nous, il commence à l'homme, à Christ. Le sens de l'Incarnation, c'est que Dieu peut entrer dans l'homme, dans chaque homme... Sa voix reprit de la force. C'est cela que nous cherchons, et... Il désigna du regard la porte où étaient sortis Vincent et Christel. Et qu'ils cherchent, sans trop s'en douter... Evidemment, à chercher ainsi Dieu en nous, il se peut que nous arrivions à nous crever la poitrine, mais... Il se renversa en arrière. L'image du gisant lui apparaissait debout.
Celui-ci a trouvé, dit-il gravement.
Le silence l'entoura d'une raideur sacrée, comme une armure.
Gabriel en chercha le défaut.
Si c'était votre fils ?
Je l'envierais...
Ce n'étaient ni la douceur, ni la crainte avec lesquelles les vieillards parlent de la mort. Mais une résolution calme de jeune homme. Gabriel pensa qu'un lien très fort devait l'unir à son fils, et que leurs deux vies travaillaient à s'enrichir. Le Père comprit sa pensée et la nia en hochant la tête, mais cette fois avec intention. Sa bouche tremblait légèrement.
Non... Je l'envierais comme tout autre gisant. Voyez-vous, je crois qu'il y a entre un père et un fils une absence... définitive. Quelque chose d'infranchissable... C'est peut-être seulement l'absence de désir, ajouta-t-il nettement. Il réfléchit une seconde. C'est curieux, mais sous beaucoup de rapports, l'espace qui me sépare de Vincent n'est pas moins large que s'il était mort. C'est cela que je voulais dire. La question n'est pas que l'image que j'aime de lui soit vivante ou morte, mais que cette image ne me déçoive pas... La communion avec la vie, avec sa vie, cela m'est interdit. Il réfléchit encore. Et si je voulais être très... lucide, je crois que je trouverais quelque chose comme le secret espoir de le connaître enfin... Interdit de communier avec sa vie, mais... peut être permis de communier avec sa mort. Ses traits s'étaient accusés. D'un demi-sourire, tout s'effaça : Voyez-vous, comme on en vient à désirer obscurément la mort d'un être qu'on aime... plus que tout chose. Enfin... cela vous explique pourquoi je n'envisage pas la mort comme vous.
Oh, je ne suis pas en cause, dit Gabriel. Il me serait difficile de vous expliquer à quel point je vous comprends, mais... je pensais à eux.
Eh bien, voyez-vous... il sont très pris par leur action. Pour des motifs tout à fait différents des miens, évidemment. Mais pour Vincent, la question ne se pose pas. Il y a en lui cette sorte de fatalité qui ne mène qu'à lamort, elle aussi. Et ils s'aiment. Cela, c'est grave.
Elle est sa fiancée ? Gabriel avait pris Christel pour la sœur de Vincent.
Sa maîtresse, dit simplement le Père. Ils sont sur un plan très curieux, vous savez. Leur amour est une tentative de se séparer du monde, c'est même la reconstruction du monde, parce qu'ils l'ont nié. A la limite, c'est la mort. Vous voyez que tout y conduit. Moi...
Gabriel se voyait reculant sur une route obscure, tenant le Père par la main. Au bout de la route, une lumière clignotante. Cette pièce. Ces masques. Ces livres. De lourds alluvions du passé. Et une présence totale, plus forte que Dieu : la Mort. Sans linceul, sans faux, sans le décrochez-moi-ça des imaginations humaines. Comme un goût sauvage dans la bouche, et la curiosité de fruits inconnus.
Moi, continuait le vieil homme, j'étais né pour cette création qu' « ils » ont trahie. On a parlé de moi, comme de jeune écrivain... Ne cherchez pas. Parlé, pas écrit. A part quelques critiques. Et mon seul ouvrage publié, j'en ai acheté tous les exemplaires. Après un peu... très peu de temps, je me suis résolu au silence. Le mécanisme est le même, voyez-vous, pour peu qu'on cherche sa profondeur. A la limite de toutes les expressions, il y a le silence, comme à la limite de toutes les amours, la mort... Il ferma les yeux. Et l'extraordinaire... l'extraordinaire, c'est la puissance des images qui vous viennent alors. Le monde a des réactions de femme. On ne saurait croire ce que sont ses dons, pourvu qu'on le nie... Il sourit : Ne me prenez pas pour un maniaque de la mort. Mais si le grain ne meurt...
Gabriel tremblait. Devant ce vieillard prophétisant, il se sentait aussi démuni que lorsqu'il avait cru protéger Vincent. Je suis venu trop tard, pensa-t-il. Ou trop tôt ? Cette fierté, cette recherche d'une route unique, dans la solitude, tout cela échappait à son royaume. Quelle aide apporter à une race qui ne trouvait de forces que dans son abandon même ? Il était venu à la suite d'une prière de Vincent, qui semblait croire, et se confier. Mais il comprenait maintenant qu'on lui demandait un témoignage plus qu'un secours, et que cet appel dans la vie des hommes était aux bornes du défi.
Vincent et Christel rentrèrent. Ils avaient mis leurs manteaux, et Christel un foulard bleu noué lâchement. L'impatience de l'aventure les illuminait, leurs jeunes corps frémissaient comme des animaux avant la course.
Vous venez ? Dit Christel, la bouche entr'ouverte, les yeux mi-clos. Gabriel pensa qu'elle devait avoir ce visage dans l'amour.
Vincent adressa à son père un sourire rapide, et sortit. Christel, d'un geste dont elle eût ri chez une autre, le suivit pour relever le col de son manteau. Gabriel se leva à son tour, un peu bouleversé. Ce que Vincent lui avait sit au jardin flambait sur les murs, autour de ce vieillard calme. Il fut sur le point de lui crier la vérité. Malgré lui, ses mots se transformèrent.
Et... dans cet abandon, VOUS pouvez croire en leur action ?
Il se tenait devant la porte entr'ouverte. Vincent et Christel l'attendaient en bas.
Le Père se pencha sur la Bible ouverte et déplaça le signet aux lignes cruelles. La lumière creusait de nouvelles blessures autour de son visage de dieu lassé.
Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, lut-il, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, où tu vas.
Gabriel resta immobile le long du mur. Le Livre. Le vieillard. Le gisant. Une ligne qui les joignait, et les menait dans une sérénité pleine de vie à l'infinie désolation. Tout cela lui apparut éloigné, et fuyant de lui à une vitesse effrayante, jusqu'à ce qu'il ne vît plus rien qu'un mur lisse et sombre. Il s'aperçut qu'il avait refermé la porte.
Mais il y a tout le reste, dit le Père dans la pièce vide.
Entre les barrières blanches, des soldats entraient. A chaque entrée, une boursouflure de lumièreet de rires éclaboussait la rue, et aussitôt se perdait. Une seule sentinelle, engourdie, se balançait comme un ours le long de la façade.
Le cycliste repassa sans se presser. Sa veste de cuir brilla devant la sentinelle, qui ne bougea pas. Vincent et Christel, sous un porche voisin, semblaient fort occupés à s'embrasser. Gabriel, à demi invisible, observait la rue. Quand le Grand Chef tomberait au pouvoir de cette lumière hâtive, le cycliste repasserait, et... Justement, il venait de s'arrêter au carrefour, et s'affairait à une vague réparation. Alors, Vincent se jetterait devant la porte, un lourd paquet à la main. Il le balancerait. Le cycliste aurait le temps de s'enfuir. « Pourquoi lui ? » avait demandé Gabriel. Vincent n'avait pas répondu. Quant à Christel... Christel ? « A la limite, c'est la mort ». Peut-être incarnaient-ils l''intelligence de Père. Ou sa volonté... Gabriel frissonna devant la puissance d'un homme, il eut peur.
Les voix se turent à l'intérieur du Foyer. Puis ce fut un chant de femme. La sentinelle se retourna, comme pour voir à travers le mur. Des passants s'arrêtèrent. C'était une étrange chanson. Sur une cadence militaire et vivante, des paroles pleines d'ombre qui la démentaient, un tableau de ville morte, et l'appel d'une impossible union...
Wie einst, Lily Marleen,
Wie einst, Lily Marleen...
La voix s'enflait. Il y passait tout le vent des campagnes vaines, des victoires dont l'enjeu s'échappait, des conquêtes insaisissables. Quelque part, des lignes de cavaliers franchissaient les frontières de l'Europe, avançaient sur des villes enflammées. D'autres montaient dans les brouillards de l'aube. D'autres veillaient sur la nuit cloutée d'or. Et le même vide se déployait devant eux, comme un drapeau. Et il fallait un espoir. Alors la voix chantait un jour attendu, les nuages s'évanouissant sur les fleuves, et une lointaine, si lointaine lumière.
Wie einst, Lily Marleen,
Wie einst, Lily Marleen !
Comme une vague se brise en roulement de galets, la chanson se fondit dans les applaudissements. Les gens de la rue, eux, demeurèrent immobiles. Gabriel découvrait les hommes. Ils avaient des pensées qui lézardaient le vieux monde, et des chants qui faisaient trembler les anges. Peu importait que cela concourût à leur destruction. C'était encore leur affirmation. Leur suprême défi.
Vincent et Christel ne bougeaient plus. La chanson, en passant sur eux, les avait pétrifiés. A l'image de son désir. Wie einst... Ils goûtaient pleinement une de leurs victoires, une possession totale qui ne se distinguait pas du total anéantissement.
Quelqu'un sortit du Foyer. Il portait l'insigne des hommes d'armes, mais Gabriel reconnut le conducteur de l'incompréhensible course. En passant à la hauteur de Vincent, il jeta : « Il sort » et s'éloigna rapidement. Quand il eût été dépassé le cycliste, celui-ci remonta lentement en selle et revint vers les barrières. Vincent fit tourner Christel en simulant un nouveau baiser, afin de voir la porte de face. Gabriel, collé au mur, cherchait dans sa sensibilité d'ange une émotion qui fût égale à cela. Le cycliste avançait toujours. Si lentement qu'il allât, il était sur le point de dépasser la sentinelle. « Il va le manquer » pensa Gabriel, qui aussitôt s'étonna de trouver en lui des réflexes d'homme. Il ne regardait plus la porte, mais cherchait sur le visage de Vincent la beauté de celui qui va tuer. C'est quand il le vit abandonner Christel et se dresser, les bras suppliciés, une joie de crucifié dans les yeux, qu'il comprit que le Grand Chef venait de sortir.
Non. Ce n'était pas possible. Tout cela était concerté, truqué. Un homme immense, grandi par une tunique d'officier aux parements éclatants, en pleine lumière, attendant la mort, immobile, la sentinelle immobile, Vincent et le cycliste avançant avec une lenteur sous-marine. L'homme ne criait pas, la sentinelle ne tirait pas, les deux exécuteurs s'approchaient. Qu'était-ce que ce spectacle au ralenti, ce sacrifice où chacun consentait, où tout était prévu et nécessaire depuis les siècles des siècles et les générations des générations . Le Grand Chef de tous les hommes d'armes, ceux qui jettent des flammes et ceux qui s'enfoncent dans la mer, les volants et ceux qui portent de sombres étendards, les muets qui ont un collier de fer et ceux dont le vêtement est noir avec des ossements de métal, celui-là s'arrêtait en pleine lumière, à quelques pas de son meurtrier... Gabriel ne s'apercevait pas que l'intensité de la scène lui avait fait oublier le rythme du temps. Le regard de Christel, amoureux et sauvage, le lui rappela, et les choses redevinrent rapides et aveuglantes. A peine avait-il reconstitué le tableau de la rue, qu'il fut déchiré par un pointillé de bruits furtifs et cruels... Le cycliste disparaissait, les images se succédaient sans lien, comme un album vivement feuilleté. C'était le Grand Chef incliné dans la clarté des villes détruites, le visage collé à ses insignes. Puis son corps étendu en travers de la porte, avec une grande rumeur naissant derrière lui, et le geste de la sentinelle... Et brusquement, immense comme une statue de neige, le geste de Vincent qui lui répondait... Alors ils plongèrent dans le feu, et tous les vents tournèrent autour d'eux, joufflus et ailés comme on les voit sur les cartes, hurlant à déchirer la vie. Des ombres se disloquèrent, il vint des sifflets, des cris étrangers, et tout au fond un incompréhensible froissement d'étoffe. Gabriel volait parmi les ruines. Quand il reprit son apparence et sa démarche, Vincent et Christel, debout à côté de lui, revenaient vers l'explosion. Alors il sut que tout était accompli.
Vincent et Christel se hâtaient, sachant que la fuite les eût perdus, tandis qu'ils prenaient l'aspect de curieux venant aux nouvelles. Et ceux qui avaient vu agir Vincent étaient morts... Près des barrières tordues, dans un grésillement de ténèbres, on courait, on improvisait des secours. Des hommes d'armes surgissaient de tous côtés, barraient les rues. A quelques pas du mur déchiqueté, Vincent s'arrêta. Un corps noir à ses pieds. Le corps se retourna et gémit. Des insignes de métal brillèrent. Un guerrier. Christel repartait, mais Vincent s'agenouilla.
Le visage du blessé apparut dans la lumière. C'était un garçon de l'âge de Vincent. Sous le bonnet rejeté en arrière, une mèche ensanglantée se tordait. A son col flambaient les petites têtes de mort. Vincent le soutenait avec un geste de Pietà et cherchait à comprendre ses paroles. Christel le regardait sans haine, mais avec un peu de répulsion. Gabriel devinait quelque chose d'encore inconnu derrière ces attitudes simples.
Bouge pas, vieux, dit Vincent. Il y avait dans sa voix une grave tendresse, celle que les femmes n'entendent jamais. Le blessé dit quelques mots en langue étrangère, et fut pris d'un long tremblement. Vincent leva les yeux vers Gabriel.
On peut quelque chose pour lui ?
Prier, dit Gabriel.
Vincent secoua la tête et se pencha en avant. Le sang coulait sur ses mains. Le blessé le regarda. Il avait compris la réponse de Gabriel. « Je suis tué », dit-il en bafouillant.
Penses-tu, dit Vincent. Tu essaies de te rendre intéressant.
Je l'ai compris, lui... Il tentait de voir Gabriel confondu au mur.
Faut pas le croire. C'est un gros menteur. On va te visser une tête de bois et tu te sentiras mieux, non ?
Le blessé sourit du coin de sa bouche non encore crispé par la mort. En remuant la tête, il se blottit dans la pliure du bras de Vincent avec un geste d'enfant malade. Vincent releva la mèche de sang et maintint sa paume à plat contre le front brûlant. Ses yeux avaient perdu toute leur dureté, et maintenant plus qu'au moment du combat, il semblait avoir repris son vrai visage. « C'est ça, dors » dit-il très doucement. Le blessé se remit à gémir et à balbutier. Inutilement, les bras de Vincent tentaient un mouvement de berceuse, comme pour marquer le rythme de ce murmure de mort qui avait été celui des forêts du Nord, lorsque la guerre était encore pure et vraie comme l'aube. Vincent écoutait avec une détresse calme l'écho de sa voix la plus profonde, et reconnaissait deux syllabes, toujours les mêmes. Pourquoi. Pourquoi.
T'occupes pas, dit-il. Tout ça nous dépasse. Mais tu peux te laisser aller. Je suis un camarade. Le blessé râlait. « Ru entends, cria presque Vincent, camarade ; Ca-marade ! Je suis un ca-ma-rade ! » Le bonnet glissa à terre, et le front meurtri, de son poids, retourna le visage. Les traits, maintenant, étaient calmes. Vincent soutenait absurdement ce corps mort. Il n'y avait plus autour d'eux que le silence.
Je crois que vous pouvez laisser...
Un officier était debout près de Vincent. Sans doute avait-il entendu leurs dernières paroles. Dans son uniforme raide, il semblait guindé et ému. Vincent se leva, et grimaça en tenant son bras engourdi par l'effort. Christel et Gabriel s'approchèrent.
Vous étiez... Il cherchait ses mots. Vous avez été très... bon pour cet homme. Je veux simplement vous dire... merci. Il tendit la main. Vincent la serra machinalement, stupéfait. Vous pouvez aller ! L'officier avait repris son ton naturel. Il donna l'ordre aux soldats de laisser passer. On chuchotait dans la nuit. Plusieurs suspects avaient été immédiatement arrêtés. Une femme pleurnichait. Les solats insultaient les civils à voix basse. De vagues fumées dansaient dans la rue éteinte. Vincent et Christel marchaient vite, tremblants d'énervement. Tout cela est si absurde, pensa Gabriel, et il crut que tout était fini.
C'est à ce moment qu'un long cri de bête courut au ras des toits, alluma d'autres cris sur son passage, et que la ville connut sa menace.
Ils étaient descendus au plus proche abri, une voûte puissante écaillée de faïence, bariolée d'images aux couleurs violentes. La foule s'y allongeait avec bonne humeur. On échangeait des plaisanteries. « La bombe, quand elle arrive, elle fait comme ça ». Sifflement de plus en plus grave. « Alors, quand ils se sont trompés, elle repart, comme ça ». Sifflement de plus en plus aigu. On riait. « Il ne se passera rien » disait quelqu'un, « c'est le Commandant qui veut faire peur à son petit garçon, parce qu'il s'est mal tenu à table ». « Cela ne doit pas vous inquiéter », disait un jeune homme à sa compagne, « il y a aussi peu de chances d'être touché que de gagner à la Loterie. ». Peu à peu, les plaisanteries s'usaient. Les plus vieilles ressortaient, dernier recours contre le silence. Mais le silence venait quand même ; lentement, il se glissait entre les groupes, les voix se faisaient basses, comme dans une église, la grande cathédrale de la peur. Enfin, elles se taisaient. Alors, on entendait, très haut, le bourdonnement des machines, et les premiers appels de canon.
Gabriel avait tenté de reparler à Vincent de son jeune mort. Il s'était détourné brusquement, et Christel l'avait regardé avec inquiétude. Ce n'est pas la haine, pensait Gabriel. C'est au-delà de la haine. Il avait espéré un moment que la puissance des hommes n'était pas aussi nouvelle, que ce n'était au fond qu'un nouveau masque sur le vieil instinct de combat. Et puis cette fraternité profonde du meurtrier et de sa victime... Christel semblait moins obscure, sur ce point. Elle haïssait, elle, fortement. Gabriel revoyait avec une sorte de fièvre les heures de cette étrange soirée. Vincent était sûr de mourir. Il le lui avait dit, dans les jardins déserts, au bord du fleuve, quand il n'était encore qu'un garçon confiant au regard dur. Et tout était si différent...
Gabriel devinait que le plus humiliant pour Vincent était cette pitié vraie qui l'avait sauvé comme une ruse.
Les coups se firent plus proches. Le sol trembla légèrement. Un bruit de moteurs courut depuis le fond des voûtes, devint un miaulement rouillé, et disparut dans un éclatement de pièces. « Maintenant, passez les piétons », dit un homme, et l'on se remit à rire. D'autres coups frappèrent, très loin, couverts par la cadence brève des armes rapides. Les moteurs tournaient au-dessus de la ville.
Vincent passa la main sur son front, et s'éloigna. Gabriel et Christel respectèrent sa solitude. Il se tenait à l'entrée du tunnel. Son visage était très las.
Peut-être a-t-il besoin de vous... murmura Gabriel.
Je ne crois pas, dit Christel. Je ne sais pas ce qu'il va chercher là-bas, mais... j'ai l'impression que ce n'est pas moi. Elle regarda fixement Gabriel. Pour la première fois, tout à l'heure, nous n'avons pas eu une émotion qui nous soit commune. C'est grave, dit-elle sur le ton même du Père, lorsqu'il parlait de leur amour.
Les moteurs se groupaient, très loin, amorçaient un retour d'animaux traqués.
Christel parlait. Gabriel avait compris qu'elle ne s'adressait plus à lui, mais à Vincent, immobile, qui ne l'entendait pas.
Jusqu'ici, les êtres les plus proches que j'aie connus étaient encore à des distances incroyables, et nous... Il a fallu que nous souffrions beaucoup l'un par l'autre pour parvenir à cela. C'est au mal que nous nous faisions que nous nous sommes reconnus. Elle baissa la voix. C'est à l'étendue de ma douleur que j'ai mesuré toute la joie que tu serais capable de me donner...
L'essentiel vous reste en commun, dit Gabriel.
L'essentiel, dit Christel, c'est que tout nous soit en commun.
Les moteurs revinrent, bêtes chassés. Le bruit se gonfla, érailla les parois, déchira les pensées. Pendant quelques secondes, il fut l'unique élément des gens du tunnel. Puis un sifflement vint le rayer, de plus en plus grave... Ils comprirent. Déjà, la plupart des hommes s'étaient jetés à terre, entraînant des femmes. Vincent leva la tête. Christel était restée debout, et ouvrait la bouche dans un grand appel muet... Le choc fut sombre, sans flamme. Les bruits se séparèrent, avec les couleurs. Quand ce puzzle reprit sa place, l'extrémité du tunnel achevait de s'effondrer. Plusieurs personnes y restaient prises, ou avaient roulé plus près, mutilées. Vincent était renversé parmi elles. Intact. Beau. Mort.
Gabriel le savait. Cela devait être. Et cela était bien. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Christel, loin de lui maintenant, prise par la foule, se jetait sur le premier guerrier venu, lui arrachait son poignard, frappait... Un autre guerrier tira, au petit bonheur. La foule s'agita comme un poulpe blessé. Des rixes éclatèrent. Les soldats tentaient de se grouper près de la sortie. On les piétina. Et ce fut une effrayante pantomime. On emmenait Christel, repliée sur elle-même dans le geste des momies, déjà prise par une douleur d'un autre monde. Dans un silence crispé, les coups jaillissaient au hasard. La foule se détendait soudain comme une farandole, enlaçait quelques soldats désordonnés, et cognait. Personne ne prit garde au dernier cri de bête sur les toits, qui éloignait la menace. La foule ondulait, poussait des soupirs de fauve. D'autres hommes d'armes vinrent, qui la divisèrent. On se battit encore longtemps, et les silhouettes grotesques ou terribles s'évanouirent dans un brouillard de fatigue.
Gabriel resta seul devant le corps de Vincent. Il ne pouvait plus supporter son poids d'homme. Par la brèche du tunnel vint une chose incroyable : des hommes chantaient dans la rue, des hommes marchaient, s'appelaient... Des voix confuses, puis encore des chants... Quel est donc ce peuple ? Pensa Gabriel, et il étendit Vincent, les jambes droites, les mains croisées, en gisant.